'En Belgique - la zone de l'Avant (Henri Malo)
'En Belgique'
'la Zone de l'Avant'
par Henri Malo, 1915-16, 1918
'la Zone de l'Avant'
par Henri Malo, 1915-16, 1918
Avant-Propos
Ce livre fait suite à celui que j'ai consacré au Drame des Flandres. J'ai procédé comme précédemment, ne suivant d'autre plan que la succession des événements et le cycle des saisons. En décrivant les choses et les gens dans l'ordre où ils me sont apparus, je pense mieux réussir à faire partager les impressions que j'en ai reçues. Malgré les restrictions qu'imposent les nécessités de l'heure, et avec le regret de devoir atténuer ou effacer les touches parfois les plus vibrantes à ces tableaux, j'ai cherché surtout à recréer l'atmosphère où j'ai vécu. C'est là ce qui fait le plus souvent défaut aux documents d'archives, et ce que les historiens y découvrent le plus difficilement. J'ai tenté de combler cette lacune pour ceux de l'avenir, au moins en ce qui concerne le théâtre d'opérations où je fus témoin.
Au reste, cette vie du front est passionnante. On y est au contact de l'action immédiate, et je ne sais rien de plus réconfortant. L'air de danger que l'on y respire est tonique. Les émotions y décuplent l'intérêt de vivre. « On existe », comme me disait un soldat. Les hommes que l'on y coudoie apparaissent grandis de leur sacrifice consenti. On se convainc que celui qui a fait abnégation de sa vie atteint le plein de sa puissance et de sa valeur morales, ce qui prouve bien que l'homme vraiment supérieur est celui qui pratique le désintéressement absolu pour une idée.
Auprès de telles gens, en de telles circonstances, au milieu de cette nature particulière du pays de Flandre qui ne se laisse pénétrer que par ses élus, mais qui alors les captive et les imprègne, j'ai vécu des heures qui comptent parmi les plus fortes de mon existence. J'espère en avoir projeté le reflet sur les pages qui vont suivre, et j'aurai atteint mon but si, à les parcourir, le lecteur éprouve les mêmes émotions qui me les dictèrent.
…
En Belgique : La Zone de l’Avant
Chapitre Premier : Les Lignes
Une Forteresse Gigantesque
Lorsque, la bataille des Flandres terminée, les armées ennemies se trouvèrent fixées face à face, suivant une ligne fortifiée allant de la mer du Nord à la frontière de Suisse, un général allemand proclama:
— Nous assiégeons la forteresse France.
Proposition vraie, à condition de l'inverser. Les événements se chargèrent de démontrer qu'en réalité les assiégés ne se trouvaient pas du côté que pensait le général allemand.
Ainsi tout, dans cette formidable guerre, prend des proportions gigantesques. Non pas même deux pays, mais deux groupes de pays s'affrontent. Le rempart et le fossé de jadis deviennent un ensemble d'ouvrages s'étendant sur des kilomètres de profondeur, perpendiculairement au front.
Ici, sur celui de l'Yser, n'existait au début qu'une mince ligne de tranchées, quelques pelletées de terre humide remuée sous l'averse des balles ennemies. Les obus éboulaient constamment le frêle talus; en hâte, il fallait obstruer chaque nouvelle brèche sitôt produite. On y parvint. Au prix de combien d'efforts, de quel héroïsme, nous le savons.
Depuis lors, des dizaines de milliers d'hommes ont travaillé sans relâche, et continuent à travailler, sous les rafales de vent, de pluie, de projectiles, avec une admirable ténacité. Aujourd'hui, la défense est nettement infrangible. On m'a cité un secteur de 9 kilomètres de front que défendent 71 kilomètres de tranchées. Un autre, sur 8 kilomètres de profondeur, offre neuf lignes de défenses avant la dixième, un obstacle qui se montrerait, le cas échéant, aussi puissant que l'Yser.
Un Immense Chantier
Si l'on vient de l'arrière, on traverse une première zone transformée en un immense chantier, vin immense atelier. Les innombrables matériaux déversés par les trains, parles charrois, par les bellandres, s'y accumulent: amas de planches, rondins, pieux, clayonnages, rails, fils de fer barbelés ou grillagés, tôles ondulées, briques... rémunération complète n'en finirait plus. Une seule catégorie, toujours présente, toujours invisible, n'apparaît qu'au moment d'être utilisée: les munitions.
J'ai naguère tenté de donner une idée des monceaux de matériaux qu'il fallait amener au front, pour édifier une seule de ces villes souterraines servant de point d'appui à la première ligne. Qu'on imagine la quantité nécessaire à la mise en défense non plus seulement d'un point d'appui, mais d'une région tout entière. Car il ne s'agit de rien moins que de cela. Dans la zone où nous sommes, ces matériaux sont manutentionnés, travaillés, et adaptés à leur fonction définitive: la pointe des pieux aiguisée, les planches assemblées en passerelles, les clayonnages arrondis en gabions. Des équipes de charpentiers rabotent cl scient. Le feu ronfle aux forges de campagne où les forgerons battent le fer. Partout une incessante activité, une allée et venue continuelle, un forcené labeur.
La Plaine Farouche
Les hivers où la paix régnait, la plaine s'allongeait, dépouillée; une onde de mélancolie la parcourait, mais mille tristesse amère n'en émanait. Elle sommeillait, elle se reposait, elle acquérait des forces nouvelles pour nourrir les germes confiés à son sein.
Dénudés et farouches, ses champs n'offrent plus l'harmonieuse alternance de prairies, de vergers, de labours hachurés régulièrement par les sillons pareils et parallèles que traça la charrue. L'humus, générateur de richesses, ne couvre plus uniformément le sol. La glaise du sous-sol profondément remuée étale en taches claires sa stérilité sur la bonne terre qu'elle étouffe. Les arbres, mutilés de leur ramure, érigent des troncs informes, où des cicatrices blanches ou rousses marquent les blessures provenant de l'amputation des maîtresses branches. D'énormes vides s'ouvrent dans les haies entourant les fermes, on bornant les propriétés en bordure des chemins.
Plus on avance, et plus la détresse de cette province s'accentue. Le regard cherche en vain les clochers, qui, de loin, permettaient de reconnaître et de nommer les paroisses; les flèches hardies ou élégantes, les tours massives qui caractérisaient le paysage, oui disparu. Les villages et les fermes montrent leurs blessures. Ce n'est d'abord qu'un toit défoncé parmi une rangée de maisons intactes; puis, en avançant, des rues entières dont chaque demeure reçut quelque dommage, tuiles envolées, charpentes rompues, maîtresses poutres brisées comme des allumettes, plafonds effondrés, façades éventrées, pans de murs percés de trous circulaires d'un diamètre tel qu'un homme y passe sans se baisser. En avançant toujours, on en arrive aux villes et aux villages rasés au niveau dii sol.
La vie se retire peu à peu des lieux habités, devenus de moins en moins habitables.
Une autre vie s'est substituée à celle-là.
Que l'on scrute attentivement ce paysage désolé, ces étendues en friche: on leur découvrira des aspects surprenants. Voici un champ, dénivelé, coupé de mares d'eau, et qu'à l'automne nul soc n'ouvrit en vue des semailles coutumières; qu'est cette étroite el profonde fissure qui le zèbre à angles aigus? Il faut la dominer immédiatement pour l'apercevoir. Elle n'est pas unique, le terrain en est étrangement crevassé.
Ailleurs, des cubes de terre semblables à des briques de tourbe, s'entassent, laissant à hauteur d'homme, au milieu de leur masse, un couloir qui chemine à angles droits et réguliers. L'ouvrage, coupé perpendiculairement vers l'arrière, se raccorde au sol du côté de l'ennemi par une pente douce couverte de carrés de gazon, qui se soudèrent et forment une nappe unie, un glacis.
Au flanc d'un tumulus, s'ouvre une entrée donnant sur une salle sombre, une caverne artificielle, dont la voûte est faite d'une paroi métallique à larges ondulations. Des réseaux de fils barbelés disposés en rectangles hérissent leur enchevêtrement; d'autres contournent un mouvement de terrain; il en émerge d'une mare bourbeuse. Des chevaux de frise sont prêts à fermer au premier signal les passages en chicane qui donnent l'accès. Partout des ouvrages, des abris, on dirait jetés au hasard, mais qui, en réalité, obéissent à un plan coordonné, se flanquent, se recoupent, s'étirent, se tassent, non point capricieusement, mais de manière à s'épauler l'un l'autre et à former un tout.
Telles sont les lignes, qui n'ont rien de commun avec les tracés parallèles que certains esprits simplistes semblent parfois tentés d'imaginer.
Parmi ces ouvrages, de longs fossés serpentent, permettant d'y accéder ou de s'en ici irer en se dissimulant aux vues de l'ennemi. Des tiles de petits piquets repèrent les chemins de colonnes. Plus une berge, plus un chemin de hâlage où ne soient aménagées des tranchées solides et «dernier cri». Le génie belge y fait merveille: et ce n'est pas lui qui me l'a certifié, mais bien des observateurs à même de comparer.
Dans cette zone, une ferme en ruines devient un fortin, et les décombres d'un village cachent une forteresse redoutable. On n'y circule jamais longtemps sans sursauter à la détonation subite d'invisibles batteries.
Au cours des guerres d'autrefois, on localisait la défense en un certain nombre de points stratégiques où les forces limitées de l'envahisseur venaient fatalement buter. De nos jours, la défense ne porte plus sur des points, mais sur toute une région, où l'on utilise pour l'assurer le moindre mouvement de terrain, le moindre accident du sol; elle épouse étroitement les formes de la terre. Il ne s'agit plus de ceinturer une ville avec une muraille: la ceinture qui sauvegardera tout un pays est d'autre envergure. Pas un arbre, pas un ruisseau, pas une motte de la terre des champs, — la bonne vieille terre ancestrale, — pas une brique des maisons même détruites, qui ne concourent à l'effort de résistance, qui ne tendent au but de libération.
La Visite d'un Village Fortifié
Je désirais visiter un village mis en état de défense. On me conduit à X. Les artilleurs boches ont un faible pour ce malheureux patelin. Ils se montrent à son égard d'une générosité excessive, qu'ils dispensent avec précision, sans qu'il faille leur en faire autrement un mérite: ce but est le premier qui s'offre à leur tir, derrière la tranchée de première ligne.
Dès les approches, des entonnoirs d'un diamètre respectable parsèment les abords de la route. À l'entrée, six à sept tombes juxtaposées, ornées d'une profusion de fleurs à peine fanées et de couronnes toutes fraîches.
— On les a enterrés là où ils ont été tués, dit l'officier qui m'accompagne.
Cinquante mètres plus loin, l'auto stoppe, sur un signe de la sentinelle qui monte sa faction devant le poste. Ce poste se loge dans un cotje, l'annexe d'une masure, réduit peu luxueux, mais auquel un solide rempart de sacs de terre constitue une appréciable richesse.
Du village, plus grand'chose ne subsiste sur un côté de la route; sur l'autre, des maisons fort entamées. L'église se réduit à un pan de mur. Le sol du cimetière qui l'entoure est nivelé, et l'on ne distingue plus la trace des tombes. Quant à la grand'place, elle rappelle assez exactement celles de la Concorde ou de l'Alma, au cours des dernières années qui précédèrent la guerre. On se souvient qu'une administration prévoyante et maternelle les avait défoncées, coupées de fondrières et de précipices, hérissées de palissades, dans un but alors ignoré: avec quelque apparence de raison, on peut supposer aujourd'hui qu'il s’agissait d'une mise en défense anticipée.
La ressemblance est frappante, et je m'y reconnais aussitôt: ici aussi, des tranchées, des boyaux, des bétonnages, des parapets, des fils de fer, rendent la circulation impossible. Momentanément, des planches jetées sur ces obstacles permettent de les enjamber. Une équipe de travailleurs s'occupe à les consolider, à les augmenter. Il s'en trouve un réseau non moins compliqué à l'extérieur du village. Pour bien comprendre l'agencement de ces dispositifs, il faudrait un plan, ou la vue d'ensemble que procure un coup d'œil jeté de haut.
Cette réflexion m'incite à regarder en l'air, instinctivement. Les quelques habitants demeurés chez eux, surtout les femmes qui, debout sur le pas de leur porte, nous dévisageaient avec curiosité, en font autant. Immédiatement au-dessus de nous, un taube, immobile et minuscule, plane comme un épervier.
Dans un quart d'heure, nous aurons des obus, dit quelqu'un.
Même pas. Gi, gi, gi... Une voix crie:
— Au blockhaus!
Les travailleurs abandonnent leurs outils, et s'y dirigent par un chemin de planches. Les femmes fennenl sans hâte les volets de leurs maisons. Gi, gi, gi...
— Par ici, monsieur, m'indiquent les soldats.
Engagé dans un boyau, je le suis dans la direction indiquée. Je barbote dans l'eau jusqu'au genou. Un rouleau de fils de fer, oublié là, me barre la route. Gi, gi, gi... Cela se rapproche. J'esquisse un rétablissement dans la boue pour gagner le chemin de planches. A ce moment, je me retourne; à soixanle mètres, dans une prairie, un éclatemenl; la boue gicle parmi la fumée noire. Encore quelques pas, et j'arrive au blockhaus.
— Placez-vous là... de ce côté... \ous serez protégé par le bétonnage.
Une douceur affectueuse empreint la voix du petit soldat belge qui me dit cela. Et je comprends la fraternité de la tranchée.
On se demande: est-ce le taube qui a lâché une bombe? Est-ce un obus? Cette dernière supposition est la vraie, sans aucun doute. A l'éclatement, au ronflement, et à ce fait qu'on l'entendit venir de tres loin, des experts précisent que le projectile est un 150, en acier, dernier modèle.
L'on m'explique: le taube, envoyé en reconnaissance pour savoir si l'on réparait des dégâts causés par un précédent bombardement, a communiqué par télégraphie sans fil à la batterie allemande que tel était bien le cas. Sur quoi la batterie a envoyé un obus dont l'aviateur a observé l'éclatement, qui lui permettra de donner le repérage exact pour le réglage du tir. Le temps qu'il transmette cette communication, et l'on peut être certain que cela va pleuvoir. On voit comme c'est simple.
Inutile de rester là. Nous traversons la place, complètement déserte. Les soldats ont disparu dans les abris; les rares civils se calfeutrent chez eux, sans réfléchir que leurs hicoques, dépourvues de caves, ne leur fournissent qu'une protection illusoire. Le moteur se met en marche, nous grimpons dans l'auto, et nous filons.
Un peu plus loin, nous nous arrêtons à un village que j'ai connu florissant. Je l'ai visité après un premier bombardement: l'église seule était sérieusement entamée. Le voilà aujourd'hui au moins aussi abîmé que celui d'où nous venons. Ici encore, le sol du cimetière fut nivelé; une tranchée le contourne; on rejeta la terre sur les tombes aux monuments disparus, et dont les morts dormiront désormais un sommeil anonyme. Une rangée de hauts peupliers longe un des côtés de l'enclos sacré; plusieurs, frappés en plein cœur par les obus, se brisèrent par le milieu: une rupture compliquée, un arrachement plutôt. De l'église, il ne reste debout que quelques pierres, où l'on fixa un écriteau: «Défense d'emporter les matériaux sans la permission de l'autorité militaire.» Le reste fut déblayé; plus de gravats, plus de décombres, un espace nu. Des fragments de dallage indiquent l'emplacement de la nef; une mare d'eau s'étale à la croisée du transept. Malgré l'habitude, une émotion me serre le cœur en présence de cette destruction totale. D'ordinaire, les monceaux de pierres et de poutres fraîchement brisées, les murs qui ont résisté, parlent assez à l'imagination pour lui permettre de reconstituer dans son intégrité le monument meurtri. Il n'est pas anéanti. Ici, plus rien. Le vide. C'est un stade nouveau dans l'accomplissement de l'œuvre de guerre, le stade de l'oubli, qui commence. Ce petit pan de mur, déjà patiné par les pluies, déjà rongé de lichens et de mousses, pourrait aussi bien avoir servi à borner un jardin de maisonnette.
C'est l'emplacement d'une église où pendant des siècles vécut l'âme du village? Il s'est passé là quelque épisode de la lutte gigantesque, de l'événement qui a bouleversé le monde? Qui s'en douterait? Il ne reste rien. Cet écriteau tout neuf — très administratif, — qui défend d'enlever des matériaux, semble une amère plaisanterie: il n'y a plus de matériaux à enlever. Il faut supposer qu'on l'a placardé trop tard. Il ne reste rien. Rien que le vent qui pleure dans les peupliers brisés.
Les sifllements, les éclatements ne cessent pas du côté de X., qui encaisse copieusement.
…
Chapitre II : Les Cantonnements
Une Vie Nouvelle s'Organise
Dans les villages, dans les hameaux, dans la dernière station du littoral belge restée à peu près habitable, le provisoire s'est mué en définitif. C'est-à-dire que, la guerre se prolongeant sur place, — on compte à peine une douzaine de kilomètres d'ici à la ligne de feu, — les gens ont pris leurs habitudes.
A priori, le fait paraît étrange. Rien de plus humain, cependant, ni de plus heureux. D'une manière générale, cette faculté d'adaptation, et la faculté d'oubli, contribuent pour une large part à rendre l'existence supportable. Elles constituent pour l'homme undouble et réel bienfait. Il faut un tempérament d'Allemand pour pouvoir vivre avec dans le cœur une haine datant de Conrad de Hohenstaufen, et toujours vivace. S'adapter et oublier: le Français y est passé maître. De là vient la réputation de légèreté'que lui attribuent les peuples incapables d'en faire autant; il aura fallu l'épreuve de la guerre pour leur démontrer qu'ils avaient prononcé un jugement téméraire. Encore n'est-il pas bien sûr qu'ils en conviennent. S'adapter, c'est raboter ses propres aspérités. Oublier, c'est passer un coup de gomme sur la somme du mal qui totalise le plus clair de notre passage ici-bas.
J'ai connu un poilu qui déclarait:
— Je n'aime pas à quitter ma tranchée, parce que quand j'y reviens, je trouve toujours qu'on a dérangé mon mobilier.
Il prouvait ainsi son adaptation parfaite à un genre d'existence peu séduisant en soi, et d'un confortable approximatif. De plus, l'habitude lui avait procuré sinon l'oubli complet, du moins l'accoutumance au mal constamment en menace sur sa tête, le morceau d'acier susceptible de déchirer sa chair d'un moment à l'autre. Par quoi cet homme, un de ceux que les gens compliqués conviennent d'appeler des gens simples, atteignait sans effort aux confins de la sagesse.
Dans cette zone de l'avant où le hasard de la guerre m'a englobé, on a obtenu à la longue, par filtrages et barrages successifs, une population civile stable, pas très nombreuse, et d'autant plus facile à surveiller qu'on l'a pratiquement immobilisée dans chaque commune. Le civil passa à l'état de gibier traqué dans une chasse réservée au gendarme. Les remous de réfugiés incertains de leur route et du choix définitif d'un nouveau gîte, s'apaisèrent. Un nombre imposant d'agents de l'ennemi demeura dans le tamis. Quant aux habitants, ils partaient ou revenaient suivant que la fantaisie des obus ennemis accentuait ou diminuait le danger. Un beau jour, ceux qui avaient décampé vers l'arrière trouvèrent barré le chemin du retour. Et l'on ne manqua pas une occasion d'évacuer le plus de monde possible.
L'une de ces évacuations dévoila un côté assez inattendu de la psychologie d'une ville voisine. En prévision de circonstances critiques, le général-gouverneur afficha la liste des « bouches inutiles » qu'il se proposait de refouler vers l'arrière, le cas échéant. Ignorant cette formule classique de la langue obsidionale, nombre de personnes figurant dans les catégories susvisées se vexèrent; elles considérèrent le qualificatif de « bouche inutile » comme une injure personnelle. Or, les dignités blessées, les amours-propres égratignés, ne pardonnent pas; le général-gouverneur en fit l'expérience, et sa popularité pâtit de l'aventure.
De même que les civils, les militaires ont pris leurs habitudes. Pendant de longs mois, les mouvements réguliers de la relève ramènent les mêmes troupes aux mêmes cantonnements. Sitôt arrivé, chacun sait où se diriger, l'officier à sa même chambre, le soldat à la même villa, à la même ferme, à la même chaumière, suivant qu'il loge au bord de la mer ou à la campagne.
Les angles s'émoussent. On lie connaissance. Des amitiés se nouent. Des soldats saisissent l'occasion de se rendre utiles; quelques-uns donnent de sérieux coups de main pour les travaux des champs; les débrouillards mettent leurs talents en évidence. Volontiers, la fermière coupe une tartine de pain beurré et sert un bol de café fumant, en remerciement d'un service rendu. Par contre, elle a dû renoncer à élever des poulets: parmi les va-et-vient des gros godillots, les tendres volatiles n'auraient pas manqué d'être écrasés dans la prime fleur de leur âge. Pour beaucoup, l'indemnité afférente au logement des troupes est une aubaine. Une vieille femme payait pour sa chaumière 120 francs de loyer annuel; elle pleure toutes les larmes de son corps le jour où elle doit loger un militaire, un gradé de l'aviation française, mais se console en touchant un franc par jour d'indemnité, à quoi le militaire ajoutait de sa poche cinquante centimes. Si bien que le jour où il la quitte, celte femme désolée verse un nouveau torrent de larmes. Dans le voisinage, un fermier avait accueilli sans enthousiasme une compagnie d'infanterie désignée pour loger dans ses granges, mais il en considéra bien vite le profit. D'antre part, il fournissait de lait, de beurre et d'oeufs un mess d'officiers. Le jour où un ordre venu d'en haut déplaça la compagnie, sans la remplacer, le fermier s'estima lésé. Il refusa de continuer sa fourniture de lait, de beurre et d'oeufs aux officiers qui n'en pouvaient mais, et cela pour les punir!
Mais la grande raison pour laquelle le logement des troupes apparaît comme une véritable bénédiction, tient à ce qu'ici chacun naît commerçant. Le bon chroniqueur Froissart — et cela ne date pas d'hier, — notait que dans les nombreux pays qu'il parcourut, il rencontra toujours des Flamands en train d'acheter et de vendre. Cet instinct, puissamment développé par la pratique dès le temps de paix le long du littoral, rencontre aujourd'hui une occasion unique de s'exercer avec ampleur. Les initiés, qui savent la véritable signification de la formule: « Faire sa saison », me comprendront. Et ces vérités reçoivent une lumière nouvelle de cette parole d'un brave curé de la région qui, certain jour d'octobre, s'écriait en chaire:
— Mes frères, admirez la bonté du Seigneur: voilà les étrangers partis,... et voici les harengs qui arrivent!
Le tohu-bohu de la grande bagarre se calmait à peine, que déjà tout le monde se mettait à vendre quelque chose. Aux vitrines des magasins, aux fenêtres des maisons les plus dénuées de caractère commercial, les marchandises les plus hétéroclites s'empilent. D'anciennes cabines de baigneurs, le toit percé d'un trou par où passe et fume un tuyau fait de boîtes de conserves, deviennent des cuisines où se confectionnent des beignets. Elles s'alignent au point de former des rues nouvelles. Un avocat de Bruxelles, ruiné par la guerre qui l'a séparé de sa clientèle, fabrique des pommes de terre frites et ne perd pas son temps. Des éventaires volants se dressent sur les emplacements disponibles de la voie publique. Le marchand d'antiquités relègue dans un coin ses étains, ses faïences et ses bois sculptés d'une authenticité douteuse, et les remplace en devanture par des boîtes de macaroni et des pots de confiture non seulement d'une authenticité plus certaine, mais encore d'un intérêt plus comestible, et par suite plus immédiat, pour les poilus. A défaut de poisson, le poissonnier vend des choux, des carottes, des lacets de bottines et des tablettes de chocolat. Le marchand de bicyclettes vend des montres: c'est toujours de la mécanique.
Ces innombrables et diverses marchandises offrent un caractère commun: l'invraisemblable fantaisie qui préside à la cote de leurs prix. Pour justifier, — ou, par un reste de pudeur, faire semblant, — les valeurs hors de toute proportion avec la réalité que les mercantis leur attribuent arbitrairement, ces gens inventent les motifs les plus saugrenus avec une fertilité d'imagination qui parfois touche au cynisme, mais que certainement leur eût enviée Alexandre Dumas, le père.
Dans la villa même où j'écris ces lignes, M. de Molinari, à l'âge de quatre-vingt- douze ans, donna le bon à tirer de son dernier livre, Ultima verba. Il s'éteignit peu après.
C'était un éminent économiste, comme ils le sont tous, et un brave homme. Dans ce livre, qu'en raison de ces circonstances particulières j'eus la curiosité de parcourir, l'auteur fixe deux stades à l'évolution économique des sociétés humaines: aux époques primitives, la période du vol, puis la période de l'échange aux époques que le progrès a marquées de ses bienfaits. Il constatait avec satisfaction que nos sociétés occidentales avaient atteint la période de l'échange. Hélas! Si ce digne homme revenait au monde, force lui serait de constater un singulier cas de régression, et le retour au stade primitif. Il en résulte des scènes dans le genre de celle-ci: dans une boulangerie-pâtisserie, le patron, la figure épanouie en présence des clients qui encombrent sa boutique, s'écrie (l'imprudent!):
— Si ça continue seulement un an, j'aurai fait fortune.
Sur quoi un bon type de fantassin belge, achevant de se bourrer de gâteaux, lui dit froidement:
— Puisque vous êtes si riche, vous pouvez bien me faire cadeau de ce que je viens de manger.
Et sans attendre la réponse, il sort paisiblement, tandis que le patron, bouche bée, « encaisse » sans protester. Les rieurs n'étaient pas de son côté.
Il faut convenir, en toute justice, qu'entre les mains des combattants, l'argent, dès qu'ils en sont lestés, perd sa valeur. Pour obtenir l'objet dont ils ont besoin, ou simplement envie, ils donnent n'importe quelle somme. L'incertitude du lendemain les incite à jouir du présent; au souvenir des durs moments où ils subirent toutes les privations, ils ne veulent se priver de rien lorsque l'occasion leur en est fournie. Suivant le précepte du bon Horace, ils saisissent l'heure.
Ainsi, au son du clairon qui règle la vie depuis le réveil jusqu'à l'extinction des feux pour les militaires comme pour les civils, sous la portée des canons allemands et sous le regard peu bienveillant des taubes, une vie nouvelle s'organisa dans les cantonnements de Flandre, soit au bord de la mer, soit dans les campagnes, en ces lieux jadis habitués au retour régulier des saisons, des étrangers, et des harengs.
de l'Animation, de la Variété
Malgré les efforts, d'ailleurs peu convaincus, des corvées de travailleurs, le service de la voirie laisse souvent à désirer: comment en serait-il autrement avec un mouvement aussi intensif? Les réfections répétées n'y peuvent rien. Tantôt la boue, tantôt la poussière et le sable, régnent en maîtres. Les chemins de briques se défoncent, et les jolis sentiers qui serpentaient entre les villas s'élargissent démesurément. Les clôtures ont servi à faire du feu. Le sable, piétiné, entremêlé de détritus, est sale; le flot ne lui rend pas à chaque marée sa pureté première et la virginité de ses ors comme au sable de la grève. Dans tous les coins on improvise des hangars, des écuries. Pendant les chaleurs, en dépit des désinfectants, des milliers de mouches naissent sur le fumier, et parmi les tas de vieilles boîtes de conserves qui s'accumulent. Le casino, nullement monumental à vrai dire, abrite un corps de garde et un marchand de pommes de terre frites chez lequel opère un coiffeur. Le luxueux cinéma, inauguré deux mois avant la guerre, a fourni les locaux d'un établissement de bains modèle où les hommes entrent par fournées, pour en sortir avec du linge neuf et leurs vêlements désinfectés. Quant aux grands hôtels, on en aménagea plusieurs en ambulances.
L'animation naissait à Pâques pour mourir à la Toussaint; elle dure, maintenant, d'un bout de l'année à l'autre. Soldats belges de toutes armes, turcos, zouaves, tirailleurs, fusiliers-marins, sveltes sous le pompon rouge, territoriaux moyenâgeux sous le casque bleu, postiers, officiers de troupe ou d'état-major, leur foule se presse aux magasins, assaille les marchands de journaux. Les autos ronflent, les motocyclettes pétaradent, les lourds camions dansent aux ressauts des pavés, les autos-canons foncent comme des bolides; des cyclistes se faufilent audacieusement dans cette bagarre; avant de s'y élancer, les piétons agiraient sagement en faisant leur testament, comme s'il s'agissait de traverser le carrefour Montmartre. On ouvre de grands yeux à voir en pleine agglomération un camion virer à toute allure à un tournant, et sur ce camion une pièce de 110 entraînée comme un joujou.
Clairons en tête, des compagnies d'infanterie défilent, des escadrons de cavalerie aux trompettes vibrantes, des pelotons de cyclistes, des batteries d'artillerie avec leurs convois de caissons, de fourgons, et d'innombrables camions de matériel, de fourrage, d'ambulances. Dans ce tapage, une musique impressionnante signale l'auto de l'attaché militaire russe. Des carrioles préhistoriques, attelées d'invraisemblables haridelles dédaignées par la réquisition, conduisent ici, des cantonnements voisins moins bien achalandés, les militaires venus au ravitaillement personnel; en procession hétéroclite, elles ramènent à la tombée du jour les commerçants retour de Dunkerque, où ils renouvelèrent leurs stocks de marchandises. Alourdies par de pleins chargements, elles s'équHibrent mal sous des piles de caisses, de sacs gonflés, sous des montagnes de légumes, le tout sommé de la marchande ou de son homme, brinqueballant aux cahots de la route. Contre un pavé malencontreux, contre un rail dénivelé, elles butent et versent; leur contenu s'éparpille sur la chaussée. Une immense flamme me signala un jour l'agonie d'un autobus parisien, qui s'en vint mourir en Flandre: le feu prit à des bidons d'essence qu'il transportait, et comme il était plein de caisses de cartouches, on imagine la jolie pétarade qui s'ensuivit. Rejetée dédaigneusement hors de la route, sa lamentable carcasse, noircie et tordue, acheva lentement de se désagréger après qu'on en eut tiré tout ce qui pouvait encore être utilisé.
Sur la plage, le mouvement n'est pas moindre: les compagnies s'y exercent le matin, tandis que s'échouent les petits chalutiers qui reviennent de leur pêche à la crevette le long du bord. L'après-midi, des parties de foot-ball ou de paume s'organisent, et sur la digue de mer les musiques militaires exécutent « les plus brillants morceaux de leur répertoire. » Lorsque la température le permet, les hommes se dévêtent par bataillons entiers et se précipitent en courant dans la mer, criant, riant, barbotant, large touche de couleur rose, — la chair jeune, bien portante et bien nourrie, — parmi la blancheur écumanle des brisants.
Des artistes improvisés préparent la prochaine séance musicale ou dramatique; d'autres cisèlent des bagues dans l'aluminium des obus boches ou le bronze des cloches brisées; avec une matière première strictement guerrière, ils fabriquent les bibelots les plus ingénieux. Des peintres de bonne volonté, et quelquefois de talent, ornent les murs des habitations, décorent les salles des ambulances et des hôpitaux, et charbonnent l'intérieur des corps de garde: quels graffiti suggestifs pour les archéologues de l'avenir!
Ah, certes, les distractions ne manquent pas! Voici les navires de guerre qui s'embossent en rade et canonnent l'ennemi. Les plaisanteries des hommes qui chargent l'obus de souhaiter le « bonjour aux Boches » partent en même temps que le coup de canon, cependant que les commerçants voisins de la mer collent en croix de Saint-André de longues bandes de papier sur les glaces de leur devanture, pour les empêcher d'éclater. Du haut des dunes, on passe facilement des heures à regarder s'élever les hautes colonnes de fumée noire qui marquent les points de chute des marmites dans la campagne du Veurnambacht, et l'on écoute le sifflement de celles qui prennent la direction de la malheureuse ville de Furnes.
Que le vent cesse de souffler ou la pluie de tomber, le vol de nos avions anime le ciel, et l'on éprouve des piqûres à l'épigastre lorsqu'ils survolent les lignes ennemies, poursuivis par les éclatements serrés des gros shrapnells noirs qui les encadrent dangereusement. A une hauteur prodigieuse, gros comme des mouches dans le ciel bleu, procédant par surprise, dissimulés derrière des ponards, ou profitant de la lumière blafarde des clairs de lune qui leur permet de voir sans être vus, les aéros boches nous menacent. Le tintamarre des artilleries spéciales entre en branle. Une pièce anglaise a toujours l'air de sonner midi sur un vieux chaudron. La sirène avertisseuse hurle, et, quand on y pense, on hisse au haut d'un mât de pavillon un double panier à figues peint en rouge. Nous assistons à des poursuites émouvantes. Souvent les bandits font demi-tour, pas toujours aussi tôt qu'on l'aurait souhaité. Ils laissent tomber des bombes au petit bonheur. Une fatalité veut qu'ils atteignent le plus souvent des enfants jouant sur la chaussée, ou des femmes vaquant à leur ménage. Mlle Vanhée, qui s'était infatigablement dévouée depuis le début de la campagne, fut littéralement coupée en deux pendant qu'elle distribuait des vêtements à des réfugiés. Un soldat qui pendant cinq mois servit une mitrailleuse en un poste dangereux et ne reçut pas une égratignure, fut tué net le premier jour où il vint au repos: adossé à la fenêtre d'un cabaret, il reçut un éclat dans la nuque, et tomba sur sa tasse de café, foudroyé. Deux frères causaient debout près d'une auto; une bombe éclate; l'un des deux voit l'autre qui chancelle, et cherche à le retenir: il s'aperçoit qu'il retenait un corps sans tête. C'est à Dunkerque que l'on eut un jour cette vision dantesque: un cycliste décapité qui continuait à rouler sur sa machine.
Le paisible Coin des Dunes, sur lequel les aéros boches liquidaient dédaigneusement le solde des bombes qu'ils n'avaient pas jetées à Dunkerque ou sur l'arrière, eut l'honneur d'une attaque par avions. Je me rappelle cet épisode d'un dressage de faucons par mon ami Alfred Belvallette, qui a conservé la tradition de ce sport passionnant: un pigeon se cacha si bien dans un buisson épineux lorsqu'il sentit la menace de l'oiseau de proie, qu'il fut impossible de l'en tirer, et même de le découvrir. Désormais, je comprends à merveille les sentiments de ce pigeon. Il y eut un grand trou au bout du jardin, des carreaux cassés chez le voisin de gauche, des tuiles démanchées chez le voisin de droite, et la cheminée de la cuisine fut ramonée à fond. Un peu plus loin, des portes traversées, et plusieurs trous dans les dunes d'en face. Un malbeureux soldat s'était enfui loin des habitations, pensant se mettre en sûreté: il semble que huit fois sur dix, lorsqu'on se sauve, on se jette au-devant du péril. On le retrouva sept jours plus tard. Il avait eu les deux jambes coupées, si net, que les artères s'étaient rétractées et avaient arrêté l'hémorragie; les médecins certifièrent qu'il vécut encore quarante-huit heures après avoir été touché.
Les Dunes et les Taillis
En temps de paix, les dunes étaient chasse gardée. Depuis la guerre, cavaliers, fantassins et braconniers les ont envahies. On y creusa des tranchées, les unes pour apprendre à se garer des balles, les autres, nullement géométriques, dans le seul but d'éven-trer les terriers de lapins poursuivis jusqu'en leurs ultimes repaires. Le manteau de velours des mousses et des lichens fut déchiré lambeau par lambeau, les oyats arrachés, le sable piétiné: on ne verra plus, la saison prochaine, les hampes des onagres aux fleurs jaunes ni des digitales mauves, toute cette flore délicate et variée, aux teintes fines, aux dessins menus. Il sera trop tard, lorsque les gendarmes en interdisent à nouveau l'accès. Quelques-unes, fixées par la végétation depuis un demi-siècle, recommencent leur marche lente, et les grains de sable volent en tourbillons dès que le vent souffle.
Dans les «pannes», dans les creux abrités, le long de la drève du Duinhoek que prolongeait jusqu'à la frontière française un sentier sinueux et romantique, des boqueteaux charmants avaient grandi, d'où émergeaient quelques beaux arbres. Aux premiers signes du printemps, violettes, coucous et primevères en tapissaient le sol. Des centaines d'oiseaux les peuplaient, et seuls troublaient la solitude et le silence que l'on y goûtait. Il faisait bon égarer là sa rêverie. Des éclaircies s'ouvraient sur de gras pâturages, où des rangées de saules argentés bordaient les watergangs et les prairies. On y respirait les senteurs embaumées des plantes dans une atmosphère reposante.
En dépit des coupes, qui déjà les éclair-ciient pour fournir aux tranchées fascines, clayonnages et gabions, ces taillis demeuraient verts au printemps dernier: au printemps prochain il n'en restera rien. Des corvées de travailleurs les fauchent impitoyablement au ras du sol, et la prochaine poussée de l'aquilon déracinera l'arbre solitaire qui s'érige encore. Le long des watergangs et des prairies, les saules n'offrent au regard que des têtards chauves, grotesques le jour, fantastiques sous la féerie du clair de lune. Perchées sur les sommets, des huttes de guetteurs déforment la souple ondulation de la dune. Dans les prairies, nul bétail ne paît l'herbe vigoureuse et verte: elle a disparu sous une boue argileuse et visqueuse.
Du joli Coin des Dunes toute la parure s'en est allée.
l'Au-Revoir
Remue-ménage, astiquages, nettoyages, graissages, revues d'armes, de détail, inspection sur inspection. Aux carrefours, le vent chasse les trombes d'une fumée acre: la paille de couchage entassée brûle en une magnitique flambée; des cartouches oubliées s'échauffent au contact des flammes, et claquent comme des coups de fouet. La flamme baisse, s'éteint; un peu de fumée s'exhale encore du résidu noir des cendres qui souillent le sable un peu plus, tandis que des vols de fumeroles s'éparpillent dans l'air.
Soldats et officiers se pressent, procèdent aux ultimes achats. Des ordonnances emportent sur leurs épaules les cantines de leurs patrons, et les chargent sur la voiture à bagages stationnée au lieu de rassemblement du bataillon.
L'heure approche du départ pour la tranchée. L'au-revoir s'empreint d'une gravité affectueuse. Lorsque le mouvement de la relève ramène au repos les mêmes corps de troupes, qui de nous n'a remarqué que certaines chambres reçoivent des occupants nouveaux? D'aucuns restèrent là-bas, qui ne reviendront plus.
L'on n'est jamais sûr de revoir ceux qui partent.
Cependant ils s'en vont confiants et gais. Les rangs se forment; les caporaux font l'appel; des commandements retentissent. La musique du régiment martèle allègrement le pas, aux accents de la marche fameuse de Tipperary, et d'un extraordinaire pot-pourri où s'amalgament les fragments les plus caractéristiques des airs nationaux de tous les pays alliés.
La colonne s'éloigne sur la grand'route, allongeant son corps articulé en compagnies et en sections, et qui progresse au balancement régulier des fusils sur les épaules des hommes. Des voitures chargées d'un invraisemblable barda, des cuisines roulantes, suivent, cahin-caha. Les derniers éléments diminuent à vue d'oeil, puis disparaissent au premier tournant. Les notes stridentes et cuivrées des clairons s'assourdissent, et s'éteignent dans le lointain.
A bientôt, amis, et bonne chance!
Chapitre III : La Promenade du Roi
La route se partage ainsi: une piste pour les cavaliers, une chaussée pavée pour les voitures, urune ligne de rails pour le petit tramway qu'un unique cheval tire sans se presser, et un trottoir cyclable... pour les cyclistes. De loin en loin, un gendarme en faction veille à ce que les cavaliers n'empiètent pas sur le trottoir cyclable, ni les autos sur la voie du tramway, ni les charrettes sur la piste cavalière. Or, c'est un phénomène bien connu que rien n'est têtu comme le conducteumr d'un véhicule quelconque, qui a déridé une fois pour toutes de ne pas se conformer aux règlements du roulage. Le gendarme a fort à faire. Il n'empêche pas, il n'empêchera jamais les collisions. Le voulût-il fermement, qu'il risquerait de grossir d'une unité le chiffre des victimes du devoir. Aussi, de temps à autre, un motocycliste s'égare dans le poitrail d'un cheval, un camion automobile fonce sur un chariot de fourrage et le culbute, et une limousine donne allègrement sur un arbre qu'elle écorche, ploie, et brise.
Et les piétons? demanderez-vous. Les piétons ont obéi à l'instinct de conservation. Ils ne se risquent pas dans cette bagarre. Mais comme la route leur est imposée, — itinéraire le plus direct, précisent les sauf-conduits, — ils ont sagement pris la tangente. C'est-à-dire qu'en bordure de la route, entre les arbres du petit bois qui l'encadre de chaque côté, ils ont peu à peu tracé une piste sans le moindre souci des méthodes qui font l'orgueil du corps des ponts-et-chaussées, sinueuse comme un sentier de nègres dans la brousse, élargie à l'usage, et qui, en somme, a fini par devenir une voie de communication très supportable. Il est seulement à regretter que les corvées de cantonniers s'obstinent à l'encombrer des gravats, des pavés, du sable avec quoi ils mettent des pièces à la route dès que le besoin s'en fait sentir, ou bien la creusent de précipices afin d'assurer l'écoulement des eaux. Telle quelle, les piétons s'en contentent, mus par ce sentiment philosophique qui veut que quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a.
Nous sommes à l’arrière-saison. Une à une, les feuilles se détachent des arbres, larges paillettes d'or fauve qui tombent lentement, et tournoient avec mélancolie dans les rayons d'or du soleil automnal, avant de se poser doucement sur le sol. Le long du sentier tracé par les piétons pour sauvegarder leur existence, deux officiers belges s'avancent, en apparence indifférents au va-et-vient de la route. L'un d'eux a belle prestance et haute taille. On reconnaît le roi.
Les hommes qui le croisent s'arrêtent, et font face pour le saluer. Un cycliste, qui accourait à fond de train, descend en voltige par la pédale avant que sa machine soit suffisamment ralentie, et manque être emporté par son élan en touchant terre; ses semelles claquent sur le dallage; il a juste le temps de reprendre son équilibre pour se figer dans la position réglementaire, au moment où le roi arrive à sa hauteur. A petits pas, deux gendarmes faisaient leur ronde, l'arme à la bretelle, en échangeant de rares paroles... Vous vous rappelez la chanson de Jouy:
Quand les gendarmes vont deux par deux, C'qu'ils s'dis'nt entre eux, ça n'vous r'gard' pas.
Eux aussi, quoique avec une lenteur plus circonspecte, reconnaissent le roi. Sans se départir de ce flegme et de cette solennelle allure qui donne tout son poids à la moindre de leurs attitudes, ils font face comme un seul homme, et saluent longuement.
Le roi répond à tous, le geste empreint de bienveillance, parmi l'affectueux respect qui l'entoure. Et je ne pouvais m'empêcher de songer que pour assurer sa sécurité, — y pense-t-il, d'ailleurs? — le roi Albert n'a pas besoin de doubler sa casquette avec une calotte en acier chromé, ni sa tunique avec une cotte de mailles à l'épreuve des 420, à l'instar de certain monarque balkanique guère plus rassuré à l'endroit de ses propres sujets que de l'ennemi. Il s'est forgé une cuirasse morale plus impénétrable et plus sûre. Nulle traîtrise n'en saurait découvrir le défaut, car elle est d'une seule venue et ne connaît pas de point faible.
Je le regarde s'éloigner. Il s'en va, devisant avec l'officier qui l'accompagne. Cette promenade offre la douceur d'une détente parmi les soucis de l'heure. Y a-t-il dans toute l'histoire l'exemple d'un pouvoir exercé en de pareilles conditions? Y a-t-il au monde, y eut-il jamais pour un souverain de surnom plus glorieux que celui-ci: Roi de l'Yser?
Car la comparaison s'impose: en regard des tergiversations, des marchandages dont l'échelle monte ou descend suivant les fluctuations du sort des batailles, en regard des misérables calculs d'intérêts dictés par la pour de la force et se totalisant en une trahison basse, ici, une décision immédiate, franche, nette, insoucieuse des risques, basée sur cette unique critérium: la loyauté envers la parole donnée.
Le roi et son gouvernement ont fait le geste. Ils n'ont pas attendu, pour « marcher », de s'assurer qu'ils marchaient avec le plus fort, avec le vainqueur de demain. La nation les a suivis. Là gît le point, comme disent les Anglais. C'est cela que le monde civilisé ne doit pas oublier, c'est cela qu'il n'oubliera pas. C'est ce geste qui eût dû d'emblée grouper en un infrangible faisceau tous les tenants non seulement de l'honneur et du droit, mais même de la simple honnêteté.
Souvent je le rencontre ainsi, le roi Albert; en compagnie d'un seul officier, il s'en va, méditant et devisant, par les routes et les sentiers de ce dernier coin inviolé de son royaume. Il vit au milieu de ses soldats; il vit au milieu de son peuple. Et chaque fois que je le rencontre, je m'imprègne de celte vue les yeux et la mémoire, en songeant à ce que cet homme représente parmi les autres hommes.
…
Chapitre IV : Le Retour des Navires de Guerre
Ils Manoeuvrent et Font Feu
Depuis longtemps, la mer restait déserte et l'horizon vide. Le jour, quelques barques péchaient la crevette entre les bancs de Flandre; il y a danger à s'éloigner du rivage, et l'on ne peut pêcher la nuit; ce n'est que par chance que le chalut ramène une paire de soles, ou quelques échantillons prélevés parmi les migrateurs qui s'égarent de ce côté, maquereaux, harengs, merluches, pendant une quinzaine de jours. Les quelques chalutiers à vapeur que l'on aperçoit au large se livrent à une tout autre besogne. Des formes grises patrouillent, torpilleurs et destroyers, tantôt immobiles pendant des heures et pareils à quelque dos de cétacé dormant en surface, tantôt filant à toute vapeur et traçant un double sillage de fumée noire dans le ciel, et d'écume blanche sur les flots.
Et voici qu'ils ressurgissent de l'horizon lointain, les cuirassés, les grands croiseurs, les monitors trapus, et leur suite nombreuse de petits bâtiments rapides, destroyers et torpilleurs, chiens de garde et chiens de chasse, et ces chalutiers d'apparence pacifique qui se sont révélés d'excellents guerriers. L'histoire est célèbre, désormais, de ce chalutier boulonnais qui, avec vingt hommes d'équipage, prit à l'abordage une goëlette turque de quarante-huit hommes. La tradition des ancêtres qui s'illustrèrent dans la guerre de course n'est pas perdue.
Le coup de vent des équinoxes passé, une période de calme lui succède, le « temps de harengs » disent les matelots, où la mer et le ciel sont d'argent. Matin et soir, le rideau de gaze blanche des brumes automnales voile la scène; le soleil n'a pas toujours la force de le tirer, de le rouler en paquets de nuages qui s'élèvent et que la brise balaie. Lorsqu'il demeure, l'éclair des coups de canon le déchire: une longue flamme, une formidable toux qui souffle brusquement, une grosse bouffée de fumée noire, se résolvant en une barre droite de la longueur de l'âme du canon, ou en un de ces ronds incertains et mobiles, orgueil des fumeurs de pipe.
La déflagration ébranle les vitres des villas, les glaces de la devanture des magasins, et la marchande gémit de la dégringolade des bibelots en montre. Puis, vrrr, vrrr, vrrr, avec une sorte d'ahan rythmé, on entend l'obus qui file en ronflant, et s'en va, disent les hommes, porter le bonjour aux voisins d'en face. Il est piquant de constater que c'est lui qui fournit l'expéditeur: un certain nombre des monitors en action de notre côté tirent avec des pièces allemandes de 380, provenant des forts de Kiao-Tchéou. Les philosophes appellent cela: un juste retour des choses d'ici- bas.
Combien la manœuvre est curieuse à observer! Un navire à passagers, un paquebot, donne l'impression d'une machine; il va, d'une allure égale, régulièrement et uniformément d'un même point à un même autre point. Le navire de guerre, au contraire, indique une entité pensant et agissant par soi-même, un être mu par une volonté indépendante. Il procède avec les allures précautionneuses des félins, ou se rue avec la furie du sanglier. Mais la force de ce monstre obéit à une discipline, et en escadre, l'action individuelle se soumet de toute évidence à une volonté dirigeante unique; cela se « lit » sur la mer où ces bâtiments évoluent. L'impression de puissance que produisent leur masse et le tonnerre de leurs canons au long cou s'en accroît.
La Riposte et Ce Qui s'Ensuit
Depuis un bon moment, avec méthode et conviction, cuirassés et monitors tapent sur un certain nombre de points choisis le long de la côte belge, de Westende à Ostende, et même plus loin, là où nos hydravions ont signalé des canons et des obusiers boches tapis dans des cachettes, dissimulés avec une habileté, avec un art parfait, peut-on dire, puisque la peinture s'en mêle.
Un coup, deux coups sourds et lointains: l'ennemi juge qu'il a suffisamment encaissé sans riposter. Vzuîîî, font ses projectiles en un crescendo soutenu et de plus en plus proche; vlouc! une haute gerbe blanche jaillit de la surface de la mer, ou deux, ou trois, ou quatre à la fois, qui encadrent le but.
D'un camp à l'autre, les coups se répondent avec régularité. Cette action prend la tournure d'une partie de balle, engagée à une vingtaine de kilomètres de distance. Lorsque les joueurs estiment qu'elle a suffisamment duré, le gros œil rond qui s'est détaché de l'escadre réintègre son orbite. Les canons se taisent de part et d'autre. Des panaches jaillissent au sommet des cheminées des navires, et déroulent au gré de la brise leurs lourdes volutes. Le troupeau des monstres marins fait demi-tour par principes. Les masses grises s'éloignent, s'évanouissent derrière le rideau des brunies blanches ou roses qui voile la ligne d'horizon, laissant traîner après leur passage un double sillage de fumée noire dans le ciel et d'écume blanche sur la mer.
Quelques jours plus tard, les gazettes hollandaises nous apprennent que ce jour-là on entendit de l'Ecluse une violente explosion, que l'on a vu dans cette direction de hautes ilammes et un gros nuage de fumée, qu'un train de blessés a été dirigé sur Bruges, et qu'un pont ayant été démoli par le tir des monitors, on oublia de faire jouer les signaux d'arrêt: grâce à quoi une rame de « vicinal » transportant deux cents soldats allemands piqua une tête dans le canal.
Chapitre V : Le Navire Naufragé
La Tempête
Depuis quinze jours, la tempête ne cesse de souffler. Tantôt du nord-ouest, tantôt du sud-ouest, — le noroît et le suroît des gens de mer, — toujours avec la même violence, le vent soulève les flots de la mer et courbe les arbres de la plaine. Il accumule au ciel de gros nuages noirs, qui, dix fois le jour, se déversent en une cataracte de fleuve. La terre des champs se dilue; sur les prairies, sur les labours, s'étendent de larges nappes d'eau que le sous-sol ne parvient pas à absorber, et qui demeurent.
Par ce temps de grenouilles, quel spectacle que celui des colonnes de troupes venant au repos après le stage réglementaire dans les tranchées! Les hommes sont casqués d'acier chromé et cuirassés de boue. Kaki ou bleu-horizon, les tenues présentent une teinte terreuse qu'aucune teinture, jamais, ne rendit aussi uniformes. Et cependant, les hommes marchent d'une allure franche, fièrement redressés à l'entrée au cantonnement, sous le poids du sac et d'un équipement de plus en plus complexe. Leurs mouvements souples et forts, la mine aguerrie, ils apparaissent vraiment beaux, d'une beauté mâle et vigoureuse qui évoque invinciblement le souvenir des silhouettes inoubliables qu'a tracées le crayon des Gallot. Si ces artistes revenaient au monde, ils retrouveraient ici leurs modèles.
En temps de paix, alors qu'un intense mouvement de navigation sillonne la mer du Nord, il n'est pas rare qu'à cette époque de l'année où les tempêtes sévissent, des navires s'échouent sur les bancs de sable, dont la traîtrise rend si dangereux les parages de la mer flamande, et soient jetés à la côte. La carcasse abandonnée se disloque peu à peu, se désagrège sous l'action des eaux et de la vermine de mer. L'été suivant, on découvre, enlisées dans le sable de l'estran, les poutres qui s'en détachèrent et que recouvrent les algues marines et les colonies de crustacés et de mollusques.
Le Navire en Détresse
Combien de fois, dans mon enfance, n'ai-je pas assisté à ce drame: le navire, l'arrière enfoncé, l'avant hors de l'eau et le beaupré pointant presque vertical, les mâts couchés; le navire talonne aux coups du ressac; des formes s'agrippent aux cordages, aux mâts, car la coque n'est plus tenable, des formes qui sont des hommes, à peine visibles dans la pluie et les embruns que fouette le vent. Gela dure des heures, parfois plusieurs jours, sous les yeux des riverains impuissants. Des sauveteurs accomplissent des miracles de courage et de dévouement. Mais les coups du ressac se font plus violents, et la secousse détache comme un fruit mûr un homme à bout de forces, qu'une vague engloutit aussitôt, tandis qu'à terre les femmes se signent.
Or, l'autre matin, lorsque l'obscurité de la nuit se fut dissipée et que le vent eut nettoyé l'horizon des brumes qui le dissimulaient, on aperçut du rivage un grand navire en détresse sur le Traapegeer, le long banc de sable où écument les brisants de la mer démontée. Il avait été surpris en rade, ou avait manqué l'entrée du port. Sa sirène hurlait sa détresse. Le vent soufflait de l'ouest: il porta ce lugubre gémissement aux oreilles des Allemands, et bientôt de leurs lignes on vit s'avancer trois hydravions qui fondirent comme des faucons sur leur proie. Planant en spirales, hors de portée de nos canons spéciaux qui tonnaient en vain, ils descendirent à bonne hauteur, et jetèrent cinq bombes. L'eau jaillit autour du cargo, qui, par bonheur, demeura indemne.
À leur tour, nos avions étaient sortis et avaient pris de la hauteur. Ils tentèrent de couper de deux côtés la retraite à leurs adversaires, qui s'empressèrent de fuir en tirant chacun de son côté.
Des torpilleurs accouraient pour porter secours au naufragé et commencer les opérations du renflouement. L'atmosphère s'éclair-cissait. Dès que les observateurs des batteries allemandes les aperçurent, les obus commencèrent à arriver. Après avoir jeté quelque peu de poudre aux mouettes, l'ennemi cessa le feu.
Le renflouement se poursuivait avec difficulté. L'état de la mer ne le facilitait pas. On devait attendre le moment du plein de la marée pour travailler avec quelque chance de succès. La nuit vint. Curieux de savoir ce qui se passait, les Allemands lancèrent un certain nombre de bombes éclairantes, mais sans tirer le canon.
Le Renflouement
Le lendemain, le cargo se trouvait toujours au même endroit. Il avait exécuté un tête- à-queue, seul résultat jusqu'ici des efforts tentés pour le déséchouer. Un calme survint. Le troisième jour, il avait encore changé de position, mais gisait à sa même place. Cependant, du rivage on constatait que sa coque s'élevait plus haut que la veille au-dessus du niveau de l'eau. Dans la nuit, on l'avait délesté par transbordement d'une partie de sa cargaison.
De temps à autre, un avion allemand essayait encore de l'approcher pour le mitrailler ou le bombarder, mais les nôtres montaient bonne garde. Ils prenaient vivement en chasse l'agresseur, qui faisait demi-tour et en hâte regagnait ses lignes. L'un d'eux n'eut pas de chance: mitraillé de près par un aviateur anglais, il prit feu et s'abîma dans les flots.
Le quatrième jour, on commençait à se demander si le navire naufragé parviendrait à se tirer d'une situation que chaque marée empirait visiblement. Il talonnait fortement sur le banc de sable; sous la violence de ces chocs répétés, ses membrures devaient souffrir; combien de temps résisteraient-elles sans se disjoindre?
Le cinquième jour, au matin, je n'entends plus le long gémissement de la sirène dans le vent qui s'est remis à souffler en tempête. Le drame s'est-il dénoué? Le cargo fut-il complètement abandonné? Je vais jusqu'à la digue de mer. Sur l'horizon déblayé, le regard n'aperçoit plus rien, rien qu'au loin sur les flots le dos bombé d'un cétacé qui semble dormir à fleur d'eau, quelque navire de la défense de Dunkerque qui monte sa garde.
Le cargo a disparu. On l'a renfloué et définitivement sauvé au cours de la nuit.
Chapitre VI : Un Séjour Enchanteur
De la Pluie et du Vent
Un vieux fermier flamand me dit: — Depuis que je suis au monde, il n'est jamais tombé tant d'eau sur le pays.
Pareille affirmation ne m'étonne guère. Le ciel doit contenir d'inépuisables réservoirs, pour fournir à un pareil déluge. Depuis quatre mois, il pleut. A peine, à de rares intervalles, une demi-journée d'entr'acte. Nous voici familiarisés désormais avec toutes les variétés de pluie: l'averse soudaine et violente qui se déverse en trombe, en cataracte fouettée par le vent, en flèches obliques si drues qu'elles obscurcissent la vue à vingt mètres, comme un rideau tendu; la pluie implacable, lente et monotone, qui tombe avec régularité, sans arrêt, lamentablement pendant des jours et des nuits; la pluie fine et pénétrante, la bruine dense qui se forme en gouttelettes aux ramilles des arbres, aux branchettes des haies d'épines; elle se pose en buée sur les vêtements de laine; elle semble inoffensive, mais on ne tarde pas à s'apercevoir qu'elle détrempe, et transperce. Elle abat le grand vent qui chassait devant lui les trombes d'eau. Après un bref répit, le vent reprend haleine, recommence à souffler, et la disperse comme une bouffée de fumée.
Ce que le sol de la Flandre maritime, la terre lourde des polders au sous-sol d'argile, est devenu dans ces conditions, dépasse l'imagination. A l'eau du ciel s'ajoute celle emmagasinée par les dunes pendant l'été, et qui s'écoule souterrainement vers l'intérieur du pays dès qu'arrive octobre. Les canaux se gonflent à crever. Les watergangs qui se perdent au milieu des champs, les fossés le long des routes, débordent.
L'eau vivifie étonnamment les mousses: elles s'étalent sur les dunes en larges lambeaux de peluche voyante. D'autres, plus sombres et plus veloutées, habillent l'écorce des arbres, les chaumes des toits et les tuiles dont elles éteignent le rouge chantant, les pans de murs et les façades exposées à l'Ouest.
L'aspect général des choses apparaît uniformément couleur de terre, sous le ciel bas et gris, où roulent de gros nuages sombres, ton sur ton.
Un Océan de Boue
En ces jours pluvieux, j'ai circulé maintes heures le long du front belge. L'an dernier, je m'étais imaginé voir sur cette plaine le maximum de boue qu'il fût possible de concevoir: j'étais loin de compte!
Des prairies entières, qui alors supportaient le bétail paissant les herbages, disparaissent aujourd'hui entièrement sous l'eau: qu'une éclaircie se produise, qu'un rayon non de soleil, mais de lumière, tombe sur la terre, son reflet se prolonge presque sans interruption jusqu'aux limites où porte le regard; il luit, métallique et blanc, sur cette vaste inondation naturelle, sœur de l'autre, celle provoquée par les ingénieurs.
La boue a si complètement envahi les routes, qu'il fallut prescrire des itinéraires d'aller et de retour différents aux voitures qui se tendent d'un point à un autre. La chaussée des artères principales, en dos d'âne et pavée, demeure praticable; les bas-côtés, malgré l'apport de tombereaux de briques pilées et de cailloux concassés, se creusent d'ornières profondes, précipices où s'enlisent les autos qui s'y risquent par mégarde. Quant à s'aventurer sur les chemins vicinaux avec quelque chance d'en sortir, leurs conducteurs savent que pareil exploit leur est totalement interdit.
La consistance de la boue des champs varie selon la nature du terrain: tantôt liquide à n'être plus qu'une eau limoneuse, tantôt gluante, glaiseuse et happant les chaussures comme si elle voulait vous les retirer du pied. Celle des lieux habités s'additionne de détritus, d'eaux de vaisselle et de lessive, amalgame noir et gras où chacun barbotte, et que le passage des autos a projeté en giclements épanouissant leurs mouchetures sur la façade et sur les vitres des maisons. Les Flamandes les plus soucieuses de propreté ont décidément renoncé à la lutte.
Les fermes isolées émergent d'un océan de boue piétinée par les hommes et les chevaux, malaxée par les roues d'innombrables véhicules. On y accède grâce à des passerelles en planches; les gros souliers ferrés enduisent de boue le bois qui devient terriblement glissant, jusqu'à ce quil s'enlise. Après quoi on en superpose de nouveau.
L'été, on découvrait l'amorce des chemins de colonnes parmi les hautes herbes, les avoines ou les blés. Une touche de couleur vive au sommet des petits piquets qui les jalonnent aidait à en reconnaître le tracé. Aujourd'hui la couleur des piquets est effacée; les piquets eux-mêmes pourrissent, s'effritent, disparaissent sous l'action de l'eau. Là, on a de la boue jusqu'au mollet.
L'eau s'infiltre et noie la moindre excavation. Les tranchées édifiées par l'apport de cubes de terre ou de sacs de sable demeurent indemnes d'inondation. Les entonnoirs d'obus, sitôt creusés, s'emplissent jusqu'aux bords d'un liquide jaunâtre. Rongés de rouille, les treillis de fils barbelés qui défendent les abords des innombrables ouvrages dont le sol est hérissé, semblent de loin des filets de pêche passés à la teinte rousse du cachou, et mis à sécher sur des pieux.
Même abstraction faite des marmites boches, le séjour en de pareilles campagnes n'est rien moins qu'enchanteur. L'imagination la plus pauvre conçoit aisément des conditions de confort plus suaves, et les possibilités d'une existence moins marécageuse. La soupe chaude et le « jus » qui fume réchauffent heureusement l'estomac et le moral. Ils sont des bienfaiteurs.
Quelle consolation, aussi, de songer que de l'autre côté, en face, le terrain est en contrebas du nôtre, et qu'on y patauge plus lamentablement dans un bourbier plus gélatineux encore! Quoi d'étonnant qu'à l'égal du terrain le moral y soit vaseux, lui aussi?
Chapitre VII : Un Tour à Paris
Le Voyage d'Aller
Depuis quatorze mois, le front s'est fixé à quelques kilomètres de la maison où je travaillais. C'est un voisinage passionnant, mais qui manque parfois de charmes. Il offre un intérêt certain, un intérêt considérable à qui vend quelque chose, car tout vendeur y est à peu près assuré de faire fortune, toutes proportions gardées, — je n'ai pas dit toute mesure. Il est juste de reconnaître que les marmites et autres bombes y ajoutent quelques risques. Quant au simple civil, les dispositions draconiennes que les autorités compétentes ont lieu de prendre, en font une sorte de prisonnier dans sa commune. Il aurait tort de s'en plaindre: la loi de la nécessité le veut, et sa propre sûreté en dépend. Il s'en faut que cette vérité élémentaire soit universellement comprise. Et il est exact que le sens social de chacun se mesure à la bonne volonté avec laquelle il exhibe au gendarme son sauf-conduit.
Donc, après quatorze mois de ce régime, personne ne s'étonnera que l'arrière m'apparût aussi mystérieux que la zone de l'avant aux gens de l'arrière. J'essayais bien de me le représenter d'après le tableau qu'en dressaient les journaux, et dont je me persuadais que les traits devaient être exacts. Mais dès que je tentais de me les faire confirmer par quelque permissionnaire à son retour, le doute s'emparait de mon âme: suivant le tempérament de chacun, suivant le développement de ses facultés d'observation, suivant sa connaissance antérieure de Paris, suivant ses relations, les appréciations différaient au point de friser la contradiction. Les méthodes de la pure critique historique m'interdisaient d'asseoir sur de pareils éléments une conviction raisonnée; et le bon sens était d'accord avec les dites méthodes.
J'eus enfin l'occasion de me former une opinion personnelle.
A la première heure matinale, dans le brouillard glacial qui prolonge l'obscurité de la nuit, après maintes et maintes formalités, après l'établissement, l'examen et le visa de multiples papiers avec ou sans photo du titulaire, me voici dans le train. De rares civils se perdent dans la foule des militaires en route pour goûter les joies de la permission réglementaire. Des hommes appartenant à une même unité se retrouvent, s'exclament joyeusement, tempêtent, s'interpellent. Les malins content comment ils ont « carotté pour attraper ce train-là », qui leur fait gagner une heure, qui leur permet d'at-trapper la correspondance, qui finit par leur valoir une demi- journée de rabiot... le tout sous condition que « ce train-là » n'ait pas de retard. Le cas se présente rarement, il faut bien l'avouer.
On se case dans les compartiments. Sur les quais, allées et venues, galopades de retardataires. Affolé, un militaire au cerveau insuffisamment administratif n'a pas fait établir ses pièces en règle; il se précipite, rebondit de porte en porte et d'employé en employé; il manquera le départ, sous l'œil narquois du conducteur du train. Des gendarmes français, des gendarmes belges, des M. P. (member police, et non, member parliament) observent avec une attention d'autant plus soutenue qu'ils ne savent pas quand, ni par qui, eux-mêmes peuvent être surveillés, le cas échéant. Des employés de la Compagnie du Nord aux brassards crasseux et fripés s'exténuent a donner des renseignements et à fermer des portières qui se rouvrent incontinent. Sous le casque, en faction, des territoriaux grisonnants considèrent ce tohu-bohu avec une expression d'incommensurable ennui.
Les coups de sifflet habituels; le train part. Un quart d'heure après, et même moins, les conversations entre poilus ont cessé; tous dorment à poings fermés; le compartiment résonne d'un concert de ronflements dont la sonorité puissante fait concurrence avec avantage à celle des moteurs d'avions.
D'une allure désespérément lente, le convoi progresse entre des champs boueux, détrempés, plaqués de flaques d'eau limoneuse, sous un ciel morne. Des feuilles de betteraves achèvent de pourrir sur place. Partout, l'humidité suinte. Aux petites gares, aux haltes dont on ne rate pas une, des arrêts interminables, d'autant plus exaspérants qu'on n'en saurait découvrir la raison utile. Plantés le long de la voie, de distance en distance, des G. V. C, l'arme au pied, le petit doigt sur la couture du pantalon, regardent passer les trains sans leur accorder la moindre marque d'intérêt.
À la première grande gare, changement de voiture. Du matériel antique, grinçant, cahotant, sentant le vieux culot de pipe et le renfermé, où la Compagnie m'a incarcéré jusqu'ici, je passe dans des wagons à couloir d'une tenue plus moderne. Beaucoup d'animation; l'élément civil plus visible. Des jeunes femmes au brassard à la Croix-Houge, des infirmières, parcourent le train, et quêtent.
Après la plaine, des collines, des arbres défilent; des ruisseaux grossis coulent, comme de petits torrents; de la neige qui fond par endroits s'étale irrégulièrement sur les champs et les prairies, comme du linge que l'on aurait mis à sécher. Des voies de garage, des baraquements militaires, des tentes, des amas de matériel, des camps entiers, donnent une idée de la formidable accumulation de moyens qu'exige cette guerre, qui nous manquaient au début, et qui commencent à abonder.
Dans la brume et dans la boue, des Hindous couleur de terre pansent leurs chevaux au beau milieu d'une rue, dans un petit village de Picardie. Plus loin, le train stoppe auprès d'un vaste moutonnement bleu-horizon: casques et capotes de poilus, mille à douze cents permissionnaires tassés, parqués entre des barrières de bois. Combien de temps une administration prévoyante les laissera-t-elle ainsi, le dos sous la pluie et les pieds dans la boue? Les soldats assis près de moi expriment leur opinion avec amertume, et énergie.
L'ombre succède à la pénombre. La nuit est revenue. Le brouillard s'intensifie; il oppose un écran opaque à l'éclat des lumières. A coups sourds, les roues heurtent les croisements de rails aux plaques tournantes; le train gronde en passant sous des ponts métalliques rapprochés; des arches, des piliers, des colonnes de fonte, les feux rouges et verts des signaux, la vitesse qui ralentit, les longues lignes des quais multipliés, et l'arrêt.
Les wagons se vident comme autant de fourmilières. Des barrages, des barrières, une foule dense derrière les employés qui ramassent les billets, les gendarmes qui examinent les papiers, les sentinelles sur le point de se laisser déborder. Les lampes à arc projettent une lumière crue, froide, coupée d'ombres violentes. La foule: une masse d'ombre avec la tache claire des visages, visages anxieux des femmes qui guettent l'homme qu'elles n'ont pas vu depuis tant et tant de jours pendant lesquels elles n'ont pas cessé de craindre. Le teint animé, les yeux brillants et largement ouverts,les dents blanches dans la bouche qui profère des appels passionnés et vibrants, puis des reconnaissances, des étreintes, quelques bousculades, quelques cris, et une rumeur immense qui emplit le vaste hall de la gare du Nord.
La sortie des voyageurs s'opère suivant une étroite canalisation, qui abolit toute initiative individuelle quant au choix de la direction. Je me trouve rue de Dunkerque sans trop savoir comment j'y suis arrivé. Je découvre avec peine l'entrée du métro, ce qui ne laisse pas de me vexer: jadis, je n'aurais pas hésité. Quelques minutes plus tard, j'émerge de la station de Saint-Germain-des-Prés.
Là, j'éprouve une satisfaction intime à reprendre contact avec mon quartier. Mais pas d'autos, pas de passants, presque pas de lumières. Des abat-jour coiffent les becs de gaz et les lampadaires électriques raréfiés. Les devantures des magasins, baissées, laissent filtrer de minces raies lumineuses. Est-ce bien ce quartier des Beaux-Arts que j'ai laissé si vivant, si frémissant de joie bruyante et de fantaisie bon enfant, si clair des flots de lumière jaillis des boutiques, des cafés, des restaurants? A sept heures du soir, une de ses heures jadis les plus mouvementées, le voici à peu près désert, et noyé d'ombre et de silence...
Je me couche: mon lit me semble étranger. Pas un bruit ne monte de la rue. L'heure tinte à l'horloge du Palais Mazarin. J'ai le brusque souvenir, le souvenir attendrissant, d'une petite ville du Nord où, collégien, je passais chaque année une partie de mes vacances. L'impression est étonnamment pareille. Ainsi je m’endormais, le premier soir, avec la sensation d'un lit étranger, mon sommeil baigné dans le silence provincial, et je frissonnais doucement au tintement de l'heure argentine, que sonnaient des cloches dans la nuit.
Le Retour en Flandre
Le train m'emmène de nouveau vers la plaine de Flandre. Il file à une allure de moins en moins accélérée à travers les paysages mouillés, que la lumière de ce jour de décembre ne contribue pas à égayer. A mes côtés, des permissionnaires regagnent le front. Chacun songe. On revit les heures que l'on vient de passer dans le cadre de la vie d'autrefois, la vie du temps de paix qui semble déjà si loin! On a peine à renouer le fil. Chacun voit nettement que cette formidable aventure l'embarque dans une vie nouvelle, et que des temps nouveaux surgissent. Le ronron monotone de la marche berce cette rêverie; suivant le rythme de la machine, un air s'implante dans le cerveau, un refrain, une obsession qui ne vous lâche plus.
De gare en gare, des agents soupçonneux passent les voyageurs au crible. Les barrages succèdent aux barrages. La Compagnie du Nord me retransborde d'un wagon moderne dans une caisse étroite et sale, puant le vieux culot de pipe et le moisi. La pluie clapote sur le toit, et dégouline le long des vitres. Une lueur blafarde tombe du plafond. Une épaisse fumée emplit le compartiment, où des fourneaux de pipes et des cigares allument à chaque aspiration du fumeur un petit brasier rouge. Dans cette atmosphère d'aquarium, je finis par distinguer deux officiers belges et quatre artilleurs français. Les officiers sont deux vieux qui ont repris du service; on les a affectés à des services de l'arrière; leurs fils sont aux tranchées. Ils en parlent avec un attendrissement relevé d'une pointe de fierté; cela s'entend bien à la petite vibration de leur grosse voix qui sort de leurs grosses moustaches. Trois des artilleurs fument en silence; le quatrième ronfle: ce sont de vieux territoriaux, résignés et flegmatiques.
Une petite gare perdue dans les champs. Le vent, la grande puissance qui courbe les arbres échevelés de la plaine et fait marcher les montagnes de sable, souffle avec force. Il secoue les wagons sur les rails, et siffle aux jointures des portières. Deux ou trois cris d'employés rayent le silence, qui pèse. Les officiers belges descendent. Le train se remet en route, péniblement, luttant contre le vent.
Il semble que le départ des gradés ait délié la langue des artilleurs. Leur stature de colosse et leur accent ne laissent aucun doute sur leur origine septentrionale. Ils parlent. C'est-à-dire que de temps à autre, entre deux silences et trois bouffées de pipe, l'un d'eux laisse tomber une phrase, à laquelle un autre répond après un temps égal, ponctuant ses dires de jets de salive abondants. Le ton demeure égal, quoi que ces hommes disent, leur physionomie immuable. Pas de gestes. Seule, la sputation plus fréquente décèle l'émotion intérieure. L'un énonce:
— En septembre, je ne passais plus par les routes, je prenais toujours à travers champs... J'avais eu deux bœufs tués; il me restait trois vaches... J'ai eu des pommes comme jamais: j'en ai fait pour cent vingt francs... Quand je suis parti, j'ai laissé ma femme et sa mère; il y avait toujours les trois vaches; ma femme vendait le lait, et les œufs.
Un grand silence.
Un autre dit:
— Moi, en neuf mois, j'ai perdu mon frère, ma femme, et mon père...
— Au moins, tu le sais, reprend le premier. Au lieu que moi, je ne sais pas si ma femme est vivante...
Même impassibilité, nouveau silence. Pas une intonation pour se plaindre; pas un geste pour protester. Les interlocuteurs se considèrent d'un regard plus appuyé, et c'est tout. La fatalité les broie: ils s'y soumettent.
Après quoi, exactement sur le même ton, la conversation se met à rouler sur l'intérêt qu'il y a, ou qu'il n'y a pas, à devenir garde-voie, et sur les démarches opportunes. Diverses considérations émises à ce sujet, et les divers points de vue auxquels on peut se placer ayant été dûment envisagés, celui des quatre qui n'avait encore ouvert la bouche que pour ronfler, conclut:
— Dans le métier militaire, il ne faut jamais rien demander.
Un silence unanime comporte un assentiment semblable. La fumée s'épaissit encore dans le compartiment. La chaleur des bouillottes dégage l'odeur de cuir chaud des brodequins mouillés qui s'y appuient.
La pluie ne cesse de clapoter sur le toit et de dégouliner le long des vitres. Le train atteint son terminus.
Je me plonge dans la nuit, la pluie, la boue, le froid.
Chapitre VIII : l'Accoutumance
Les modes de vivre particuliers qu'impose la nécessité semblent naturels, au moment où on les vit. Plus tard seulement, à la réflexion, on aperçoit l'étrangeté de certains gestes.
En cours de route, je me suis arrêté à Dunkerque, chez mes amis T... Leur maison fut démolie, avec deux autres, par un seul obus de 380 qui tomba dans une citerne, et produisit un tremblement de terre en miniature, si tant est que le terme de miniature puisse s'appliquer à un phénomène de cette espèce. Depuis lors, ils campent dans une maison amie.
Dès le seuil, une anomalie: inutile de sonner; la porte d'entrée reste toujours ouverte. Un petit drapeau rouge indique aux passants qu'ils peuvent s'y réfugier en cas de danger subit. La cave est bonne, c'est-à-dire solidement voûtée. Une partie fut aménagée en dortoir: des lits, des tapis, des paravents, l'électricité, et un poêle. Des sacs de sable protègent les soupiraux.
L'habitation comporte deux corps de bâtiments, séparés par un jardin et communiquant par une serre: partout, le mastic des vitres est frais; une bombe tomba au milieu du jardin; elle n'entama ni le figuier vénérable, ni le poirier centenaire qui en font l'ornement le plus comestible, mais elle brisa une incroyable quantité de vitres en une incroyable quantité de petits morceaux. Dans la chambre où je couche, des éclats déchirèrent le plafond de trous noirs, irréguliers, où des plâtras pendent, et qui contrastent avec la netteté et la bonne ordonnance du reste de la pièce. Dès le second jour, je ne les vois plus.
A l'heure du couvre-feu, on ouvre la trappe qui masque l'entrée de l'escalier de la cave; chacun dans sa chambre dispose ses vêtements de manière à les avoir sous la main pour se couvrir vivement en cas d'alerte; on s'assure du bon fonctionnement de sa lampe électrique de poche. Car on ne couche à la cave que pendant les périodes de bombardement. Dès le second soir, ces gestes deviennent habituels. On les accomplit comme tant d'autres, en pensant à autre chose.
Si l'on s'éveille, la nuit, on entend le carillon de la Tour qui tinte les heures, harmonieusement comme au temps de paix, ou le ronflement d'un avion qui veille à la sûreté de tous. Dans le lointain, du côté de la mer, de longs coups de sifflet, de longues plaintes de sirènes déchirent l'air au passage des navires à vapeur. Lorsque hurle le lugubre mugissement de la sirène avertisseuse du danger, chacun exécute la manœuvre prévue; encore faut-il qu'il s'agisse d'autre chose que de la visite d'un taube [: auquel cas on se retourne entre ses draps, et on se rendort.
Et ces habitudes nouvelles se déroulent le plus naturellement du monde; nul ne songe à ce que ces gestes offrent d'anormal, ni ne s'en étonne plus loin que le premier soir.
Chapitre IX : Le Nouveau Danger
Essaie de Psychologie de Bombardés
La longue portée de l'artillerie mise en œuvre au cours de cette guerre, et les fantaisies des aviateurs boches tant qu'il leur fut loisible d'y donner cours impunément, ont inauguré un nouveau danger. Il fallut, pour y résister, une nouvelle sorte de courage chez les civils comme chez les militaires, également menacés dans la circonstance.
Pendant des mois qui finirent par former des années, tout point du territoire situé dans la zone de vingt kilomètres en profondeur en arrière de la ligne de feu, sans compter les villes qui reçurent des obus tirés de 38 kilomètres de distance, se trouva sous la menace constante des projectiles ennemis. Et ce ne sont pas les moindres marmites qui portaient le plus loin. En présence du caprice déroutant des tirs exécutés par les artilleurs du Kaiser, nul en cette zone ne pouvait se flatter de vivre en sûreté, à quelque moment que ce fût. Les chances variaient, le risque demeurait.
Il ne s'agissait donc plus d'affronter un danger momentané, visible, précis, tangible en quelque sorte. Celui-là est le danger classique, en prévision de quoi on peut amasser une provision de courage pour le dépenser au moment voulu. On sait encore qu'en y courant on a chance de le supprimer; ce sentiment va jusqu'à déterminer ce qu'on a appelé la fuite en avant. En pareil cas, le vrai brave accepte le sacrifice de sa vie; il sait avoir toutes chances contre lui, et cependant il agit jusqu'au bout conformément à ce que le devoir commande. Les uns le font de sang-froid; d'autres tendent les ressorts de leur volonté, dominent leurs nerfs, mais ne sauraient prolonger cet état au delà de certaines limites.
Un jeune sous-lieutenant belge, frais émoulu de l'Ecole de Gaillon, et qui venait de prendre le commandement de sa section, m'expliquait que pour acquérir de l'autorité sur ses hommes, l'officier doit dès l'abord leur montrer l'exemple de la bravoure et du mépris du danger. En vertu de quoi, une nuit, il s'aventura seul au delà de nos lignes, rampa derrière celle des sentinelles et des petits postes ennemis, et repéra plusieurs pièces de canon dissimulées dans une ferme., ou ce qui en restait. Au retour, il reçut les félicitations de son commandant, qui, d'ailleurs déclara ne pas pouvoir le proposer pour une citation, puisqu'il avait agi sans ordres, et par ainsi mérité plutôt une punition qu'une récompense. Le commandant ajouta:
— Mais soyez tranquille: c'est un ordre que je vous donnerai une autre fois.
En toute franchise, mon sous-lieutenant conclut:
— Il est bon!... Une autre fois, il n'est pas dit que je serai aussi bien disposé à y aller!
Et cela est profondément humain. Je dois ajouter que la fois suivante, il se trouva dans des dispositions identiques à la première. Les Boches ayant enlevé un petit poste par surprise, il fut chargé de le reprendre. Il combina parfaitement son attaque, réussit, et ramena les Boches prisonniers. Il reçut l'ordre de la Couronne et la croix de guerre.
De ce qu'il bande les ressorts de la volonté en vue d'un but précis, le danger classique est exaltant. De par sa nature, le nouveau danger exerce au contraire une influence déprimante. Très différent du premier, il est présent partout, et à toute heure. On ignore et l'on ne peut prévoir pourquoi une marmite tombe sur telle maison plutôt que sur telle autre, à telle seconde plutôt qu'à la seconde suivante. Le jour, en vaquant à vos occupations ordinaires, la nuit, dans votre lit, vous pouvez être atteint. Imaginez l'état d'âme du Dunkerquois, par exemple, qui n'entend pas de coup de départ, pas de sifflement annonciateur de l'obus, et voit sauter une maison à l'arrivée d'une marmite venue de 38 kilomètres de distance. Il ne s'agit plus d'affronter un danger que l'on voit venir ou au-devant duquel on court; il faut vivre, en se disant qu'à toute seconde de l'existence le danger imprécis, irraisonné, sournois, imprévisible, fondra sur vous, et vous anéantira. Il faut, en somme, non seulement se tenir toujours prêt à mourir d'un moment à l'autre, — ce qui est le propre du sage, — mais encore supporter la pensée constante de cette mort, pendant des mois et des mois. La question ne se pose plus d'accumuler une provision de courage pour un temps donné et une circonstance limitée: il faut obtenir de ses nerfs que cette tension devienne leur état normal. Et ceci, bien entendu, est d'autant plus vrai qu'on se rapproche davantage de la tranchée de première ligne.
Comment un organisme humain peut-il y tenir? Car c'est un fait que des milliers de personnes se plièrent à ces conditions d'existence.
Comment On Tient
Parmi ceux qui résistèrent, il y eut les braves, ceux qui obéissaient au devoir. Il y eut les insouciants: on en rencontre même au milieu des pires périls. Il y eut des natures sur lesquelles l'habitude agit comme un anesthésiant de l'inquiétude. Il y eut des récappés des premiers bombardements, qui, de ce fait, se crurent désormais invulnérables. Il y eut les fatalistes, le grand nombre de ceux qui comptent sur leur chance.
Il y eut encore les mercantis, dont l'apreté au gain se montra plus forte que la peur. Les voleurs professionnels obéirent à un sentiment analogue. Ils opérèrent couramment sous les obus, qu'ils considéraient comme des complices susceptibles de faciliter leur travail. A Furnes, un obus éclate dans la maison de Mme Dr., à qui l'explosion arrache un bras: des gens se précipitent à son secours, d'autres à celui de sa sacoche, qu'ils soulagent de 4oo francs, et de son argenterie, qu'ils déménagent. A Dunkerque, le bombardement révéla d'inattendus et singuliers amateurs de littérature. En compagnie de dix-sept personnes venues chercher là un refuge, Mlle D., libraire, s'était mise à l'abri dans sa cave, une vaste, profonde et solide cave voûtée qui offrait une excellente protection. Un obus de 380 éclate tout auprès; les glaces de la librairie tombent en miettes. Après l'explosion, dans ce silence de mort qui suit le vacarme de la déflagration, les gens de la cave entendirent, venant de la chaussée, une voix qui disait, nullement altérée par l'émotion:
— Prends celui-là... le jaune, oui... et puis le rouge... et l'autre, là-bas, avec une image sur la couverture...
Le bombardement terminé, Mlle D. constata à son étalage la disparition d'une quinzaine de volumes.
De telles manifestations de courage ont leur côté pittoresque.
En voici une, simple et de noble allure, de Mme Tch..., qui mérite d'être relatée. Des hommes qui ne savent plus ce que c'est que de manger à une table et de dormir dans un lit, éprouvent un puissant réconfort, matériel et moral, à retrouver ces conditions de leur existence normale: elle entreprit de les leur procurer autant qu'il fut en elle, dans la zone dangereuse. Ils lui en gardèrent une profonde reconnaissance. Tant que Fumes fut habitable, c'est-à-dire que le danger n'y fut pas constant, elle y demeura, et se mit à recevoir. Elle avait compris ce trait de la psychologie du combattant, trait profondément humain, d'ailleurs, et qui est, en somme, à la base du principe des permissions. Donc, un jour que Mme Tch. donnait un grand dîner, l'ennemi se mit à bombarder. Un obus tomba dans la rue. Pas plus que les officiers, ses convives, Mme Tch. ne broncha. Elle dit seulement:
— C'est désagréable!... On ne s'entend plus!...
Et, tandis que le bombardement continuait, elle continua de veiller à l'ordonnance du repas, en bonne maîtresse de maison.
La peur se montre plus étrange, plus caprécieuse.
Une dame, conduite à Nieuport sous un bombardement assez intense, ne s'émeut pas; elle ramasse le plus tranquillement du monde un éclat encore chaud d'un obus explosé près d'elle; elle ne prête qu'une attention de curiosité à une brique qui tombe à ses pieds, après avoir été projetée par-dessus le toit d'une maison. Et le lendemain, apercevant trois paisibles vaches sur le chemin qu'elle suivait, elle poussa des cris de désespoir, fit demi-tour, et s'enfuit.
Une infirmière essuya sans broncher l'un des plus terribles bombardements de Dixmude, où elle soignait les blessés dans le vestibule de l'Hôtel-de-Ville; peu après, elle vit anéantir à ses côtés un soldat assis dans une auto, et supporta le coup avec fermeté. Affectée par la suite à un poste de secours de Pervyse, un beau jour, et sans pouvoir en raisonner, elle se sentit prise de peur, et dut partir. Une personne habitant Furnes tint bon pendant des mois sous des bombardements répétés jusque trois et quatre fois par semaine, et tout d'un coup maigrit à vue d'oeil, perdant tant de kilos de son poids normal en un laps de temps si court, que le médecin ordonna son évacuation immédiate.
Entre ceux qui ne connaissent jamais la peur et ceux qui en souffrent en tous temps, deux catégories mixtes se rencontrent: la première, de gens très effrayés aux premiers obus, et qui s'y habituent au point de ne plus s'en soucier le moins du monde; la seconde, de gens qui, impavides au début, cèdent ensuite à une crise d'affolement, provoquée la plupart du temps par un événement insignifiant et sans augmentation du danger habituel, mais aboutissement d'une évolution morale subconsciente insoupçonnée.
En général, dans les centres habités, après l'exode que détermine l'approche de l'ennemi, le bombardement en produit un deuxième, appréciable. Parmi les habitants qui demeurent, les uns le font parce que leur situation leur crée ce devoir, les autres par « envie de gaigner », d'autres encore par l'effet d'un entêtement qui prend sa base dans l'attachement aux habitudes, à la demeure, au sol. Ces derniers sont surtout de vieilles gens qui jugent superflu de se déranger pour aller mourir un peu plus loin: sentiment fréquent même en temps de paix, où bien des malades âgés refusent d'aller chercher le climat bienfaisant, dont l'action prolongerait à coup sûr leur existence.
Sous le danger, l'élément jeune de la population témoigne d'un ardent désir de jouir de la vie, d'une hâte « d'en prendre » le plus possible. Le notaire mi-bonhomme, mi- solennel, d'une cité jadis benoîte et de mœurs calmes, déclarait, en constatant autour de lui un dévergondage imprévu:
— Je ne reconnais plus ma petite ville!
Cet excellent homme s'en montrait profondément affecté. Et près de lui une vieille demoiselle, qui dirigeait un patronage, se vit contrainte à licencier ses pupilles, tant l'état de leur santé offrait un intérêt manifeste pour l'avenir de la patrie. Ingénieuse autant que charitable et dévouée, cette personne respectable fonda une maternité. La fréquence des mariages allait en grandissant.
Et c'est là une loi invariable depuis que le monde est monde, au cours et à la suite des cataclysmes qui se déchaînèrent sur l'humanité, depuis les pestes du Moyen- Age et l'angoisse de l'an Mil, jusqu'aux prisons du Comité de Salut public et aux tremblements de terre de Messine. Le danger surexcite l'instinct vital, en même temps que le bouleversement des milieux et des conditions sociales affranchit l'individu des règles qui d'ordinaire contiennent et compriment ses instincts.
En ce qui regarde les pays bombardés, ces constatations sont d'ailleurs consolantes. Elles montrent comment le jeu des réactions naturelles sauvegarde l'avenir de l'espèce, et fournissent la preuve à l'appui de cette vérité formulée par la sagesse des Nations, que de la Mort renaît la Vie.
Chapitre X : Robinson Crusoe and Co.
ou la Persistance du Veil Homme
Une expérience maintes fois répétée l'a prouvé: l'homme appartenant à une race primitive, arraché dès l'enfance à sa sauvagerie natale, et cultivé dans la serre chaude de la civilisation, prend l'apparence d'un civilisé au point d'en donner complètement l'illusion. Mais que, même sur le tard, il retourne à son milieu originel, il se replonge bien vite dans sa barbarie d'antan. La couche de vernis dont on l'enduisit craque et s'effrite, et le naturel reparaît au galop.
Au contraire, transposez l'Européen occidental des conditions de la civilisation dans celles de la vie primitive, il réagira de suite de manière à récupérer les premières. Le Robinson, conçu par Daniel de Foe, est un symbole autant qu'un enseignement. La joie de créer, la satisfaction éprouvée à vaincre la difficulté, l'amour-propre d'auteur, sont des traits essentiels de notre psychologie. On pourrait presque mesurer le degré de civilisation d'un homme, au plaisir qu'il éprouve à fournir un effort, et à l'orgueil qu'il ressent du résultat de l'effort.
La guerre actuelle fournit à ce propos une démonstration décisive. En dépit des accessoires nouveaux dont le Progrès se plaît à l'agrémenter, elle offre généralement l'exemple du retour à une indiscutable barbarie. Je n'assimilerai pas les campagnes de Flandre à une île déserte, mais, à coup sûr, le soldat qui bivouaque en pleins champs, ou vit dans les tranchées de l'Yser, ne se trouve plus du tout dans les conditions d'habitat de l'avenue de l'Opéra ou du boulevard Anspach. Cependant, avec une rapidité surprenante et une incroyable ingéniosité, sitôt le minimum de sécurité indispensable obtenu, son effort s'applique à se procurer un certain confort, et il y parvient dans une mesure qui souvent semble dépasser le possible.
Il dépense des trésors d'imagination et d'adresse pour adapter à un usage déterminé par lui un objet découvert dans les décombres d'un village bombardé, et destiné par son fabricant à un usage totalement différent. Un tapis cloué d'un bout à une table de salle à manger, de l'autre à un dos de piano, constitue un hamac idéal. Même l'ornementation de leurs « home » préoccupe les habitants des gourbis. Sur la rive gauche de l'Yser, à vingt-cinq mètres des Boches qui bordaient l'autre rive, j'ai admiré des jardinets fleuris, aux allées artistement saupoudrées de la poudre rouge des tuiles pilées.
Quiconque s'est vu faire par un officier les honneurs de sa demeure à la tranchée, a remarqué la satisfaction visible avec laquelle il s'attache à mettre en valeur les moindres détails de l'organisation intérieure conçue et réalisée par lui: l'entrée basse et étroite, en soupirail de cave, pour que les éclats — et le commandant du secteur qui est grand et gros, — n'y pénètrent que difficilement; le lustre suspendu au plafond, dont la pièce essentielle consiste en une boîte à sardines, travaillée pour que l'on y puisse ficher deux bougies; la couchette dont le sommier s'avère un ancien grillage de cage à poules. Du moindre détail, le propriétaire témoigne plus de fierté que de son courage devant le danger, dont il ne semble pas se soucier.
Je me rappelle le modèle du genre, dû, il est vrai, à des spécialistes.
La Villa Improvisée
La plaine. Une pluie diluvienne, comme toujours. Des routes boueuses bordées de larges fossés où l'eau affleure au niveau des bas-côtés. Un liquide jaunâtre gicle en gerbes sous les roues de l'auto. Dans la morne tristesse de ce paysage, une grande prairie à l'herbe rare, piétinée, et, au milieu, des baraques de bois, grises, ternes. L'auto stoppe. J'enjambe un pont de bois glissant jeté sur un fossé; je suis un étroit chemin pavé de larges carreaux de ciments; une porte s'ouvre, et me voilà introduit dans une pièce chaude, claire et gaie. C'est une surprise.
On dirait un de ces intérieurs coquets et confortables des villas du littoral, avant la guerre. Une vaste cheminée de briques nues, presque monumentale, forme voûte au-dessus du foyer, où dans le calice d'une grille montée sur pied, en fer forgé et contourné en tulipe, le charbon flambe, dispensant de la joie avec sa bonne chaleur.
A mi-hauteur des parois de la pièce en bois de sapin, un bandeau de couleur marron marque la route où court une frise de silhouettes féminines découpées dans les journaux les plus parisiens; elles se groupent et se suivent en une théorie élégante, de la plus amusante fantaisie.
Les meubles, disparates et rarement complets, ne jurent pas de leur voisinage réciproque. Deux demi-buffets, que le marchand fit certainement passer pour anciens, doivent un air vénérable à d'adroits rafistolages récemment exécutés, nécessaires travaux de consolidation. Un magnifique piano aux incrustations de cuivre se carre dans un coin avec des airs de bourgeois cossu. Sur la cheminée une toile, veuve de son cadre, un magnifique portrait de jeune femme à crinoline et à bandeaux plats, évoquant les maîtres d'autrefois par la solidité de la pâte et la richesse du Coloris, apporte une note d'art savoureuse et distinguée.
Ces épaves ne proviennent pas du navire de Robinson, mais furent sauvées du désastre d'une ville.
Le couvert est mis. Pas d'argenterie, mais chacun a couteau, cuiller et fourchette, de modèle divers. Une cristallerie nombreuse et variée scintille; sa provenance hôtelière se devine à la capacité des coupes à Champagne, énorme parce que le Champagne se vend à la bouteille, tandis que celle des verres à liqueur est minuscule, parce que les liqueurs se vendent au verre.
Les portes intérieures ouvrent sur des couloirs où donnent des chambres à coucher, de véritables cabines de navire, moins le roulis; les garnitures de toilette, article éminemment peu fait pour résister au choc de l'acier des 380, sont hétéroclites et ébréchées; des bois de lits différents ont concouru à en former un seul, qui s'ajuste aux dimensions de la cabine. Un militaire, jadis maître-coq à bord des paquebots d'une grande compagnie de navigation, opère dans une cuisine qu'envieraient bien des ménagères: c'est dire l'intérêt artistique du menu qui s'élabore, et dont les divers numéros mitonnent sur le fourneau.
Et voilà comment, dans une zone désolée, les Occidentaux dont je fus l'hôte avaient opéré un retour complet aux conditions d'une civilisation raffinée. Le résultat de leur effort justifiait un amour-propre d'auteurs non dissimulé, et absolument légitime.
Chapitre XI : Frère Jean
Imaginez Fra Angelico, le moine plongé dans son rêve de chrétien et d'artiste, brusquement enlevé à la paix de son couvent et jeté en pleine barbarie, en pleine guerre moderne.
Son âme simple, son cœur pur se complaisaient dans les délices de la foi et dans les joies de son art. L'une et l'autre n'évoquaient devant son esprit que des images de douceur et de beauté. Et tout-à-coup le voilà lancé dans le tourbillon de la retraite d'Anvers, dans la sanglante tragédie de l'Yser. Le voilà sous les rafales de marmites, parmi les trombes d'acier hurlant dans l'air déchiré, le voilà assourdi au fracas des explosions tonnantes, et ramassant toute la douleur humaine éparse sur les champs transformés en charniers. Il voit gicler sur la route la cervelle du médecin dont il est le brancardier. Il vit au contact permanent de la souffrance et de l'horreur.
Quels drames se passèrent alors dans les âmes voisines de la sienne? Qui eût jamais songé à celui-ci: il y avait, occupant un rang dans la hiérarchie de son couvent, un frère d'origine allemande; peut-être fut-ce à cette circonstance que le couvent dut d'être épargné; mais des affres de la guerre, des atrocités commises par ses compatriotes dans le pays paisible où il priait, ce religieux devint fou.
L'âme de frère Jean demeura ferme en face de ces événements auxquels rien ne l'avait préparé. Il a vécu cette existence si diamétralement opposée à celle qu'il s'était choisie, sans qu'une ride vînt modifier l'expression de bonté dont sa physionomie rayonne. Il porte à hauteur du cœur la croix de laine rouge sur la vareuse kaki, et au collet le caducée brodé entre deux palmes. Le port du casque n'arrive pas à lui conférer un air spécialement guerrier.
Dans le « tumulte des camps », comme on disait jadis, il connut une oasis: la permission réglementaire lui fut l'occasion d'accomplir une retraite. Le lieu désigné fut une maison religieuse, une superbe propriété dans la campagne de l'Ile-de- France. Il y avait là de grands arbres centenaires aux essences variées, des allées solitaires soigneusement entretenues. Avec délices, frère Jean s'y retrempa dans le silence, la solitude et la méditation.
Les armées une fois stabilisées face à face dans la longue guerre de siège où elles s'éternisèrent, chacun découvrit à frère Jean de multiples occasions d'exercer ses talents. Je ne parle pas ici de ceux afférents à son œuvre de dévouement. Mais dans la vie militaire, quiconque sait manier le crayon ne manque jamais d'être mis à contribution. Frère Jean en fit l'expérience.
— Frère Jean, il nous faut un modèle de frise pour l'école installée dans les baraquements de Boitshouk... Etablissez-le, et exécutez-le sur place...
— Frère Jean, en fouillant le sable des dunes, au camp romain, j'ai découvert les objets que voici: des fibules de bronze, une mosaïque insérée dans une broche mérovingienne, des monnaies, des poteries... Il m'en faudrait la reproduction scrupuleusement exacte, grandeur nature...
— Frère Jean, il faut à l'hôpital du Duinhoek un portrait du roi et un portrait de la reine; il faut aussi un encadrement à ces portraits, quelque chose d'artistique...
— Frère Jean, il faut pour l'ambulance un écriteau avec une flèche indicatrice...
— Frère Jean, nous allons demain aux avant-lignes: préparez les plaques et les pellicules, et chargez soigneusement les appareils...
Car frère Jean est aussi un artiste en photographie; il sait avec un goût sûr choisir son modèle et l'éclairage qui y ajoutera ce je ne sais quoi, dont le défaut se fait habituellement sentir dans les photographies de professionnels.
Et frère Jean charge les appareils, va aux avant-lignes, prend les photos, développe les plaques, tire les épreuves. Et il combine d'élégants motifs décoratifs en stylisant des fleurs, des animaux, des accessoires guerriers, puis découpe les pochoirs, prépare les couleurs, et répand de la lumière et de la joie plein les baraquements où s'instruisent les enfants réfugiés, où peinent les malades, où souffrent les blessés. Et avec son crayon, avec son pinceau, à l'aquarelle, à la gouache, il reproduit les fibules romaines, les bijoux mérovingiens, les poteries samiennes ou de fabrication locale, avec une exactitude, une minutie, et dans les ombres portées une habileté telles, qu'on avance la main pour les saisir, et que le trompe-l'œil est absolu.
Tout en fignolant ses œuvres avec amour, — car à toutes ces tâches, y compris les flèches indicatrices, il s'attelle avec la même conscience, — frère Jean n'entend pas le canon qui tonne, et rarement daigne-t-il se déranger pour lever les yeux vers ce point noir dans le ciel moucheté de shrapnells, vers ce taube dont cependant les incongruités meurtrières ont déjà semé la mort à ses côtés.
Son inépuisable complaisance lui vaut travaux sur travaux, besognes sur besognes, tant et si bien qu'il ne prend même plus le temps de souffler, et ne dispose plus d'une minute parmi celles que ses heures de service lui laissent libres.
Parfois il rencontre un partenaire avec qui s'entretenir de son art. La peinture, l'art décoratif surtout, il les a étudiés à fond. Il en parle bien. Sa voix, légèrement voilée, s'anime, s'échauffe, se passionne. On s'aperçoit qu'il connaît l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et leurs chefs-d'œuvre, qu'il a comparé les écoles et jugé les styles, qu'il a analysé les talents, et qu'il est lui-même un véritable artiste. Ces moments-là sont de nouvelles oasis où il oublie un instant les fusillades, les bombardements, les massacres, les plaies ouvertes et le sang répandu.
Voyant sa soumission, son dévouement, sa bonté, quelqu'un disait:
— C'est un saint.
Je n'oserais affirmer que déjà le temps soit venu de le ranger parmi l'une quelconque des catégories célestes. Sans doute lui-même envisage-t-il sans hâte pareille anticipation. Mais à coup sûr, tel que je le vois, je ne me ligure pas autrement Fra Angelico, un Fra Angelico que les 420, les zeppelins et les gaz asphyxiants, — mathématique, physique et chimie diaboliques, — n'empêcheraient pas de rêver et d'œuvrer en chrétien et en artiste.
Chapitre XII : Le Caporal Dieu
Tantôt, Louis Piérard doit chanter, dans une salle de l'ambulance, quelques-unes de ces chansons wallonnes et flamandes qui ragaillardissent les blessés. Il manque d'accompagnateur. Nous nous mettons en quête pour en découvrir un, certains, d'ailleurs, de réussir: au front, les talents musicaux ne manquent pas.
Sur un terre-plein, parmi les villas, un grand rassemblement d'hommes d'où partent en fusées des exclamations et des rires: des Wallons jouent à la paume, leur jeu favori. Du haut d'une estrade, leurs officiers jugent les coups et distribuent les prix aux vainqueurs; le courage malheureux se contente d'une poignée de mains de son capitaine. On se presse pour mieux voir; de grands éclats de rire saluent ironiquement les maladresses des joueurs, et des applaudissements enthousiastes les coups heureux. Nous regardons. Soudain, Piérard tombe dans les bras d'un être étonnant, qui riait à gorge déployée. A y regarder de près, on reconnaît un caporal, mais un caporal comme je n'en avais jamais vu: des plaques de boue, des accrocs, des reprises, des mains noires et terreuses, des cheveux longs saupoudrés de terre séchée, des dents blanches, un regard vif comme l'éclair, et une figure épanouie de joie.
Tel se présente le caporal Dieu. A première vue, ce nom semble lourd à porter. Mais il ne paraît pas peser autrement sur les épaules du titulaire. Ce dernier sort du Boyau de la Mort, de sinistre renommée, et, avant de prendre le temps de se débarbouiller, il n'a pu résister au plaisir de suivre une partie de paume. Le caporal Dieu est un bon Wallon. Il n'a rien de commun avec son homonyme, celui auquel le Kaiser ne manque jamais de rendre hommage des crimes et des turpitudes dont il se souille, et l'Allemagne avec lui.
Cette nuit encore, le caporal Dieu rampait le long du Boyau de la Mort, dans la boue- sanglante et fétide, sous le sifflement des balles boches tirées des tanks à pétrole, ce bloc de béton qu'une entreprise allemande avait édifié dès le temps de paix. Le caporal Dieu parle de ses camarades, des universitaires comme lui, tués à ce passage meurtrier. Il explique combien ceux qui s'en tirent peuvent se vanter d'être veinards, et combien il est normal, au moment où on risque sa peau, de ne pas s'effaroucher d'un placard de boue à sa capote, ni d'un accroc au fond de sa culotte.
En attendant de devenir un juriste éminent, le caporal Dieu est un excellent musisien. Voilà notre accompagnateur trouvé.
Et l'après-midi, sur une estrade garnie de palmiers, de draperies rouges et de drapeaux aux couleurs des alliés, le caporal Dieu s'installe devant le piano. La capote raclée, les cheveux calamistrés, la barbe ratissée, la peau des mains décapée, il se présente sous un aspect quasi civilisé aux regards des infirmières aux coiffes élégantes qui ornent les premiers rangs de chaises.
Le caporal Dieu accompagne les chansons que chante Louis Piérard. Ce n'est pas assez dire: il les mime. Il se balance sur son tabouret, d'avant, d'arrière, de gauche, de droite; il gesticule tout en martelant le clavier; il sourit, il rit, il s'attendrit dans sa barbe, dont les épis récalcitrants se rebellent au fur et à mesure des mouvements qui agitent son corps en même temps que son âme. La chanson finie, il se pénètre de la suivante. Il est là pour son compte personnel; il oublie les-trade, il oublie le public. Il a complètement oublié le Boyau de la Mort, où il y a quelques heures il rampait, sous le sifflement des balles boches, dans la boue fétide et sanglante.
…
Chapitre XIII : Le Noël sur l'Yser
Le Deuil dans la Nuit
Le long de l'Yser, le long de la rivière au nom désormais immortel, il n'est plus de cloches dans les clochers, il n'est plus de clochers, il n'est plus d'églises. Les obus monstrueux ont crevé les voûtes anciennes, ont déraciné les piliers, ont mutilé les christs aux bras étendus, et qui gisent parmi les décombres; ils ont bouleversé les champs de repos et arraché les morts des tombeaux où l'on croyait que régnerait pour eux une paix éternelle; ils ont décapité les flèches hardies qui pointaient dans le ciel, et sous les masses d'acier les tours s'effondrèrent, tandis que se brisait sur le sol le bronze harmonieux des cloches, le métal argentin lentement patiné par les siècles.
Cette nuit de Noël 1915, l'œil scintillant des étoiles ne verra pas, le long des sentiers qui courent à travers la campagne et se faufilent parmi les ondulations des dunes, les lueurs errantes des lanternes guidant les pas des fidèles qui vont saluer la venue du petit Jésus. L'illumination des cierges ne projettera pas au dehors le rayonnement multicolore des vitraux aux gemmes précieuses. La grande voix des orgues demeurera muette.
Dans les maisonnettes des pêcheurs, le long de la côte, autour du foyer flambant dans les grandes cheminées des fermes flamandes, autour des poêles dans les maisons bourgeoises des coquettes cités qui s'élevaient sur la plaine, on ne se réunira pas pour manger des coukes, ni aucune des spécialités gastronomiques de cette province, où l'air vif suscite l'appétit et encourage la gourmandise.
Un lourd voile de deuil pèse sur les joies traditionnelles où l'on se complaisait jadis.
Le Noël Sanglant
L'an dernier, la sanglante bataille des Flandres venait de finir. Les dunes de Nieuport, la boucle de l'Yser, Dixmude, le saillant d'Ypres, avaient été le théâtre d'une lutte effroyable, et des flots rouges avaient détrempé la vieille glèbe. Les deux années, encore étourdies par la violence inouïe de ce choc, se reconstituaient. La marée allemande arrêtée définitivement, nos troupes s'organisaient dans les tranchées rudimentaires où elles avaient merveilleusement réussi à tenir; elles se fortifiaient dans leurs positions; elles commençaient à améliorer les conditions matérielles auxquelles il leur fallait s'adapter pour de longs mois. Déjà se faisaient sentir les premiers effets de cet effort de reconstitution de son armée, réalisé depuis par le gouvernement belge. Un premier rayon d'espoir commençait à luire. Et comme les fêles de Noël approchaient, de toutes parts les cadeaux affluèrent pour les soldats: des sous-vêtements, des lainages, des confitures, du vin, du chocolat, des cigarettes, des pipes, que sais-je encore? Il y en eut pour tous les goûts, et en abondance.
La canonnade s'espaçait. Il ne pouvait s'agir pour les Allemands de recommencer la bataille; mais puisqu'il y avait de la joie dans l'air, en dépit des misères de ce temps et de la désolation de ce pays, ils s'efforcèrent de la tuer. Ainsi se manifeste habituellement l'humour allemand. A l'occasion de la fête de Noël, ils s'avisèrent de bombarder les bourgades et les villes à leur portée, et qui avaient jusque-là échappé à la furie de Faction. Furnes fut cette fois un de leurs buts préférés. Je vis alors quelques-unes de leurs victimes: une jeune femme au bras arraché; des religieuses qui donnaient des soins à quelques enfants, dont l'une fut tuée et deux autres grièvement blessées. Il n'en manqua pas d'autres.
Ainsi, dans cette région, les Allemands commençaient l'œuvre de destruction systématique qu'ils ont continuée depuis, anéantissant de jour en jour tout ce qui se trouve sous la portée de leurs canons.
l'Etoile Merveilleuse
Ce ne sont même plus des villes ni des villages en ruines qui se reflètent dans les eaux calmes de l'Yser: ce sont des cadavres de villes, ce sont des squelettes de villages. Leurs pierres écorchées ont la blancheur des ossuaires délaves par le temps, et évoquent devant l'imagination déroutée, l'idée de quelque déconcertant, de quelque inconcevable cataclysme.
Et cependant dans la tranchée, dans le poste d'écoute où il veille, le doigt sur la gâchette de son fusil, le petit fantassin belge, le petit soldat rose et blond à la bonne figure joufflue, non seulement n'a pas perdu l'espoir, mais, au contraire, sent plus que jamais son cœur se gonfler d'espérances nouvelles. Voici Noël, et les mille douceurs qui lui arrivent de l'arrière, tout en ne laissant pas que d'être agréables en soi, lui apportent ce réconfort moral de savoir que ceux pour lesquels il se bat, pensent à lui avec amour, et prient pour lui.
Voici Noël, voici la nuit. Des canons tonnent çà et là, par intervalles. Des lueurs rouges brillent en éclairs subits. Le feu d'artifice des fusées de couleurs, des lumières au sens mystérieux, animent l'obscurité, comme le jeu d'orgue des escadrilles d'avions aux moteurs chantants animent le silence des hauteurs aériennes. Le petit soldat qui veille écoute les bruits sur la surface lisse, sur le miroir calme de l'inondation; il suit le jeu des reflets qui courent et qui dansent. Et parmi ces reflets divers, voici qu'il en distingue un plus vibrant, plus fixe, plus intense que les autres. Il lève alors les yeux vers la voûte du ciel; son regard cherche, et reconnaît l'Etoile merveilleuse, l'Etoile unique, celle qui jadis guida les Rois mages vers la lumière éternelle, vers l'Enfant divin. Elle brille ce soir plus radieuse que jamais au-dessus des tranchées de l'Yser; elle s'annonce comme un Signe, et le petit soldat comprend qu'elle l'appelle, pour le guider vers la Victoire.
Chapitre XIV : Mon Ami Bronchart
Un Souvenir de la Retraite
La longue, la triste procession de l'armée belge en retraite, des civils fuyant devant l'invasion, achevait de défiler sur la route. Depuis huit jours, elle y déroulait son ruban ininterrompu de douleurs et de misères. Maintenant, ses divers éléments s'espaçaient; des blessés, des éclopés, par petits groupes, se traînaient misérablement, à petits pas, avec des arrêts fréquents que l'épuisement transformait en pauses interminables au bord du chemin, sur le sol détrempé par les bruines de l'automne. Ils s'affalaient dans les boqueteaux clairsemés, et parmi les taillis légers qui garnissent le creux des dunes entre la mer et la limite des sables, du côté où commencent la terre des polders et les champs labourés. La grande rumeur de la retraite, qui pendant huit jours avait vibré à nos oreilles comme un glas de la guerre, s'apaisait. Le silence revenu, des souffles de brise froissaient les feuilles jaunissantes qui une à une se détachaient de la branche, et tombaient en tournoyant. Une inquiétude plana. Au loin, le canon commença à gronder sourdement.
Dans les magasins de comestibles, le passage de tant de milliers d'hommes avait fait le vide. La bière manquait dans les estaminets. Un soldat faisait tinter trois pièces de cinq francs dans sa main tendue:
— Je ne trouve pas une tartine à acheter, disait-il.
Les habitants n'étaient guère mieux partagés. Les rares charrettes disponibles devaient rouler dix lieues pour rapporter de Dunkerque un ravitaillement dérisoire. Les derniers traînards étaient les plus affamés. On secourait ceux qu'on pouvait.
Je n'en avais guère rencontré d'aussi pitoyable: étouffant sous le poids de l'équipement et de la lourde capote noire largement dégrafée au col, il avançait à pas incertains, chancelants. Le teint jaune, les traits tirés, la bouche ouverte, un masque de fatigue et de souffrance. Des gémissements désespérés s'échappaient de sa gorge contractée. On se demandait si, de ses yeux injectés de sang, le regard trouble voyait. Le képi rejeté en arrière découvrait son front, où perlait une abondante transpiration. Il s'appuyait sur son fusil. On s'attendait à le voir s'effondrer d'un moment à l'autre.
Je l'engageai à entrer. L'air égaré, il ne répondait pas. Il fallut répéter pour qu'il comprît. Il avala un œuf frais battu dans du café noir, se reposa quelque peu, et voulut à toute force se remettre en route. Rien ne put le retenir. Il reprit sa voie douloureuse. Il s'éloigna dans la direction de la petite garé voisine.
Un Revenant Qui Est le Bienvenu
Quatorze mois plus tard, bien des événements s'étaient déroulées, et cet incident m'était à peu près sorti de la mémoire. Quelqu'un sonne à la porte. La vieille servante flamande va ouvrir. Elle aussi, toute sa conception de la vie fut tellement bouleversée depuis la guerre, qu'elle ne s'étonne plus de grand'chose. J'entends un palabre indistinct qui se prolonge; enfin elle vient m'annoncer que « c'est un soldat qui vient dire merci ».
Je le fais introduire afin d'éclaircir ce mystère, et je vois entrer un grand gaillard, bien planté, carré d'épaules, arborant un large sourire qui éclairait une physionomie heureuse.
Il paraît légèrement surpris que je ne le reconnaisse pas d'emblée, et précise mes souvenirs.
— Alors, comme pour la première fois depuis ce temps-là je me retrouve par ici. J'ai pensé que je devais aller chez ces gens-là pour les remercier.
« Ces gens-là », c'est moi. L'intention est excellente, et j'avoue que j'en suis touché, ne fût-ce que vu la rareté du fait. Et Bronchait me conte la suite de ses aventures: arrivé à la petite gare, une défaillance le prit, et il perdit connaissance. On l'évacua sur un hôpital de l'arrière où il demeura trois mois. Revenu au front, il en repartit pour aller faire son instruction de mitrailleur. Après quoi il resta cinq mois en première ligne sans jamais venir au grand repos. L'y voici pour un bon mois, et depuis lors, régulièrement, sa formation cantonne huit jours par mois au village voisin. A chaque séjour, mon ami Bronchart vient me voir, car nous sommes une paire d'amis, désormais.
La première fois qu'il s'assit devant une table où le couvert était mis, et que, la serviette au cou, il attaqua le potage, Bronchart n'en revenait pas :
— Ça rappelle la maison, disait-il.
Pareille aventure ne lui était pas arrivée depuis un temps qui commençait à devenir immémorial!
Nous parlons longuement de sa vie passée et de sa vie présente, il conte des anecdotes. Pendant la retraite, les Boches cernèrent son peloton; son lieutenant fit à haute voix son acte de contrition, Bronchart l'imita, et on se battit si bien qu'on se tira d'affaire. Au combat de Boggenhout, une auto-mitrailleuse française « sauva la vie à mon régiment », dit-il. Le caporal qui la manœuvrait découvrait sans crainte le haut du buste, pour mieux viser l'ennemi qui tirait à 100 mètres; et il criait aux fantassins belges: « Couchez-vous dans le fossé. »
Aujourd'hui, Bronchart, qui est un Wallon de bonne souche, a une foi absolue dans son arme, et il l'aime comme un artilleur peut aimer sa pièce:
— Pensez donc! Avec une mitrailleuse, on peut arrêter un bataillon!
Mon ami Bronchart ponctue ses récits d'une incroyable quantité de: « Nom des-z-os! » Et chaque fois qu'il commence à s'embrouiller dans une explication un peu complexe, il se tire d'affaire au moyen d'une série de: « Et toutes sortes!... », dont l'accent convaincu remplace ce que les termes ne peuvent pas exprimer.
Puis un jour, son corps changea de secteur. Il ne viendrait plus au repos dans le village voisin. Nous allions rester longtemps sans nous revoir. Il allait occuper un mauvais secteur. Et Bronchart, avec mélancolie, déposa chez moi une petite caisse contenant quelques effets, quelques souvenirs qu'il ne pouvait emporter avec lui; il y inscrivit l'adresse de son père, auquel il me pria de les faire parvenir au cas où il lui arriverait malheur. Mais j'espère bien que Bronchart en personne me la réclamera plus tard.
Sa mélancolie s'aggravait d'une énorme fluxion qui le défigurait complètement, et que lui avaient value les nombreux courants d'air de l'étable où il couchait, non loin du trou par où s'écoulait le purin. Cela ne l'empêcha pas de me conter encore une histoire: il était cantonné dans une ferme avec plusieurs camarades, dont l'un, par chance, se trouva cousin de la fermière. Un jour, cette femme tue un lapin, et, suivant la coutume, l'écorche, puis le suspend en plein air. Le cousin va à la chasse aux chats, tue un Rominagrobis, le dépiaute, et par ce nouvel écorché remplace le précédent. Ce fut donc le chat que la fermière mit en gibelotte. Le cousin lui demanda si elle s'en était régalée, et sur réponse affirmative, il exhiba la tête du chat qu'il avait gardée comme pièce à conviction. Bien entendu, pendant ce temps, ledit cousin et ses camarades avaient dégusté le lapin. La fermière ne put qu'en rire. J'aime beaucoup mon ami Bronchart.
…
Chapitre XV : La Saison Bat Son Plein
La Rubrique: Théâtres et Concerts
Certains corps de troupes ont construit, sur divers points du front, des théâtres parfaitement agencés et ne laissant rien à désirer aux spécialistes les plus exigeants. Des comédiens notoires y ont joué devant les poilus, et en présence de ce public vibrant et sincère, telle artiste, habituée à la froideur de salles prétentieuses et médisantes, s'est surpassée.
A ces représentations sensationnelles, j'avoue que je préférais celles, plus naïves, plus touchantes, où des soldats étaient auteurs, acteurs, musiciens, metteurs en scène, machinistes, et dont toute la matière élait fournie par le corps de troupe qui donnait la fête.
La salle, jadis de banquets pour noces nombreuses, comportait une scène. Le manteau d'arlequin figurait un portique de palais exotique ou moyenâgeux: un archéologue averti n'en eût pu fixer le style avec précision. Les colonnes, les chapiteaux affectaient des formes fantaisistes et des attitudes penchées qui défiaient audacieusement les lois les plus élémentaires de l'équilibre. Les décors procuraient une illusion suffisante à l'imagination d'un public de bonne volonté: piotes au teint rose et aux yeux écarquillés. Aux premiers rangs, quelques officiers; rarement plus de trois civils; et des dames dont le nombre n'atteignait parfois la douzaine que grâce à l'appoint d'infirmières profitant d'un moment de répit.
Le programme était chargé, et varié. Une affiche illustrée et manuscrite l'annonçait à l'extérieur, fantaisiste ou caricaturale, puissante ou même tragique: on la vendait aux enchères après la représentation. Les romances sentimentales succédaient aux chansonnettes comiques, les saynètes aux pantomimes; un auteur parvint, non sans mal, à faire jouer un drame en cinq actes, — pas moins, — écrit spécialement pour la circonstance, et embrassant l'ensemble des événements depuis la mobilisation jusqu'à nos jours. Les revues obtenaient la faveur des auteurs et du public, car il s'y dépensait, avec une liberté inconnue par ailleurs, une verve satirique qui s'en prenait aux tics des chefs, et des communiqués officiels.
Les interprètes jouaient avec une sincérité et des gaucheries délicieuses. Leur conviction donnait le plein de leur sens aux paroles et aux gestes, si enfantine en fût l'expression. Lorsque le fantassin qui chantait le Clairon, de Déroulède, s'écriait d'une voix par trop tonnante: « En avant, à la baïonnette! », on ne pouvait s'empêcher de penser que la veille il avait rugi ce cri à la face de l'ennemi, et que demain peut-être il tomberait en le poussant. Et si les ténors et les barytons ne savaient pas toujours conduire leur voix avec cette dextérité que l'on acquiert dans les conservatoires, au moins le timbre en était-il jeune, pur, frais et charmant. Quant aux comiques, j'en vis d'inénarrables; je me rappelle un carabinier, dans le rôle du substitut de l'Article 330, dont la fantaisie, la physionomie, les intonations, furent incroyables de drôlerie et de justesse; et certain chanteur flamand qui avait tout pour lui: le physique, le jeu, l'organe, et qui déchaîna des tempêtes de rire. Mais comme il faut qu'ici la guerre, même aux instants où l'on s'en croit le plus éloigné, se manifeste toujours présente et s'impose durement à l'esprit, chaque geste de ce comique relevait sa manche, et à son poignet, éclairée par les feux de la rampe, maintenue par une chaînette formant bracelet, brillait sa plaque d'identité.
En général, la séance se clôt sur une « Apothéose » de circonstance. En voici un thème caractéristique: la scène représente une clairière dans une forêt; au fond, des faisceaux de fusils, des soldats couchés, et une sentinelle qui monte la garde, casque en tête. Au premier plan, un soldat, drapé dans les couleurs belges, chante. Après chaque couplet, une voix dans la coulisse appelle le nom d'une des nations alliées: le soldat qui la figure — reconnaissant au drapeau dont il s'enveloppe le torse par-dessus son équipement, — entre en scène, une, deux, une deux..., fait un à-gauche ou un à-droite brusque comme à l'exercice, et instinctivement s'aligne sur le précédent, le poing sur la hanche, et un peu désorienté de ne pas entendre le commandement de: « Fixe! » La liste des nations alliées épuisée, et les couplets terminés, les soldats couchés se dressent, rompent les faisceaux, présentent l'arme, et tout le monde entonne la Brabançonne.
A l'entr'acle, des quêteuses tendent en guise d'aumônière une douille de 75; le produit de la quête, proclamé avec satisfaction, va à quelque œuvre de bienfaisance, et le plus souvent à la Croix-Rouge.
Avant de lever la séance, le général qui la préside prononce quelques paroles appropriées, précisant la signification de la réunion. Après quoi l'on se sépare, le cœur content, et l'on va deviser devant une chope en fumant une pipe.
Nul cabotinage. Durant ces minutes de bien-être paisible, l'âme simple, sentimentale et bon enfant des petits piotes s'est épanouie dans la tendresse et dans le rire, dans l'enthousiasme et dans la foi en l'avenir.
Chapitre XVI : l'Ecrasement de Loo
l'Anitiquité de Loo
On dit: la ville de Loo. On exagère.
La population de cette localité flamande équivalait à celle de l'un des grands villages environnants. Mais Loo jouissait d'une belle église, d'allure monumentale, surmontée d'une haute tour et d'une flèche élégante ornée de crochets. Loo possédait un Hôtel de Ville récemment restauré, avec une tour carrée et des ferronneries nombreuses; un cabaret en occupait la partie principale; imaginez un Palais-Bourbon où la buvette tiendrait plus de place que la salle des séances, et serait accessible au public. Loo montrait, à la suite de l'Hôtel de Ville, un hôpital civil, de minuscules dimensions en vérité, mais qui remontait à l'an 1216, où on le construisit pour servir d'asile aux pèlerins et aux voyageurs; il avait été rebâti en 1686, et vers ce temps on y avait ajouté une petite chapelle. En potence, un couvent de religieuses achevait de donner sa physionomie à la place, dont des maisons particulières occupaient les deux autres côtés. L'église et le couvent conservaient pieusement des tableaux qui étaient de belles œuvres d'art. Les stalles et les boiseries du chœur de l'église jouissaient d'une célébrité modeste, mais de bon aloi.
En somme, l'église, l'Hôtel de Ville, l'hôpital, le couvent, étaient dignes d'une ville. De plus, bien des villes de taille imposante n'auraient pu se targuer d'un passé aussi lointain. A ce passé était attaché un archéologue local. Le second rappelait et expliquait le premier avec plus ou moins d'exactitude.
Le voyageur arrivant de l'Occident apercevait à l'entrée de Loo un arbre antique au tronc rabougri. Des briques et du mortier en maçonnent les fissures; des tenons de fer consolident sa décrépitude. Puis une sorte d'arc-boutant, appuyé à une tourelle au toit conique, occupe une moitié de la largeur de la route. L'archéologue vous disait, avec un sourire sceptique:
— Cet arbre rabougri s'appelle l'arbre de Jules César..., du moins la tradition le veut ainsi.
Reprenant son sérieux, il ajoutait que l'arc-boutant s'appelait la Porte de l'Ouest, sous laquelle passait la voie romaine; trois autres voies, non moins romaines, se dirigeaient sur Poperinghe, sur Estaires et sur Gand.
L'archéologue vous apprenait encore, non sans une pointe d'orgueil, qu'au cours des siècles Loo fut trente-six fois prise, brûlée et pillée, par les Northmans, les Français, les Anglais, les Allemands, les Gueux, les Espagnols et les Ostendais. Il avait dressé le bilan du compte qui revenait à chacun dans ce total respectable, et établi que les Français arrivaient bons premiers, ayant fait seize fois, à eux seuls, la conquête de Loo.
Et cependant, le cœur de Ia petite cité n'avait jamais cessé de battre.
Il vient de s'arrêter. Bien que Loo n'ait pas été prise, pour la trente-septième fois elle a subi l'assaut de l'ennemi: mais cette fois, l'ennemi, c'est le Boche, un fléau qui ne pardonne pas. L'assaut fut livré de loin, à coups de gros canons. Il aboutit à un désastre sans précédent.
Le 21 décembre 1914, les premiers obus firent leur entrée avec fracas. Sans grande peine ni grand mérite, ils démolirent le petit hôpital et quelques maisons; l'un d'eux meurtrit le chœur de l'église, dont il endommagea les boiseries.
Et puis, il y eut un répit. On en profita pour mettre les œuvres d'art à l'abri. On enleva les stalles, les boiseries, les tableaux, et une grande statue de bois représentant, saint Pierre, qui dominait le maître-autel. On sauva également les meilleurs tableaux ornant le couvent des religieuses. Le 23 octobre 1915, avec l'aide de fusiliers-marins français, on descendit du haut clocher les cloches vénérables, et on les emporta.
Il était temps. Deux jours plus tard, cinquante-deux obus de 210 tombaient en plein centre de la ville. A de brefs intervalles, trois autres bombardements suivirent celui- là.
Loo est Frappée au Coeur
J'ai voulu voir ce qu'il en advint. A coup sûr, en gens qui cultivent l'art de détruire, les Allemands accomplirent là un de leurs chefs-d'œuvre.
Le petit hôpital, qui abrita au douzième siècle les pèlerins de passage, a définitivement rendu l'âme. La tour carrée de l'Hôtel de Ville fut décapitée avec une maestria de bourreau exercé; à hauteur d'homme, un cadre grillagé reste accroché au mur; il contient encore les avis administratifs qu'y inséra un secrétaire communal scrupuleux; sans le moindre respect, les intempéries effacent les textes bureaucratiques.
Deux ou trois soldats errent sur la place. Leurs grosses chaussures grincent sur les éclats de vitres qu'elles écrasent à chaque pas. Un entonnoir d'obus de cinq à six mètres de diamètre s'est empli d'une eau vaseuse, où flotte un paquet d'entrailles. Je jette un coup d'œil sur le jardin du couvent: un grand Christ, deux fois crucifié, gît sur l'herbe, portant au flanc une large blessure. Dans la chapelle aux vitraux multicolores, préservés jusqu'ici par miracle, un soldat immobile comme une statue, agenouillé, la tète dans les mains, s'abîme en une ardente prière. Sur le pavement de marbre noir se détachent les petites dalles blanches, égales et régulièrement alignées, qui recouvrent les nonnes défuntes, sous la garde de la fondatrice du couvent dont la tombe les domine et semble veiller sur elles; elles continuent à dormir dans le silence poignant qui succède au tonnerre des bombardements.
Une rangée de maisons sépare la place de l'église. Du côté de la place, les fenêtres sont brisées; leurs linteaux et ceux des portes s'effondrent; des poutrelles fixées obliquement les étayent; les tuiles des toits dégringolent sur le trottoir, ou s'empilent au bord du chêneau, dans un équilibre inquiétant. Du côté de l'église, les façades baillent, éventrées. Il existe là un espace assez étroit, peuplé de tombes; le cimetière entourait complètement le monument et s'étalait plus largement sur les autres faces. Partout, les obus le labourèrent. Les entonnoirs voisinent à se toucher. Pas une sépulture inviolée. Les os des pauvres morts, sauvagement dispersés, se mêlent dans les amas de terre remuée aux morceaux de marbre où l'on déchiffre des fragments d'inscriptions.
Quant à l'église, sa ruine est complète. Les quatre murs tiennent encore debout, mais à l'intérieur l'éboulis, l'enchevêtrement des matériaux précipités par les obus sont indicibles : poutres et boiseries de la voule, toute la toiture, les colonnes, chapiteaux, corniches, arcs de pierre, statues de bois mutilées et méconnaissables, marbres des pierres tombales, réseaux des losanges de plomb qui retenaient les vitraux, meneaux des rosaces et des hautes fenêtres gothiques, fragments des orgues, et du mortier, de la poussière, de la terre, tout cela forme sur le pavement de la nef un amas confus, un indescriptible chaos.
A la croisée du transept, là où s'effondra le clocher, le monceau de ces ruines s'élève à la hauteur d'un premier étage. J'y grimpe, et de là je regarde par les ouvertures béantes qui donnent sur la campagne, à l'Est et au Nord; je vois un grand bâtiment auquel sa situation, dans l'axe de la ligne du tir ayant l'église pour but, valut une démolition en règle; au-delà, la plaine, la plaine flamande dénudée, ravagée, bouleversée par la guerre. A mon entrée, un congrès d'étourneaux qui sifflaient et piaillaient à tue-tête, cesse toute discussion. Bientôt, constatant que je suis un être incomparablement plus inoffensif qu'un 210, ils reprennent leur palabre sans plus se soucier de ma présence. Je lève les yeux vers les hauteurs où ils perchent, et j'aperçois une rangée de têtes curieuses et penchées: les corbeaux qui soutenaient les poutres de la voûte, échappés à la destruction, se terminent par les figures sculptées et peintes d'évêques mitres, dont les yeux ronds au regard figé contemplent inlassablement le désastre. Ils ne se départissent point de l'expression de naïveté souriante, que le « maître tailleur d'images » du temps passé fixa, voici des siècles, sur la pierre dont ils sont faits. Et cela semble une douloureuse ironie.
Le cœur de Loo, meurtri par les Barbares comme jamais il ne le fut au cours de deux mille ans d'histoire, a cessé de battre. Vont-ils s'acharner sur ce cadavre? Le procédé leur est coutumier: Furnes, Ypres, Reims, Soissons, et combien d'autres villes encore, le prouvent assez. Au moment où j'achève cette page, on m'annonce que le surlendemain de ma visite les Allemands ont recommencé à bombarder les ruines de la petite ville flamande, et qu'ils continuent.
Poperinghe à son tour subit le même sort. Une musique militaire anglaise jouait sur la place lorsque l'ennemi commença le bombardement; un obus explosa non loin des musiciens, dont deux tombèrent: on les emporta, sans que le chef ait cessé de battre la mesure, ni les autres de jouer leurs parties. Il ne reste plus, dans la Belgique libre, une seule agglomération de quelque importance demeurée intacte.
Chapitre XVII : La Revue du Roi
Ave, Patria
Debout sur une haute dune, je contemple l'horizon de mer, toujours le même, mais toujours aussi changeant, aussi varié. Le ciel est gris. Une brume borne l'immensité de l'étendue d'eau et de l'étendue de sable. Du côté de l'Est, elle noie les premières maisons habituellement en vue; celles du coté de l'Ouest se devinent à peine. En face, une trouée lumineuse dans le ciel, sous laquelle l'émail translucide de la mer s'éclaire de teintes vertes et brillantes, appliquées à larges coups de pinceau. Le vent souffle de terre, et les brisants bruissent faiblement. Le flot se retire, sur le sable luisant d'humidite; des bandes de mouettes le suivent pas à pas dans sa retraite, picorant les débris organiques qu'il délaisse, et voletant par instants comme des flocons de neige dans le tourbillon d'une rafale.
Au loin, des niasses grises se meuvent: au cours de leur incessante croisière, de leur garde assidue et périlleuse, les bâtiments de l'escadre tour à tour émergent de la brume ou s'y replongent.
Vers la gauche, au pied de la ligne des dunes qui fuit en s'ahaissant jusqu'à s'effacer dans la grisaille indécise de l'horizon, une large nappe sombre se déploie à perte de vue sur la surface de la grève découverte par la marée. Une division d'armée belge, massée, attend d'être passée en revue par le roi. Spectacle solennel à celte heure!
D'entre les villas, un groupe de cavaliers s'avance, et descend sur la plage, le roi en tcle, coiffé du casque et revêtu de la longue capote kaki; puis la reine en amazone noire, les princes Léopold et Charles-Théodore montant des double-poneys fringants, et les officiers de la Maison militaire. La petite princesse Marie-José et une suite de quelques personnes escaladent une dune, d'où elles embrasseront du regard l'ensemble du tableau.
Le vent souffle avec force. Il emporte en ondes successives les sons de la brabançonne, qu'il enfle ou qu'il étouffe, cependant que le roi et le groupe des cavaliers galopent le long des rangs de la Division. Ils se fondent au loin dans la brume. Des accents cuivrés continuent à sonner, et parviennent inégalement. Plusieurs avions survenus décrivent à faible hauteur des courbes élégantes; leurs moteurs strident rageusement lorsqu'ils avancent vent debout.
Le groupe des cavaliers reparaît, et gagne l'emplacement désigné d'où le roi, posté en avant de tous, surveillera le défilé; à peu de distance de lui, deux porte-fanion jalonnent la direction.
Pendant ce temps, les troupes se sont formées en lignes de colonnes de pelotons, formation de manœuvre extrêmement souple, mais peu favorable à la rigidité et à la régularité d'une marche de parade. Le général commandant la Division, et son Etat- major, se joignent au groupe royal. Une musique entonne la marche d'un régiment, et le défilé commence.
Vu de haut, il paraît impeccable: fantassins au pas ferme et solide, voitures de munitions et sections de mitrailleuses, batteries d'artillerie aux attelages puissants, cavaliers la lance haute et galopant sur deux rangs doublés. Un officier au brassard ponceau, le sabre au clair, file au triple galop pour porter un ordre. Est-ce la silhouette classique du cheval en mouvement? Est-ce la bour-guignote qui eoiffe l'officier? Je revois les anciennes gravures figurant des batailles rangées, où, parmi les escadrons de gens d'armes disposés en carrés, courent des guerriers également casqués et l'épée au clair, montés sur leurs destriers de combat à la croupe large, à la forte encolure. Je me rappelle qu'ici même Farnèse, duc de Parme, — le cauteleux Italien comme le qualifiaient ses ennemis, qui fut le camarade d'enfance de Philippe II et de don Juan d'Autriche, le vainqueur de Lépante, — fit parader trente mille hommes échelonnés entre Nieuport et Dunkerque; il les tint là six mois durant, prêts à embarquer sur les galions de l'Invincible Armada, et, après le grand naufrage, il les emmena assiéger Berg-ob-Zoom.
Aujourd'hui, le panache a disparu des cimiers. Tout se fait volontairement terne et gris; seul l'éclair bleu de l'acier des baïonnettes luit au-dessus des files de fantassins, et décèle la force latente prête à jaillir au premier signal.
Les dernières revues de troupes belges auxquelles j'avais assisté, voici un an, m'avaient laissé une singulière impression de réconfort, après les affres de la retraite et des grandes luttes d'octobre et de novembre. Les soldats de l'Yser avaient déjà récupéré l'effrayante dépense d'énergie qu'ils avaient fournie.
L'attitude, l'allure de la Division que je vois révèlent bien autre chose.
Je ne parlerai pas de l'outillage, où rien ne manque, où rien ne cloche; cela, c'est le côté purement matériel, et l'on y a pourvu. Mais ce qui mérite surtout de retenir l'attention, c'est le fait que cette Division d'armée apparaît surtout comme une Unité. Chaque bataillon, chaque batterie, chaque escadron, s'adapte si parfaitement aux autres dans les mouvements, dans l'action de l'ensemble, que l'on ne conçoit pas à chacun de ces organismes séparés une existence individuelle: ils sont les éléments d'un seul et vaste tout, où ils se fondent harmonieusement par la vertu d'une pensée unique. Ils sont l'Ordre, d'où découle la Force.
Le général qui commande cette division la mène d'une poigne exceptionnellement vigoureuse, et avec une inflexible énergie. Son œuvre est la réalisation d'une volonté de puissance. Cette volonté a pénétré ses hommes jusqu'au dernier. Elle réagira sur la compagnie lancée à l'assaut, sur l'escouade tapie dans son poste d'écoute, sur la sentinelle perdue au-delà de l'avant-ligne. Elle actionnera, de ce corps qu'elle anime, les muscles qu'il faudra, pour porter, au moment et au point choisis, les coups nécessaires, et tous concourront pour que chaque coup soit porté avec le maximum d'effet ulile. Cela, le spectateur le moins prévenu le lit aujourd'hui sur la grève.
Ah! certes, nous voilà loin des revues qui se passent devant des tribunes drapées de velours rouge à crépines d'or, bondées de rutilants uniformes, de femmes élégantes et de diplomates chamarrés. Mais combien celle-ci est plus émouvante, plus près de l'action, dans sa simplicité grandiose, dans le cadre dramatique de ce lambeau de royaume, dont de l'Est à l'Ouest le même regard embrasse les limites, et où se dresse invaincu, droit sur sa selle, ce roi, « parangon d'honneur », aurait dit Bayard qui eût aimé le sacrer chevalier un soir de bataille.
En lui plus que jamais, à cette minute, s'incarnait la patrie belge, et les milliers de regards, que fixaient fièrement sur lui les soldats qui défilaient, disaient:
— Salut, ô roi! Salut, ô patrie! Ceux qui sont prêts à affronter la mort pour toi te saluent.
Et ce n'était pas une réminiscence classique d'un caractère purement littéraire. A quelques pas de là, sur les rails du « vicinal », dix locomotives fumaient, attelées à dix rames, où, sitôt la revue terminée, la plupart de ces hommes s'engouffraient: elles les emmenaient sur l'heure vers les tranchées de première ligne.
…
Chapitre XVIII : La Douche
l'Eau Vivante
A la vérité, l'inondation, telle que nous la pratiquons en Flandre, constitue une septième arme. Ceux qui en ont la direction la manient avec une incomparable maestria. Elle ne s'étale pas, en effet, en nappe d'eau immuable, mais se montre d'une incroyable mobilité. Son niveau s'abaisse ou s'élève; elle se retire d'ici, où on la croyait fixée, pour s'infiltrer un peu plus loin, où on ne l'attendait pas. C'est un perpétuel mouvement.
Elle est vivante. Elle est une bête de proie, une immense et fantastique pieuvre, une nouvelle hydre de Lerne. Elle allonge ses tentacules ou les rétracte. Elle s'empare d'une proie, et quand elle l'a tuée, l'abandonne, épave noyée sous les viscosités de son limon. Elle est le danger sournois, imprévisible; elle peut produire, à la volonté de ses maîtres, des effets terribles. Constatons-les, sans rechercher les cafuses premières, ni les moyens.
La légende d'Ys l'Engloutie est transposée clans la réalité contemporaine.
Les Boches viennent d'en faire une fois de plus l'expérience à leurs dépens.
La Surprise
Les maîtres des Eaux avaient, si l'on peut dire, fait leur plein. Et ce plein, à quelques bidons près, équivalait à une capacité de plusieurs millions de mètres cubes d'eau. Un beau jour, ou une belle nuit, quelque part entre la mer et Dixmude, une digue crevai comme par hasard, au moment et à l'endroit les plus propices. La crevaison portait sur une respectable longueur de remblai, et, par cette brèche, les quelques millions de mètres cubes d'eau accumulés se précipitèrent.
Avec une intelligence louable et un sens de l'opportunité méritoire, ils prirent incontinent la direction des tranchées ennemies. Ils en noyèrent une première, puis une deuxième, et, ralentissant leur course, une troisième. De la première tranchée, les observateurs ne virent sortir personne; de la deuxième, presque personne; et, de la troisième, quelques Boches empêtrés dans l'eau et la boue, glissant, trébuchant, barbotant lamentablement.
Tout leur matériel, tous leurs engins de tranchées, lance-bombes, crapouillots, lance-torpilles, voire quelques canons, m'a-t-on certifié, demeurèrent la proie des eaux.
Quant aux sujets du Kaiser qui burent là leur dernier verre de limonade, on en ignore le nombre. Ce qu'il y a de sûr, c'est que, pour corser le total, les maîtres des Eaux avaient pris une ingénieuse précaution: pendant les quarts d'heure qui précédèrent immédiatement l'instant propice où se produisit l'événement qui creva la digue, nos canons entrèrent en danse, et bombardèrent avec entrain les tranchées allemandes: leurs occupants, comme cela se pratique en pareil cas, se terrèrent dans leurs abris afin de se garantir des obus.
Et les obus pleuvaient toujours lorsque le torrent d'eau dévala. De sorte que, presque seuls, les hommes de la troisième tranchée bénéficièrent du répit nécessaire pour évacuer leurs abris et échapper à la noyade.
L'énorme apport de cette masse liquide, une fois étalé, eut pour effet de surélever notablement le niveau de l'ancienne inondation, d'en augmenter la superficie, d'en étentre les tentacules autour de positions ennemies qui y avaient échappé jusque-là. L'eau recouvrait tout son ancien domaine, du temps où le chevalier de Langeron s'y embarquait sur des chaloupes et des canonnières, avec les marins et les soldats du roi tirés des vaisseaux et des galères de Dunkerque, pour couper les communications des Impériaux. Ce à quoi il réussit parfaitement.
Pendant que le drame se déroulait, nos gens, au guet dans les postes d'écoute ou dans les tranchées, le long de la ligne, entendirent cette nuit-là des clapotis insolites, quelque chose comme le bruit d'une marée qui monte. Ils s'étonnèrent: ils ignoraient tout de l'aventure. Des mesures rigoureuses avaient assuré le secret sur les préparatifs de lopération; il fut bien gardé, et l'opération réussit.
A la suite de quoi, pendant un temps appréciable, nos hommes jouirent d'une certaine tranquillité dans ce secteur.
Les eaux ont repris leur calme habituel sur leur domaine agrandi. Les bouquets d'arbres dépouillés de feuilles, les bâtiments des fermes en ruines émergent un peu moins haut que par le passé. Les oiseaux de marais, abondants malgré les continuels feux d'artillerie, sillonnent à angle aigu le miroir liquide qui reflète un ciel gris, chargé de brumes et de nuages. Les corbeaux, plus philosophes ou plus prudents, ont depuis longtemps déserté ces parages reconnus dangereux, et ne reviennent pas.
Sous l'uniforme et impassible surface glauque dorment désormais quelques cadavres de plus, à ajouter au chiffre fantastique de ceux qu'aura engloutis l'Yser... l'Yser, nom d'épouvante pour les oreilles allemandes, qui le recueillent dans la lugubre plainte du vent occidental.
…
Chapitre XIX : Un Raté
Ce que, d'un Observatoire, on peut voir d'une Attaque
Il y a quelque vingt ans de cela, si j'ai bonne mémoire, un de nos meilleurs humoristes publia un dessin qui portait pour légende: « La bataille de l'Avenir. » On voyait une immense plaine, nue, dévastée, sans un brin d'herbe. Au ciel, sur le sol, partout, d'innombrables obus éclataient. Et dans un coin du dessin, un officier d'artillerie, assis au centre d'une pièce étroite, manipulait des leviers et pressait sur des boutons.
Ce dessin avait la valeur d'une prophétie... d'une de ces prophéties rares, qui se réalisent. Il illustrerait avec une exactitude parfaite une action à laquelle je viens d'assister.
J'achevais de déjeuner, lorsque, avec la soudaineté habituelle à ce genre de manifestation, éclata une de ces invraisemblables canonnades dont un roulement de tambours donne, à une échelle infinitésimale, l'identique sensation. J'entendais l'éclatement des marmites allemandes, et les coups de départ de nos canons, dont la riposte avait été immédiate autant qu'énergique. Le tintamarre était tel, l'air vibrait, la terre frissonnait de telle sorte, que de toute évidence le théâtre de l'action était très proche.
Je gagnai un obesrvatoire d'où je pouvais embrasser du regard un large horizon, à peu près toute la superficie du terrain où il se passait quelque chose. C'était d'un côté la zone des dunes qui fuyaient vers l'Est, semées de petits groupes de maisons d'apparence intactes, vues à distance, mais que je savais en réalité avoir beaucoup souffert des bombardements méthodiques et continus de l'ennemi; d'un autre côté, la plaine flamande telle que la guerre l'a faite, des champs dénudés, des ruines de fermes isolées, des bouquets de végétation squelettique. Le tout se fondait à l'horizon en une grisaille faite de brume et de fumée.
Sur cette étendue, pas un être vivant n'apparaissait. Par rangées, de hautes colonnes de fumée noire montaient droites vers le ciel, aux points où les gros obus explosaient. Elles indiquaient les barrages que l'ennemi établissait pour arrêter ou tout au moins gêner les mouvements de nos réserves, auxquelles, en l'espèce, il ne fut pas nécessaire de recourir.
Le tintamarre dura deux heures environ, et cessa subitement, comme il avait commencé. L'affaire était terminée. Déjà les automobiles d'ambulances apportaient les premiers blessés, qui recevaient des soins immédiats., dans les meilleures conditions. On en compta de notre côté un chiffre minime. Quant à l'ennemi, il ne put prononcer son attaque, préparée avec une débauche de projectiles.
Ce fut, dans toute la force du terme, un « raté ».
Nous avons reçu environ 20.000 projectiles; nos batteries ont riposté avec une libéralité notoire. Le tout en moins de deux heures de temps. Ceci donne une idée de l'intensité du « roulement de tambours ».
Le lendemain matin, à l'heure où la première pointe de l'aube teinte de lumière l'horizon oriental, les Boches, pour se venger de leurs échecs, ont, suivant leur tactique constante en pareil cas, envoyé leurs taubes semer au petit bonheur des bombes sur les localités sises immédiatement en arrière des lignes.
Ce n'est pas encore de cette graine-là que germera pour eux le laurier de la Victoire.
…
Chapitre XX : Gens De Mer
La Maison dans la Dune
Les petites maisons basses sont tapies dans les dunes. Elles s'abritent de leur mieux parmi les monticules de sable contre le grand souffle du vent. De ci, de là, un arbre maigre cherche à s'élever; mais dès qu'il dépasse une certaine hauteur, dès que sa ramure s'épaissit, il donne prise aux rafales qui le courbent, et puis le brisent. Des arbrisseaux touffus, épineux, résistants, garnissent les creux du terrain, où, dans l'humidité que retiennent les sables, des plantes vivaces poussent et fleurissent.
Des enclos entourent les maisons. Les haies sont renforcées de rideaux de paille pour arrêter l'ensablement. Cela forme de petits rectangles où, à grand renfort d'engrais humain et de poisson pourri, on fait pousser des pommes de terre et, lorsque le sol s'est enrichi suffisamment, des choux et des poireaux. Encore faut-il disputer ces piètres récoltes aux lapins qui pullulent dans la dune.
Les petites maisons s'encapuchonnent de grands toits, à cause des pluies fréquentes et ahondantes. Une couche de lait de chaux souvent renouvelée leur donne un air pimpant; elle souligne d'une raie blanche les arêtes des toits; les linteaux des fenêtres, les chambranles des portes sont peints de bien, de jaune ou de rose; les volets sont rayés de vert et de blanc comme la barrière d'entrée. Aux fenêtres à petits carreaux, des embrasses relèvent les rideaux blancs sur des pots de géraniums alignés.
La plus grande partie de l'année, le ciel bas semble vouloir écraser les maisons qui se font toutes petites sous la menace, et se perdent dans l'immensité des sables. Les hommes qui les habitent se perdent, eux, dans l'immensité des eaux, car, mi- pêcheurs, mi-cultivateurs, beaucoup vont à Dunkerque s'engager pour la campagne d'Islande. Ces gens mènent une rude existence. Il y a, tout contre la frontière, une de ces maisons où j'entre parfois. Le décor intérieur est toujours le même: un poêle de fonte aux ornements de cuivre ou de nickel, une table, des chaises de paille, un meuble, tout cela astiqué, net, luisant. Sur le plancher de bois blanc ou le carrelage de terre rouge, suivant le cas, quelques poignées de sable fin renouvelé tous les matins. Aux murs, dans des cadres, des images rappelant une première communion ou le temps de service à bord d'un cuirassé, et des diplômes illustrés d'une médaille. Sur la cheminée, des globes de verre protègent contre la poussière des vases peints à fleurs et des statuettes hautement coloriées, et se font pendant de chaque côté d'une pendule en bronze doré. Disséminées, des photographies aux tons passés représentent des personnages endimanchés à l'ancienne mode, parmi d'autres plus récentes. Décoration naïve qui convient à des âmes simples: des âmes simples, droites et fortes.
l'Absent
Le visage de la vieille femme qui va et vient dans la pièce a pris l'immobilité du masque de la résignation. Elle va et vient, car elle travaille toujours à quelque chose. Son vieux mari s'emploie désormais au chemin de fer. Ses garçons et ses filles sont mariés, sauf le dernier, le Benjamin. Celui-là, je le connais, le jeune gars bien découplé, à l'œil intelligent et vif, à la parole douce, au bon sourire. Il porte le béret au pompon rouge et le grand col bleu. Il a été enrôlé lorsque la guerre fut déclarée, et, son instruction militaire terminée, versé dans l'immortelle Brigade. Il n'est pas loin d'ici, a Nieuport. Lorsque son bataillon vient au repos à Coxyde, il galope quelques kilomètres par le chemin des contrebandiers qui est direct, embrasse sa vieille maman, avale une tasse de café, emporte quelque douceur, et se sauve.
C'est de lui que nous parlons. De qui parler sinon de lui? Le vent fait rage; les grains de sable volent et piquent la figure comme autant de pointes d'aiguilles. En trombe, voici l'averse oblique dont les grosses gouttes gifflent la joue, l'eau qui trempe et alourdit les vêtements. Le poêle ronfle par saccades; la maisonnette tremble sur sa base; les fenêtres ont des frémissements, comme si une invisible main les secouait furieusement pour les ouvrir, pour les arracher de leurs gonds.
Comme ce café qui mijote sur le feu réchaufferait Je gars dans sa tranchée! Il est si près d'ici! Comme toujours, le canon tonne; on l'entend, c'est le cas de le dire, comme si l'on y était. Chaque coup retentit douloureusement dans le cœur de la vieille maman. Car c'est affreux, n'est-ce pas, de devoir se dire à chaque coup: « Est-ce que celui-là n'a pas fait de mal à mon fils? Est-ce que celui-ci n'a pas déchiré la chair de ma chair? » Vous imaginez-vous pareille angoisse?
Une nuit, à l'heure de la relève, une balle lui effleura le dessus de la tête. Littéralement, elle lui fit la raie, une raie rouge. Il en fut quitte pour trois semaines de repos.
Maintenant, la Brigade est dissoute. La maman a reçu des cartes postales illustrées. Je n'ai pas été oublié non plus. Ces cartes représentent un port, des navires, des maisons, et les murailles de fortifications antiques sur la hauteur. Le ciel est colorié d'un bleu intense. Les personnages ont une allure exotique. C'est Malte. « Ici, c'est déjà l'été de Flandre », écrit le jeune marin: or, par le chemin que j'ai suivi pour venir, serpentant à la lisière des dunes et des polders, nul bourgeon ne pointait encore aux branches des haies et des arbustes rares. Mais il ne se laisse pas éblouir par « le carton du décor ». S'il a la curiosité de ces pays nouveaux à ses yeux, comme le doux Albert Samain il garde tout son amour pour sa terre de Flandre.
Désormais, sa mère sourit en évoquant son souvenir. L'inquiétude de l'absence n'est rien auprès des tourments des mois précédents. Je suis son regard qui s'arrête fréquemment du côté de la cheminée. Contre l'un des globes s'appuie une photographie que je n'avais pas encore vue; c'est un portrait du petit gars et, à côté, une croix de guerre. Il vient d'envoyer les deux à sa maman.
Et je lis la citation suivante, signée du capitaine de vaisseau Mauros: « Excellent soldat. Grand ascendant sur ses camarades. Placé à un poste particulièrement visé par le 57 ennemi, poste où il exerçait les fonctions de veilleur, a continué à remplir ses fonctions avec le plus grand calme. »
Mon jeune ami est modeste. De cette citation, de cette croix de guerre, il ne m'avait jamais soufflé mot.
Au Retour d’Arkhangel
Vous connaissez la vieille estampe qui représente le retour du marin? On la rencontre rarement dans nos maisons de France, mais très souvent aux murs des cottages d'Angleterre. C'est un de ces sujets qui plaisent à la sentimentalité populaire. Des vieux, des très jeunes, des femmes qui tricotent, groupés au coin du feu, sous la lampe, écoutent avec un intérêt passionné les récits de celui qui revient des pays lointains, des pays que l'on n'a vus qu'en imagination ou en images dans les livres, et que conte celui-là qui a vécu l'Aventure.
Cette scène, je l'ai contemplée tout à l'heure en entrant dans la petite maison tapie parmi les dunes. Il y avait là le vieux et la vieille, noueux comme des chênes, solides encore malgré les quatre-vingts ans passés: le vieux avec un anneau d'or au lobe de l'oreille et la courte pipe de terre culottée entre les dents; la vieille, fidèle au petit bonnet qu'elle portait dans sa jeunesse. Il y avait des jeunes femmes. La marmaille était à l'école, et manquait. Au centre, captivant l'attention, un homme de trente-cinq à quarante ans apparaissait dans la plénitude de sa force; chacun de ses gestes faisait jouer des muscles durs, qui tendaient à la craquer l'étoffe de son vêtement. Il était en habit bourgeois, et sa femme en toilette de ville; la veille on avait enterré sa belle-mère, morte comme il arrivait en permission.
— Je reviens de la Mer Glaciale, me dit-il. Mon bateau est en réparations, et, j'ai huit jours à passer chez moi. Je montais un cargo de 2.000 tonnes, J’ai fait quatre fois le voyage d'Arkhangel, où j'ai même hiverné. Quel froid! Nous avons eu quarante-cinq degrés sous zéro. Au début, nous n'avions que nos vêtements de France; mais nous avons réclamé, et on nous a donné les vêtements fourrés des soldats russes. J'avais doublé les cloisons de ma cabine et installé un poêle. Comme cela, je n'ai pas trop souffert. Mais tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Il a fallu en couper, des membres gelés, des bras et des jambes! Sans compter les équipages qui ont débarqué en cours de route sur un point de la côte, et qu'on a retrouvés, morts de froid! C'est curieux, cependant: sur la côte de Kola, il y a des parages où la mer ne gèle jamais, et quand on a jeté l'ancre et qu'on la relève, elle est chaude.
Il passe à un autre ordre d'idées:
— Il y avait le danger des sous-marins et des mines. Mais nous ne partions jamais deux fois de suite du même port, et nous ne faisions jamais deux fois de suite la même roule. Et puis, on ne passait pas un jour sans renconter un croiseur auxiliaire, qui nous protégeait. N'empêche que le cargo en compagnie de qui nous naviguions habituellement a sauté. Il a dû donner sur une mine.
— Et les Russes?
— Les Russes vous achètent couramment un litre d'eau-de-vie cinquante roubles. Ils déclarent qu'ils ne savent pas si après la guerre ils seront Russes, ou Boches, ou n'importe quoi, que cela leur est égal, mais que ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils feronl la révolution.
Et il en revenait à son impression la plus vive:
— Mais quel froid! Pensez donc: quarante-cinq degrés sous zéro!... Et ma belle- mère qui meurt pour mon arrivée!
On croirait presque que la pauvre femme a joué ce dernier tour à son gendre, pour lui gâter le plaisir de sa permission.
…
Chapitre XXI : Les Beaux Jours Revenus
Printemps Mouillé
La végétation a un bon mois de retard sur les années précédentes. Les premiers bourgeons, les premières pousses ne se montrent que fin avril, et avec quelle timidité! On dirait qu'ils craignent un retour du froid, qui arrêterait leur essor et grillerait les feuilles frêles.
L'eau tomba en telle abondance depuis l'automne dernier que la terre ne parvient pas à l'absorber. Les germes que l'on confie au sol pourrissent. Il fallut planter jusque par trois fois les pommes de terre. Et dès que les premiers semis levèrent dans les jardins, d'innombrables et minuscules limaces grises dévorèrent tout au ras du sol. On dut replanter, resemer, et plusieurs fois le jour, surtout à l'aube et au crépuscule, se livrer à une chasse acharnée de ces bêtes visqueuses et difficiles à découvrir. A la surface de la terre apparaissent des plaques bleuâtres, qui demeureront infertiles.
On dirait parfois que la nature se plaît à ajouter aux maux de la guerre.
Enfin le soleil s'est montré, timidement. La lumière délicate de cette saison et de ce pays vêt de teintes harmonieuses et tendres les arbres et les maisons, les dunes et la plaine. C'est bien le renouveau des choses, et ce serait le renouveau des êtres sans l'affreux cauchemar qui pèse sur tous. Quelques bouquets blancs et roses commencent à pointer aux branches des poiriers et des pommiers, mais inégalement, et sans celte unanimité de floraison qui fait habituellement leur splendeur à cette époque de l'année.
Les hirondelles viennent seulement d'arriver de leur lointain voyage. Elles s'affairent dans le ciel avec de petits cris joyeux. Les grenouilles leur donnent la réplique. Ces sympathiques batraciens sont sans doute dans la joie de leur domaine agrandi. L'eau forme dans les pannes des dunes de véritables étangs, limpides et peu profonds; les ruisseaux par où ils se déversent vers l'intérieur des terres, à sec dès le mois de mai les autres années, ne le seront pas encore au mois d'août; venant du canal, des épinoches les remontent, que poursuivent les gamins du hameau avec de vieilles boîtes de conserves transformées en aquariums. Et dès que tombe le soir, le chœur des grenouilles s'élève avec une ampleur et une continuité qui font supposer un pullulement inaccoutumé, ou la tenue d'un exceptionnel parlement.
Sous les Cerisiers en Fleurs
Le 30 avril, Dimanche de Quasimodo. Pour la première fois, une journée vraiment radieuse. Sous les cerisiers en fleurs, on installe les fauteuils de jardin et la table à thé. Des fleurs et du soleil... quelle joie! Un parterre de violettes embaume, et bientôt ce seront les roses. On devise entre amis, et quelqu'un dit:
— C'est le dernier jardin où l'on cause.
Un peu plus lard, lorsque les capucines auront grimpé et les feuillages épaissi, on s'y trouvera complètement isolé. Aujourd'hui, on voit encore la roule; le petit tramway trotte avec un air de fête; les gens marchent à pas comptés, engoncés dans leurs beaux habits des dimanches. Le canon tonne. D'heure en heure, la purelé du ciel bleu est mouchetée de shrapnells. Les avions des deux partis sont en mouvement. Cette activité maintiendra dans notre région les effectifs en présence, tandis qu'ailleurs se livreront de grandes batailles. Mais nous ne cesserons de voir sur la route ces cortèges d'uniformes, où des musiques militaires jouent des airs plaintifs, où un drapeau couvre les bières que l'on emporte vers le cimetière.
Sous les cerisiers fleuris, on devise entre amis... et alliés, c'est le cas de le dire: des Belges, des Anglais, des Français, de tout un peu, réunis là par la guerre, gens de poil, de plume et d'épée, des militaires de carrière et des militaires d'occasion qui s'en seraient bien passé, des infirmières, une aimable romancière toujours en retard parce qu'elle et ses papiers ne sont jamais d'accord avec le gendarme du coin, et qui réunit les éléments d'un ouvrage fortement documenté sur la bataille de l'Yser. On discute le livre du jour ou le Salon de peinture de La Panne. On s'efforce de ne pas parler de ce qui est l'unique préoccupation de tous..., mais en vain. On se communique les nouvelles: chacun cherche sans conviction la confirmation de celle qu'il apporte, à peu près résigné à ne savoir la vérité sur les événements contemporains que dans une cenlaine d'années d'ici. Et l'on conte des anecdotes. L'un dit:
— Je viens de recevoir une lettre de Rome. Voici ce qu'on m'apprend: le prince de Bulow assistait à une réunion mondaine où la V., la célèbre danseuse belge, exécuta la Piémontaise avec un tel brio que le public enthousiasmé, en délire, réclama la Brabançonne. A la première mesure de l'hymne national le prince de Bulow, vexé, se retira en maugréant: « Cette V.! avec ses jambes, elle en fait plus pour la cause de la Belgique que D. avec ses grosses moustaches. »
Anecdocte diplomatique que l'on eut certainement grand plaisir à colporter dans les salons romains, et qui garde encore sa saveur sous le ciel de Flandre.
Un aumônier lourd,— c'est-à-dire appartenant à un groupe d'artillerie lourde, — qui cantonna quelque temps ici, conte avec verve quelques-unes de ses impressions de guerre. Il professait le flamand dans une maison d'éducation; rien ne l'avait préparé à ses fonctions actuelles, y compris l'équitation, son major ayant déclaré péremptoirement ne pas vouloir d'un aumônier qui ne saurait pas monter à cheval. Et l'aumônier lourd s'en est tiré avec souplesse et légèreté.
— Le grand diable que vous avez vu manœuvrer les crapouillols devant Dixmude, me dit-il, s'appelle Lignon. C'est un gaillard qui n'a pas froid aux yeux. A lui seul, il a beaucoup gêné l'avance des Allemands au début de la campagne. A Liège, monté dans son bachot et aidé de trois camarades, il s'arrêta chaque jour sous une arche du pont, à la barbe de l'ennemi. Il y creusa peu à peu un trou de mine. Il fit sauter le pont. Et comme il n'avait pas épuisé sa provision de dynamite, avec le reste il fit sauter un vicinal chargé de troupes. Après quoi il rejoignit son corps. En sa qualité de Wallon, il jurait en flamand; je ne sais si vous avez remarqué cette particularité, mais c'est un fait: les Flamands jurent en français, et les Wallons en flamand!
Comme on parlait de l'endurance au mal dont certains hommes sont capables, à un point souvent extraordinaire, mon ami Gaston L... cita un fait. Gaston L... est officier de zouaves, engagé à l'âge de 46 ans dès le début de la guerre, et en dépit de cinq blessures, il n'a rien perdu de son énergie.
— Le plus étonnant que j'ai vu, dit-il, est un Joyeux. Un obus lui emporte le bras. Il reste sur place, indécis; son lieutenant l'engage à aller au poste de secours, mais voyant l'homme les yeux chavirés et prêt à tomber, il lui verse une sérieuse rasade de gnole. Ranimé, le Joyeux se baisse, ramasse avec son bras valide celui qu'il a perdu, et par-dessus le parapet le lance dans la tranchée boche en criant: « C'est tout ce que vous aurez de moi cette fois-ci. » Après quoi, il va se faire panser.
Un autre cita ce beau trait d'un général anglais: le général français M. lui faisait visiter un secteur; l'Anglais était d'une taille fort au-dessus de la moyenne; à un certain passage de la tranchée, le général M. lui dit:
— Ici, mon général, le parapet n'est pas assez surélevé, et, en face, il y a une mitrailleuse braquée. Il faut vous baisser un peu.
L'Anglais sourit:
— Si c'était chez moi, je baisserais; mais ici..., je peux pas.
Et redressant sa haute taille, il passa sans se presser.
Les canons contre avions tiraient avec une certaine intensité sur un taube qui se rapprochait.
— Il faut, observa le docteur B..., se méfier autant de ce qui retombe que de ce qui tombe. A sept ou huit kilomètres de Steenstraate, nous cassions une croûte au bord de la route; l'un de nous s'affaisse soudain, vomissant le sang: une balle de mitrailleuse tirée par quelque avion venait de lui traverser les poumons.
Cette réflexion mit la conversation sur l'étonnante fantaisie de certains projectiles. On rappela qu'un des jours précédents, à Fumes, un 150 entra chez le parfumeur de la Grand'place, voisin du pharmacien, pénétra par effraction dans une caisse contenant pour 6.000 francs de parfumerie, puis trôna le mur mitoyen, si bien que jamais l'officine du pharmacien n'exhala d'odeurs aussi suaves. Mon ami, le lieutenant belge M..., ajouta:
— Il n'y a pas longtemps, je conversais avec mon commandant. Il sentit quelque chose qui lui soulevait le pied; il regarda: un 77 venait de se ficher en terre sous son talon, sans éclater. Mais la plus drôle est arrivée au commandant d'artillerie N..., tandis quil commandait par téléphone le feu d'une batterie: un obus allemand pénétra dans son abri, et, sans éclater, s'enfonça dans le sol entre les quatre pieds de la table sur laquelle le commandant téléphonait. D'instinct il cria dans le téléphone: « Cessez le feu! »
Alors, à propos d'une branche fleurie du cerisier que la brise balançait, la causerie s'orienta sur les mérites de l'art japonais.
Les gens endimanchés continuaient à passer sur la route à pas comptés, le petit tramway à trotter allègrement avec un air de fête, les canons à tonner vers Nieuport, et les shrapnells à moucheter de blanc le ciel bleu.
Chapitre XXII : Passages d'Avions
Le Rossignol Chante
Le soleil s'était couché dans une apothéose printanière, rosissant la cime des peupliers au feuillage naissant, et découpant à contre-jour la ligne onduleuse des dunes, sombre sur le ciel clair. Une brume montait de la terre humide des polders, mais un coup de brise souffla, dissipant les vapeurs ténues, et la nuit s'était faite claire, étoilée, magnifique.
La lune ne devait se lever que passé minuit. Après la canonnade habituelle de la journée, la rumeur sourde et lointaine qui signale la vie nocturne des armées au front ne troublait pas ce soir-là le silence répandu sur la plaine flamande.
En cette minute d'apaisement délicieux, un rossignol chanta. La douce mélodie détendit les nerfs; l'âme un instant s'abandonna.
Ce ne pouvait être pour bien longtemps.
Voici que la note soutenue et grave des moteurs emplit l'espace, grandit, et fait vibrer les ondes de l'air. Par magie, des gerbes de faisceaux lumineux éblouissants jaillissent du sol, fouillent la profondeur du ciel où ils déversent une clarté laiteuse et diffuse, se cherchent, se croisent, s'écartent, se recoupent comme s'ils jouaient aux quatre coins. Des fusées montent et s'épanouissent en pluie de feu, confondant leurs étincelles avec les éclairs d'innombrables shrapnells aux éclatements moins inoffensifs. Les canons de la défense aérienne tirent à coups précipités, les mitrailleuses claquent éperdûment, les poms-poms dévident leurs chapelets de grains meurtriers. L'air est zébré de métal. Une détonation plus violente et plus sourde indique qu'une bombe vient de tomber.
Chose étrange : à chaque pause de l'infernal concert, si, ne fût-ce qu'une demi- minute, le vacarme cesse comme pour reprendre haleine, les notes de cristal pur, les trilles du rossignol chantent toujours, chantent sans arrêt, avec une netteté, une sonorité, une acuité surprenantes.
Est-ce un défi de la nature à l'homme? Est-ce une ironie? Est-ce une affirmation que de la brutalité bestiale triomphera toujours la divine harmonie?
l'Épave
Le lendemain, au petit jour, sur la vaste grève, l'eau de la marée montante couvrait peu à peu une épave, un avion ennemi touché par les nôtres, et tombé là. Le canot de sauvetage tenta de le ramener, sans succès; car le poids de l'épave était trop lourd. On ne put cette fois que sauver quelques agrès, et lever suffisamment une aile pour prendre le numéro de la machine abattue.
A la pleine mer, un petit remorqueur et deux barques réquisitionnées reprirent la besogne, soulevèrent l'avion, et réussirent à le conduire aussi près du bord que le permit leur tirant d'eau. La marée descendante échoua définitivement l'épave qu'elle abandonna sur le sable, avec l'air piteux d'un oiseau mouillé, aux ailes disloquées.
Tout d'abord, on ne découvrit nulle trace des aviateurs. Plus tard, le Ilot rejeta leurs corps. On supposa qu'ils avaient essayé de se sauver à la nage.
Le Combat Invisible
L'heure indécise où un peu de jour s'attarde dans le ciel clair, où pointent timidement les premières étoiles.
Des détonations ouatées vers l'Est, très haut, très loin. Des crachements de mitrailleuses. Nos avions-canons et mitrailleurs patrouillaient à grande altitude: ils attaquent, à leur passage au-dessus de la mer, devant notre rivage, une bande d'avions ennemis en route vers Dunkerque.
Le bruit du combat se déplace vers l'Ouest, puis cesse. En même temps, une vigoureuse canonnade se déclenche, un roulement de tambour ininterrompu. Nous distinguons les éclatements, en gerbes.
Pendant cet entr'acte, devant nous, des l'usées de couleurs s'allument dans le ciel, ici, pais là, comme si des étoiles se détachaient et s'éteignaient en tombant dans l'éther.
La canonnade se rapproche, poursuivant l'ennemi qui revient, pourchassé, dispersé. Nouveaux poms-poms des avions-canons, nouveaux crachements des mitrailleuses. On ne peut rien distinguer dans la pénombre du soir tombant; il y a quelque chose d'angoissant à savoir que là, sous nos yeux sans que nous en puissions rien voir, se déroule le drame épique d'un combat aérien.
Le bruit s'éloigne vers l'Est. Des profondeurs du ciel s'entendent alors en crescendo des ronflements de moteurs. On devine, puis on perçoit des ombres grandissantes, énormes chauve-souris qui filent à faible hauteur, et regagnent le champ d'aviation où des signaux convenus les appellent. Nous apprenons le lendemain que les Boches ne sont pas sortis indemnes de l'aventure.
D'autres bourdonnements vibrent toujours, atténués: ceux des avions qui cette nuit montent la garde au-dessus de nos têtes, et qui poursuivent lentement leur croisière dans la nuit profonde.
…
Chapitre XXIII : La Triple Rencontre
Le Marin
Un poilu disait:
— En guerre, on rencontre tout le monde partout.
C'est vrai. J'ajoute qu'à l'avant, ce Tout-le-monde offre un intérêt poignant.
J'en ai fait le même jour la triple expérience, à l'ombre du Jean Bart de David d'Angers, dont le geste, quelque peu emphatique, surprend aujourd'hui: au temps du maître statuaire, on ne concevait les héros qu'en des attitudes théâtrales; les nôtres nous ont habitués à plus de simplicité; leurs actions n'en paraissent que plus grandes.
Le voisinage de Jean Bart, sans doute, me valut la rencontre d'un marin. Le contre- amiral B... a toujours ce sourire bienveillant et fin, cette voix nette, ce regard vif et pénétrant que je lui connus jadis.
— Il faut un caractère comme le sien, m'avait dit un jour un officier placé sous ses ordres, pour maintenir l'harmonie et la bonne humeur à bord d'une de ces prisons flottantes que sont nos modernes cuirassés.
A ses qualités, notre marine doit d'avoir évité un désastre. Une torpille frappa le vaisseau qu'il commandait au cours d'une croisière dans l'Adriatique: grâce au sang- froid du capitaine, au calme et à la précision avec lesquels chacun à bord exécuta ses ordres, le bâtiment s'en tira si bien qu'il ne larda pas à reprendre la mer, après quelques réparations. On n'eut à déplorer d'autre perte que celle de deux serins, tués dans leur cage par la commotion; ces infortunées bestioles furent les seules victimes d'un accident qui eût pu coûter la vie à des centaines d'hommes.
Aujourd'hui, il y a plus de joie que de coutume dans le regard de l'amiral: la veille, il a présidé à une cérémonie infiniment touchante. Il a remis lui-même la médaille militaire à son fils, qui deux mois auparavant avait déjà reçu la croix de guerre.
Ce fils, pilote-aviateur, fait partie d'une escadrille qui s'est distinguée par des raids audacieux. Il a vingt ans. Un de ses camarades m'a conté le flegme avec lequel il descend à deux cents mètres au-dessus des positions ennemies, et comment les blessures qu'il reçut ne l'ont jamais empêché de recommencer.
On sortit les appareils des hangars, on les aligna sur le champ d'aviation. Les pilotes, les observateurs, les mécaniciens se formèrent en rangs, et dans ce décor, au bruit du canon qui tonnait à proximité, le père eut la joie et le juste orgueil de prononcer la formule sacramentelle: « Au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés... », de donner l'accolade à son fils, et d'épingler sur cette jeune poitrine l'insigne du courage militaire.
l'Infirmière
Ma deuxième rencontre de ce jour fut celle d'une infirmière-major, elle aussi gratifiée depuis peu de la croix de guerre. Elle appartient à l'une de ces grandes familles de France qui cumulent l'aristocratie de l'intelligence et celle du sang. La mort a surpris son père au poste de devoir que, malgré son âge avancé, il s'était assigné dès le temps de paix, et qu'il occupa jusqu'au bout. Son mari commande en Orient une de nos unités navales. Son jeune fils est au front. Elle-même n'a cessé de soigner nos blessés depuis le début de la guerre, dans l'Est d'abord, puis, dès la bataille des Flandres, dans le Nord.
La physionomie sérieuse et douce sous le voile et le bandeau illustré de la croix rouge que frangent des cheveux blonds, la voix égale, parfois un sourire au coin des lèvres et dans les yeux, elle parle avec une affectueuse commisération des soldats qu'elle soigne en ce moment.
— Ce ne sont pas de « glorieux blessés », dit-elle: simplement des accidentés. Ils n'en méritent pas moins notre sympathie, et ils ons autant besoin de soins que les autres.
Et comme j'évoque le souvenir des bombardements qu'elle subit:
— Le jour, cela ne m'impressionnait guère, même les 380, et je ne suis jamais descendue dans une cave. Mon souvenir le plus émouvant est celui d'un bombardement nocturne par avions, non pas, cependant, à cause du bombardement en lui-même, mais il survenait après une action assez sérieuse: nous avions reçu un certain nombre de blesses, dont beaucoup d'Africains; ces malheureux se croyaient échappés de l'enfer, et, impuissants devant le danger, incapables de se mouvoir, de se défendre, de se garer, voici que l'enfer les reprenait... les bombes explosaient autour d'eux, ils pleuraient, ils gémissaient... on ne pouvait pas ne pas être émue.
Ce que mon interlocutrice ne me dit pas, c'est sa crânerie devant le danger. D'autres, qui en furent témoins, n'avaient pas les mêmes raisons de m'en faire mystère.
Le Soldat
Ma troisième rencontre ce jour-là fut celle du colonel C... Les hasards d'un cantonnement de repos te ramenaient dans sa ville natale, dont depuis de longues années les obligations de sa carrière l'avaient tenu éloigné. Il venait d'éprouver la satisfaction de retrouver debout la maison qui vit ses premiers ébats, alors que la voisine ne formait plus qu'un tas de gravats.
Sec, nerveux, les traits accentués et énergiques, de la bonne humeur dans sa voix claire, le colonel C... apparaît le type vivant de l'officier français.
— Depuis la guerre?... J'en ai vu de toutes les couleurs, dit-il en riant. A la bataille de la Marne, un éclat me brisa les deux os de la jambre droite, et un autre les deux os du bras gauche. Les Boches me ramassèrent, et me transportèrent à une de leurs ambulances. Mon bras s'est remis tout seul. Quant à ma jambe, elle avait été cassée au même endroit quatorze ans auparavant; elle restait plus courte que l'autre, et courbe: ils ont si bien tiré dessus qu'ils l'ont rallongée et redressée; je m'en sers comme si de rien n'était.
L'ennemi, obligé de reculer, confia au colonel une centaine de blessés allemands, avec un médecin et trois infirmiers, se prévalant des bons soins qu'on lui avait donnés pour réclamer sa protection en leur faveur. Mais, à proximité, deux canons continuaient a tirer, sur lesquels le 75 se mit à taper avec son énergie habituelle.
— J'ai été à même de comparer nos explosifs et les leurs, dit le colonel. Incontestablement, les nôtres l'emportent: je n'eus que le temps d'attraper ma jambe comme je pus, de dégringoler de mon lit, et de me coller à terre, contre le mur de la fenêtre.
Sa convalescence terminée, on l'envoya aux Dardanelles:
— Certes, c'était dur... mais on avait toujours sur la tête le beau ciel bleu!
Et après les Dardanelles, il connut cinq mois de combats, sans repos, à Carency, à Notre-Dame-de-Lorette, à Souchez. La bravoure de ses hommes lui semble naturelle: ce sont des Français. Mais leur résistance aux conditions de vie où ils opèrent l'émerveille littéralement. Quant à lui, dangers et souffrances sont oubliés. Il a gagné la rosette, deux palmes à sa croix de guerre, et un galon d'or.
— Et avec ça, ma jambe est droite! conclut-il en tendant le jarret. Je n'ai pas à me plaindre!
Le marin, l'infirmière et le soldat: ces trois nobles figures incarnent à l'heure présente les plus hautes vertus de notre race. Le hasard venait, en un raccourci saisissant, de m'en offrir trois magnifiques exemples. L'atmosphère que l'on respire auprès d'eux, quoique parfois un peu trop chargée d'obus, est saine et vivifiante. Ils ne geignent pas parce que la guerre a quelque peu dérangé leurs petites habitudes. Ils ne répètent pas dix fois le jour que « c'est long », sans doute parce qu'ils agissent pour que ce soit plus court. Ils accomplissent leur devoir simplement, et avec bonne humeur. Ce faisant, ils sauvent le pays dans le présent, et en assurent la grandeur et la prospérité dans l'avenir.
Ce sont de bons Français.
…
Chapitre XXIV : l'Armurier d'Herstal
Le Doyen des Volontaires Belges
— Pourquoi, malgré mes soixante-cinq ans sonnés, je me suis engagé?... Parce que je suis antimilitariste!
Ainsi parle Barthélémy Merx, le vieil armurier d'Herstal, où il naquit le 27 janvier 1849. Il se présente sous l'uniforme de sergent au 9e régiment de ligne belge. El il explique:
— Je n'aurais jamais pris les armes si mon pays avait fait une guerre de conquêtes. Mais puisque les Allemands la font, puisqu'ils ont envahi mon pays, j'estime que mon devoir était de le défendre. Je me trouvais libre, veuf depuis vingt-sept ans, mes deux filles mariées et mères de famille, mon fils brigadier d'artillerie de place, rappelé comme milicien. Je n'avais aucune raison d'hésiter. C'est pour détruire la guerre que je la fais.
Je lui demande de me conter l'histoire de son engagement.
Le samedi 1er août 1914, les gens d'Herstal s'entretenaient avec animation des événements du jour, mais sans témoigner la moindre crainte que la paix fût troublée, au moins en ce qui les concernait. Ce sera comme en 1870, disait-on. Les souvenirs du vieux Merx ne pouvaient que le confirmer dans cette opinion. Il était à cette époque cavalier au 4e régiment de lanciers; toute la campagne se borna à quelques promenades dans la province de Namur. Donc, ce samedi soir, comme tout le monde il s'endormit tranquille. Le lendemain, à la lecture des journaux, il comprit que pour la Belgique aussi, c'était la guerre. Il prit immédiatement sa décision.
— Je vais m'engager, dit-il à un camarade.
n Qu'vieûsse fé là dou?... Veie biesse! n n Ce qui, en bon wallon, signifie: « Qu'irais-tu faire là, vieille bête! » Merx ne s'arrêta pas au compliment. Il rentra chez lui, fit ses préparatifs de départ, et communiqua sa résolution aux siens. Les larmes commençaient à couler; il brusqua la séparation.
Le lundi 3 août, il se présentait devant le commandant de place.
— Trop vieux, dit cet officier.
— Vieillesse n'a plus d'âge, répond Merx. Et le docteur qui le palpe et le visite prononce son jugement:
— Cet homme-ci a toujours vingt-cinq ans.
Merx obtenait gain de cause. Ne pouvant reprendre du service dans son ancienne arme, ne voulant à aucun prix partir comme milicien, il fut, suivant son désir, versé à l'armée de campagne, dirigé sur Malines, puis sur Lierre, et incorporé au 9e régiment de ligne. On lui offrit d'emblée les galons de sergent, puisque jadis il avait quitté le 4e lanciers avec ceux de maréchal-des-logis. Il refusa.
— Je veux les gagner sur le champ de bataille.
Et me montrant sa manche:
— J'ai tenu parole.
Il a plus de soixante-sept ans aujourd'hui; je l'examine, tandis que nous bavardons et qu'il fume son inséparable pipe: plutôt petit, le haut du torse large, une épaule légèrement inclinée, les traits accentués, le teint recuit, les mains puissantes, le corps solidement charpenté et musclé. De sa vie, pas une fois il ne fut malade. La chasse, sa passion, lui a fait des muscles d'acier, et lui garde son entraînement. Chaque jour, avant de se mettre au travail, il a déjà marché de longues heures. Il promène ses chiens si la chasse est fermée, ou bien, dans le cas contraire, il court après la plume et le poil, à moins qu'il n'aille guetter à l'affût le gibier d'eau. Bien entendu, ses journées de liberté sont entièrement consacrées à son sport favori, où il est infatigable.
La fatigue, il ne la sent pas encore après vingt-et-un mois de campagne. Ce n'est pas faute d'avoir mené dans sa rudesse la vie de guerre. Jusqu'à la chute d'Anvers, on l'affecta au service des patrouilles spéciales, de concert avec la gendarmerie. Pendant la retraite, à Ostende, la malechance voulut qu'il se foulât le pied, accident bête qui le priva du plaisir de prendre part à la bataille de l'Yser; évacué sur la Normandie, il rejoignit son dépôt dès que son état le lui permit, puis le front, où il continua le métier de patrouilleur, qu'il affectionne: ses goûts cynégétiques y trouvent leur compte.
Au mois de mars 1915, à la suite d'une patrouille particulièrement dangereuse qu'il mena à bonne fin, il reçut les galons de caporal, la croix de Léopold II avec palmes, et la croix de guerre. Presque aussitôt après, il prit part à l'attaque de la ferme Den Toren, et gagna ses galons de sergent. Il patrouillait avec trois hommes: un fut tué, deux furent blessés; seul, il s'en tira indemne, non sans avoir passé un assez vilain quart d'heure. Les balles lui sifflaient aux oreilles avec une persistance inquiétante; une fusée éclairante s'éleva; elle allait le désigner aux coups; il bondit dans un trou d'obus. Le trou était plein d'eau; il en avait jusqu'au cou; il se garda de remuer jusqu'à ce que la fusée s'éteignît. Alors, il rampa jusqu'à nos lignes, rapportant les renseignements nécessaires, et sa mission remplie avec succès.
A celle occasion, il avait été question d'adjoindre à ses galons de sergent une nouvelle décoration.
— Mais, dit-il philosophiquement, celle-là est encore de l'autre côté de l'Yser.
La dernière fois qu'il est venu me voir et bavarder un moment, il a sorti de son portefeuille un papier officiel, qui d'ailleurs, avait subi les atteintes de la pluie. C'était une liste de citations à l'ordre de la division, datée du 19 juillet 1916. L'une de ces citations le visait. La simplicité du texte ne comporte pas de commentaires; elle énonce suffisamment le nouveau trait de courage du brave Merx. « Malgré ses 67 ans, donne constamment l'exemple du courage calme et résolu. Au cours d'un violent bombardement devant Dixmude, s'est offert spontanément pour aller reprendre le commandement d'un poste dont le chef venait d'être tué, et y est resté jusqu'à la relève. Est chevalier de l'ordre de Léopold II et décoré de la Croix de guerre. »
Le vieil armurier d'Herstal a réfléchi et raisonné sa conduite. Ayant discerné le devoir à accomplir, il a calculé ses forces avant d'agir, et il a agi suivant son devoir, que ses forces lui ont permis de remplir.
— Tout ce que je souhaite, m'a-t-il dit en manière d'adieu, c'est de les voir vaincus et chassés. Après... on peut mourir.
Combien il apparaît symbolique de sa race, ce vieil ouvrier pacifique, que sa conscience a dressé devant le crime, en fier et libre soldat du Droit!
Chapitre XXV : Les Deux Jocondes
Mietje Debœuf
Car il y en a deux: c'est pourquoi — raison suffisante, — les premiers signalements que l'on en donna ne concordèrent pas. L'une a soixante-huit ans, l'autre quatre- vingts. Elles ne rappellent que de loin l'énigmatique Monna Lisa. Laquelle reçut la première ce surnom qui de suite se répercuta de tranchée en tranchée? Quel loustic en fut l'inventeur? La critique historique se perd à vouloir fixer ces points dans leur genèse et leur établissement.
Ce qu'il y a de sûr, c'est que Mietje Debœuf vivait paisiblement dans sa petite maison au bord de l'Yser, non loin de cette bonne petite ville de Dixmude. Mietje est le diminutif de Marietje, qui est lui-même le diminutif flamand de Marie. Sans doute comptait-elle terminer là ses jours au rythme d'une existence tranquille, que sa jovialité naturelle éclairait d'un perpétuel rayon de soleil. Elle avait marié sa fille à un bellandrier qui possédait deux péniches; il louait l'une, et exploitait personnellement la seconde. Or, chacun sait que les bellandriers ont d'ordinaire le gousset bien garni, et que la batellerie a du bon. Et sa fille avait donné à Mietje Debœuf trois petites filles aux grands yeux clairs, à la mine éveillée, qui faisaient le bonheur de leur grand'maman.
Et voilà que la guerre, l'abominable guerre éclata. Un jour, de l'autre côté de la rivière qu'une inondation bienfaisante élargit singulièrement, des voisins mauvais coucheurs et incontestablement dangereux s'installèrent, que Mietje Debœuf n'avait pas prévus. Beaucoup d'autres dans le pays s'enfuirent. Elle resta. Elle resta parmi les obus qui hurlaient à la mort, parmi les explosions qui ébranlaient l'air et secouaient jusqu'en ses fondements la vieille terre flamande, parmi le sussurrement doux des balles qui chantaient comme le vent dans, les roseaux du canal, mais dont la mélodie était mortelle.
Mietje Debœuf resta, parce qu'en même temps elle se trouva entourée de braves petits gars qui installèrent une tranchée le long de la rive, à deux pas de chez elle, et qu'elle les reconnut puisqu'ils parlaient sa langue, el que ceux qu'elle ne comprenait pas portaient le même uniforme et se battaient pour la même cause. Elle vit bien que ces enfants-là affrontaient un terrible péril, et qu'ils ne bénéficiaient pas le moins du monde de ce confort douillet que l'on a coutume de se procurer dans sa maison, ni ne se régalaient de la moindre des gourmandises dont les palais flamands sont friands, dont la ducasse est l'occasion primordiale, et à cause de quoi l'on ne serait pas fâché que la ducasse durât les 364 autres jours de l'année.
Mietje Debœuf resta. Elle ne pouvait dans les circonstances présentes confectionner des coukes savoureuses ni d'exquis pains d'amandes, étant donné la pénurie des moyens de ravitaillement: ne fallut-il pas qu'un officier profitât d'une permission pour lui acheter dans une ville de l'arrière un jupon dont elle avait le plus pressant besoin! Et l'histoire ajoute que cet officier ne savait trop comment s'y prendre, pour expliquer à la marchande l'emplette de ce vêtement si peu adéquat à sa propre tenue guerrière.
Cependant, au voisinage de Mietje Debœuf, la soupe des soldats s'améliora, le rata mijota plus savamment dans la marmite, et le café, le fameux café « relevé » de chicorée, chanta sans discontinuer dans la cafetière toujours tenue au chaud.
Un jour, comme elle allongeait le bras pour attraper une poule, elle sentit une douleur à la main gauche: une balle venait d'entrer à la naissance du petit doigt et de ressortir vers la paume, occasionnant une blessure en séton. La blessure guérit rapidement, mais un tendon était coupé, et le petit doigt demeura immobilisé. Pour cette blessure de guerre, et pour les soins donnés à ses soldats, le roi Albert conféra à Mietje Debœuf l'ordre du Mérite civil.
Les obus s'en prenaient maintenant à la petite maison. Avant que l'immeuble fût réduit à n'être plus qu'un petit tas de gravats, l'autorité militaire en évacua la propriétaire. A grand regret, la brave femme dut se séparer de ses amis les piotes, et quitter la place où elle avait « tenu » pendant plus d'un an. Elle n'alla pas bien loin. Elle vint dans mon voisinage. Sa fille, ses petites-filles l'accompagnent. Les deux péniches qui composaient le bien de la famille se trouvaient à Ypres, et les bombardements les ont démolies. Ces pauvres gens, désormais, sont des réfugiés. Ils cherchent leur vie. Mais la plus gaie, la plus vaillante, la plus vivante, celle qui trouve toujours le mot pour rire, c'est la vieille Mietje.
De taille moyenne, solide comme un roc, les bras forts, les joues pleines et drues aux pommettes colorées, elle porte fièrement sa décoration. Elle ne sait pas un traître mot de français, et je n'ai guère fréquenté plus de deux douzaines de mots flamands, mais je les additionne d'anglais, au petit bonheur; la fille de Mietje Debœuf intervient opportunément, et nous nous entendons parfaitement. Ainsi \insi m'a-t-elle raconté son histoire. Elle m'a dit comment les Allemands tentèrent de l'amener à espionner en lui offrant beaucoup d'argent, et de quelle façon magistrale elle les envoya promener. Et elle termina sur ce qu'aux dernières nouvelles sa maison était complètement démolie.
— Tout ce qui reste dans ma cave, c'est un colonel et un major.
J'admire cet entrain, cette bonne humeur, cette vitalité. Et considérant l'éclair malicieux qui brille en ses yeux bleus et la finesse de son sourire, je songe qu'après tout le loustic qui la baptisa la Joconde ne fut peut-être pas aussi ironique que l'on pourrait penser.
Madame Tack
L'autre Joconde s'appelle Madame Tack. A dire le vrai, tel n'est pas son nom. L'état- civil lui reconnaît celui de Faverger, que lui donna l'officier dont elle devint veuve, il y a de longues années de cela. Mais dans son pays, sur les bords de l'Yser où les traditions persistent, les bonnes gens continuent à la gratifier de son nom de jeune fille: d'où Madame Tack.
Je longeais un jour la tranchée de l'Yser, dans ces mêmes parages qu'habitait Mietje Deboeuf. L'agréable spectacle me surprit, à vingt mètres de la tranchée, d'un cottage élégant, pimpant, coquet, toutes fenêtres ouvertes au soleil, des roses grimpant à la façade, et, près de la porte d'entrée, dans le jardin fleuri, un panier « Miss Helyett », capitonné d'andrinople. Jusqu'alors, un seul obus s'était permis d'effleurer le toit, emportant deux ou trois tuiles laitières.
Là, résidait pendant l'été Madame Tack, qui, l'hiver, habitait Bruxelles. Surprise par la guerre au cours de sa villégiature, elle ne put regagner la capitale quand la bise et les Boches furent venus. Elle s'adapta à sa nouvelle existence, en compagnie des soldats qui occupaient la tranchée, en compagnie de Paula et de Chéri qui partageaient ses peines et ses dangers. Chéri est un petit chien affectueux et philosophe. Paula est une ânesse bien portante, au poil luisant, à l'œil roublard; elle possède au suprême degré ces deux caractéristiques de son espèce: l'entêtement et l'esprit de contradiction.
Madame Tack attelle Paula à un petit tonneau, ou la selle d'une large peau de mouton, et va se promener dans la campagne. Naturellement, Chéri est toujours de la partie. Et ces trois personnages, à des titres divers, eurent vite conquis la sympathie des hommes de la tranchée. Madame Tack était arrivée de Bruxelles avec un certain nombre de billets de mille francs, dont généreusement elle fit part aux soldats qui l'entouraient. Elle les soigna, les dorlota, ferma les yeux lorsqu'ils appréciaient sans l'en aviser la bonté des crûs de sa cave. Comme ils manquaient d'eau potable, elle leur indiqua exactement l'endroit du sol où ils devaient creuser pour en découvrir, cela sans employer la moindre baguette de coudrier. De ce coup, elle conquit la grande popularité.
Ce temps ne pouvait, hélas, toujours durer. Sur le cottage pimpant et coquet les obus boches se mirent à pleuvoir. Madame Tack dut leur céder la place. Avec son petit tonneau et sa « Miss Helyett », avec Paula, avec Chéri, elle émigra. Elle s'installa chez sa sœur, qui possède une des belles villas de la digue, à La Panne.
Sur la plage, la voici montant l'ânesse sellée de la peau de mouton, à l'arrière de laquelle le petit chien s'assied en rond, indifférent aux événements extérieurs qui, difficilement, le dérangent de son somme. Coiffée d'une capote, sur les épaules une mantille noire perlée de jais, où s'épingle la croix de Léopold II, la jupe couleur puce, les mains dans des gants de filoselle, Madame Tack, un éperon au talon gauche, une canne dans la main droite, déploie de vains efforts et une louable patience pour décider Paula à traverser une flaque d'eau de mer. Paula ruse, biaise, se dérobe, et finit par en avoir le bon bout.
C'est en ces circonstances que j'eus l'honneur d'être présenté à Madame Tack. Apprenant ma qualité de Français, elle me dit gracieusement:
— J'ai logé chez moi des territoriaux français , et je n'ai jamais eu qu'à m'en louer.
Le compliment est à l'adresse de la nation, et je m'incline.
Mon interlocutrice est grande, la taille droite, le profit pur, les traits beaux et d'une régularité parfaite, les cheveux toujours blonds malgré son grand âge, le teint frais des races du Nord et dont le temps n'a pas terni l'éclat, les yeux bleus au regard clair. Elle est douée de cet heureux caractère qui ne voit que le beau côté des choses et des gens. Et en réponse à une question sur ses tribulations parmi tant de militaires, avec un sourire charmant, avec une pointe de malice aiguisant le regard, elle déclare en soupirant:
— Ah! si j'avais eu vingt ans de moins! Elle a quatre-vingts ans sonnés. Madame Tack est une femme délicieuse.
Chapitre XXVI : La Tête d'Etapes
La Gare
La première fois que j'y débarquai, plusieurs années avant la guerre, la petite gare m'amusa comme un joujou. Comment les services du chemin de fer, du télégraphe et de la douane pouvaient-ils tenir dans un espace aussi exigu? Je me le demande encore. Quant aux voyageurs, la question ne se pose pas, car à la moindre affluence, ils débordaient à l'extérieur, sous le soleil ou sous la pluie.
En présence de l'insuffisance notoire de ces bâtiments, dont une couche de lait de chaux rajeunissait chaque année l'aspect vénérable, on construisit, de l'autre côté de la voie, une gare neuve. Vaste, bien comprise, conçue non dans un style renaissance ou moyen-âgeux (oh! les horloges de gare dans un gable flamboyant!), mais suivant un style adéquat au paysage et au modernisme du voisinage, avec son grand toit de tuiles rouges, ses montants de pierre grise encadrant les murs de briques, avec ses boiseries en pitchpin, sa décoration en ferronnerie et en carreaux vernissés et blasonnés du lion de Flandre, la nouvelle gare a tout-à-fait bonne allure. On devait l'inaugurer en août 1914. Au lieu de cela, la guerre éclata.
Elle bouleversa les habitudes du chef de gare et de ses employés, qu'auparavant, dans leur torpeur béate, secouait à peine le coup de feu de la saison estivale. Ah! combien les voyageurs pressés avaient tort! Sur la tète de ces fonctionnaires, des képis sombres remplacent aujourd'hui les fulgurants képis ponceau galonnés d'or du temps de paix; à leurs manches s'enroulent des brassards couverts d'initiales et de signes cabalistiques. La brave femme, qui manœuvrait la barrière du passage à niveau prolongeant les quais, a disparu de la voie, où veillent des sentinelles. J'aimais m'entretenir avec elle des mœurs des brochets et des anguilles, car eu matière de pêche à la ligne, je puis dire qu'elle avait le feu sacré, elle, son mari et son fils. Désormais, elle se confine dans sa maisonnette; quand je passe, elle m'adresse un sourire triste à travers les géraniums qui fleurissent sous la dentelle des rideaux de sa fenêtre, et qu'encadrent des vases peints à fleurs et décorés de filets dorés.
C'est là que j'ai acclamé au passage les soldats de la Marine anglaise filant sur Anvers, nos fusiliers-marins en route pour Gand, et les soldats de la Division de Fer et les troupes d'Afrique accourus à la rescousse pendant la bataille de l'Yser. C'est là que je vis défiler les milliers de recrues s'en allant à l'arrière recevoir l'instruction militaire qui devait les transformer en soldats. C'est là qu'ils débarquaient quelques mois plus tard, aux sons de la Brabançonne, patriotique et sonore accueil des musiques régimentaires, tous ayant de petits drapeaux belges dans le canon de leur fusil, des cocardes aux couleurs nationales à leur casquette, et de la joie plein les yeux en retrouvant le sol de leur pays.
C'est là que j'ai vu passer le premier convoi de prisonniers allemands, au milieu de l'indifférence du public. Lorsque survint le deuxième, l'attitude de la foule changea; on avait appris les atrocités commises par ces Barbares, el comme ils eurent l'audace d'invectiver cette foule avec accompagnement de grimaces comme seules ces têtes de forçats sont capables d'en faire, on eut juste le temps de donner le signal du départ pour éviter une riposte menaçante. Encore ne savait-on pas que l'assassin de Louvain comptait parmi ces prisonniers.
D'innombrables convois sanitaires ont, de ce point, emporté vers l'arrière les blessés douloureux, et en cette gare et ses annexes s'installèrent les hôpitaux d'évacuation, lorsque les bombardements rendirent la gare de Furnes intenable. Et le flot des permissionnaires s'y déverse, marée montante vers l'arrière, marée descendante vers les tranchées. Ils s'en reviennent surchargés de paquets dont les comble la sollicitude des leurs, et trouvent au débarquer un service régulier de fiacres et de diligences, parfaitement organisé par des industriels du pays, grâce à quoi ils n'ont pas quatre pas à marcher pour regagner les cantonnements de leurs corps respectifs.
l'Hopital de l'Amitié
Grand, large d'épaules, la moustache forte, la voix claironnante, M. Bertrand de Laflotte, chef-brancardier, vous enlève un blessé à bout de bras, comme une plume, et le manipule ensuite avec une douceur toute maternelle; il lui glisse à l'oreille les mots affectueux qui consolent et réconfortent; alors un souffle de tendresse passe dans sa voix assourdie. Figure connue du barreau parisien, confrère de lettres, son âge lui permettait de rester au calme dans son cabinet de travail, sous le regard tranquille des hauts portraits en robe rouge qui le solennisent, parmi ses livres et ses bibelots, et surtout auprès des êtres qui lui sont chers.
Il a préféré troquer la toque contre le bonnet de police, la toge contre le dolman, l'épitoge contre le brassard de la Croix-Rouge. Il s'est prodigué sans compter. Il a, des premiers, veillé à l'entretien des tombes françaises à Furnes, à Adinkerke, à Zuydecoote. Et si quelque pauvre diable, traduit en conseil de guerre, lui demandait le secours de son talent, maître de Laflotte s'offrait la fantaisie de plaider au son du canon. Il a conté ses impressions de volontaire de la Croix-Rouge dans un livre vivant et vibrant, où il a serti comme des gemmes plusieurs de ces mots de poilus qui sont autant de facettes brillantes de l'Ame française; et après qu'il eut quitté le service auquel on l'avait affecté en Flandre, il reçut du chef de la mission militaire française près de l'armée belge une citation comportant la croix de guerre, pour son dévouement constant, et sa belle attitude sous les bombardements de Furnes.
— Venez visiter l'hôpital de l'Amitié, me dit-il. Je vous présenterai à lady Ragot.
Lady Ragot, qui a fait campagne au Transvaal, était au nombre des infirmières qui reçurent les blessés à la gare de Dunkerque pendant la bataille des Flandres. Elle vit de suite la nécessité d'organisations sanitaires nombreuses et bien munies, le plus près possible de la ligne de feu. On en manquait à cette époque. Sitôt la bataille apaisée, lady Ragot s'en alla en Angleterre, avec son idée. Et deux mois plus lard, elle revenait en Flandre, avec son idée réalisée, c'est-à-dire avec un hôpital de campagne, facilement et rapidement démontable.
J'ai visité les baraquements qui le composent: une salle contenant au minimum trente lits, chiffre susceptible d'augmentation en cas de besoin; une cuisine, un magasin, une salle d'opérations, un four extérieur pour consumer les déchets. En douze heures de temps, le tout peut être démonté, emballé, et installé sur des wagons de chemin de fer. Des tentes permettent aux blessés de se tenir en plein air et à l'abri. Une automobile est affectée spécialement au service de l'hôpital.
A côté du magasin, un « cagibi » de quelques pieds carrés: un petit lit de fer une petite table de bois blanc, deux chaises, et un poêle. Pour ce domaine, lady Bagot a abandonné son château du Westmoreland, le vieux château qui compta parmi ses hôtes la reine Elisabeth, et qui a conservé maints souvenirs de cette illustre souveraine.
L'hôpital de l'Amitié est un exemple de cet esprit d'initiative privée et de cette volonté de réalisation, qui constituent une des grandes forces de nos amis d'Outre-Manche.
l'Ambulance Marocaine
Les baraquements voisins constituent dans leur ensemble l'hôpital d'évacuation français. Le service en est assuré par le personnel d'une ambulance marocaine. Pourquoi marocaine? « Kif-kif » est à peu près le seul mot arabe que j'y aie entendu prononcer; on ne dit même pas le « toubib » en parlant du médecin-chef; et je n’ai rencontré qu'au début de rares originaires du Maroc. Mystères de la terminologie militaire!
L'hôpital d'évacuation est bien agencé. La Société de Secours l'a doté d'une salle d'opérations, et miss Morgan d'une installation radiographique complète. Cependant, on y opère peu. Les blessés n'y séjournent pas. On reçoit les convalescents qui furent soignés à La Panne, des petits blessés, des malades peu graves, et des galeux. Les grands blessés n'y entrent que quand, destinés à l'hôpital de Zuydcoote, ils ne peuvent supporter plus longtemps le transport; ce sont le plus souvent des cas desespérés; ceux-là succombent. J'ai gardé la triste vision d'un malheureux qui avait reçu sur la tête une fusée de 75, au cours d'un tir contre les taubes; il fut presque constamment dans le coma; la face était horriblement tuméfiée; plusieurs mètres de gaze enveloppaient sa tête comme un turban hindou, et sur la blancheur du pansement, une tache rouge vif s'élargissait, s'élargissait; rien ne pouvait empêcher le sang de suinter hors du crâne défoncé. A peine si l'homme geignait, s'il remuait. Il reprit quelque temps connaissance, put écrire aux siens, et retomba dans le coma pour ne s'en évader que dans la mort. Il repose dans le cimetière du village.
Un jour, l'ambulance eut son Grand Blessé, bien à elle. Il était venu avec une sérieuse blessure à la jambe, qui prit mauvaise tournure: on dut procéder à l'amputation. Il guérit rapidement, et devint un personnage. Je ne sais s'il le comprit et résolut d'en tirer parti, mais il ne tarda pas à morigéner son monde, et d'autant plus que sa guérison s'accentuait. Cette manière d'être modifia peu à peu la nature de l'intérêt que chacun lui portait. C'était un méridional excessif.
Il se plaisait à crier, à se mettre en colère.
— A moi seul, je souffre plusss que tous les otres ensemmble!
Il s'amusait à balayer d'un revers de bras les fioles et les objets divers posés sur sa table de nuit, pour donner à l'infirmier la peine de les ramasser. Il renversait son pinard et son jus, pour le plaisir. J'arrivais parfois au milieu d'une scène de ce genre:
— Quel mauvais bougre tu fais, lui disais-je doucement.
Il s'apaisait, et acceptait une cigarette en souriant; mais il ne se tenait pas longtemps tranquille.
Il avait pris en grippe les infirmières. Il refusait de se laisser piquer:
— Elle me pique jusqu'à l'ôssse! geignait-il. Elle veut me trouer la peau comme une écumoire!
Il accompagnait ses objurgations de qualificatifs et de vocables n'ayant généralement pas cours dans les salons, et dont une imagination active et une remarquable facilité verbale lui fournissaient une étonnante variété.
— Quel répertoire! soupirait l'excellente Mlle d'H...; elle supportait l'averse d'une âme égale, mais certes ne se doutait pas auparavant combien la langue française était riche d'expressions, qui n'avaient pas leur place dans les colonnes du dictionnaire de l'Académie.
Le Grand Blessé finit par donner sur les nerfs de tout le monde, ses camarades y compris, dont il troublait le sommeil comme par jeu; chacun poussa un soupir de soulagement le jour de son évacuation. Et ceux qui précédemment ne trouvaient pas glorieux de soigner les galeux, firent amende honorable.
Contre le hangar abritant les automobiles du groupe électrogène, il existe une apostume, une verrue, un petit réduit en planches généralement mal jointes. On s'est efforcé d'en boucher les fissures pour arrêter le vent qui s'y engouffrait, et l'eau qui dégoulinait du toit. Le sol est de terre battue. Une fenêtre s'ouvre sur la plaine et sur les dunes; la vue est admirable, et le point semble choisi pour y goûter la splendeur des soleils couchants. Des fleurs des champs, des guirlandes de capucines ornent l'étroite pièce, qu'embaument des touffes de réséda cueillies aux parterres de l'ambulance. Des gravures, des études fraîchement peintes ornent les parois, et plusieurs reproductions des superbes fresques primitives découvertes au palais des Papes. L'Avignonnais qui les a piquées là fut l'objet d'une aventure: chargé de conduire à Rosendael un malheureux qui avait perdu la raison, c'est à lui qu'en arrivant on prit doucement le bras, en lui disant:
— Venez avec nous, mon ami, venez: vous verrez comme vous serez bien!
Dans le petit réduit de planches mal jointes, je retrouvais des amis charmants. Une atmosphère d'intimité régnait. La vapeur montait de la théière fumante, et se mêlait aux volutes bleues de la fumée des cigarettes blondes. Je garde le souvenir très doux des heures vite envolées où, tantôt en français, tantôt en anglais, notre causerie se prolongeait, s'attardant aux sujets chers à notre cœur. Le crépuscule venait à pas de velours. Et c'était toujours avec une pointe de mélancolie que je cédais à la peur du gendarme posté sur la grand'route, et que je réintégrais ma demeure.
Chapitre XXVII : l'Ambulance de l'Océan
La Genèse
J'ai visité nombre de salles d'hôpital: je n'ai jamais rien vu qui ressemblât à la salle B. A. de l'hôpital de l'Océan, à La Panne.
Sur la digue de mer, la ligne pittoresque des villas aux façades fantaisistes et aux toits cocasses fut un jour rompue par la masse d'une immense et laide bâtisse: des murs droits, percés de fenêtres pour cent chambres. Cela s'appela: l'hôtel de l'Océan. Pourquoi « l'Océan », puisque les flots qui battaient la digue étaient ceux de la mer du Nord? La mégalomanie qui présida à la construction de la bâtisse en fournit sans doute l'explication.
Quoi qu'il en soit, l'hôtel de l'Océan fut un asile tout trouvé pour les premiers blessés de l'Yser. Le docteur Depage, le grand chirurgien belge, en prit la direction. La reine Elisabeth, dont on sait les aptitudes et les connaissances en matière médicale, s'y intéressa activement. Les fonds affluèrent. Bientôt, les annexes s'ajoutèrent aux annexes, et c'est désormais une cité, aux quartiers déterminés par les spécialités que comporte la souffrance humaine.
Si j'ai pu en apprécier l'installation et l'organisation, également hors de pair, la compétence me manque pour en parler au point de vue technique. D'autres, ayant qualité pour en juger, m'ont dit les résultats merveilleux obtenus là. On y applique les systèmes les plus nouveaux, on les compare, on cherche, on invente, dans toutes les directions, dans tous les ordres d'idées. Chaque semaine, des breaks amènent les médecins et les chirurgiens des formations sanitaires de la région; à ces conférences, on confronte les observations, on apporte les faits qui infirment ou vérifient les théories. Un périodique spécial en publie les résultats.
Les maîtres qui purent constater sur place l'application de leurs méthodes ont exprimé tout le bien qu'ils pensaient de cette application. Le médecin-chef de l'ambulance d'évacuation française qui reçoit, après guérrison, les blessés soignés à l'hôpital de l'Océan, et qui les dirige sur l'arrière me disait:
— Ceux qui sont soignés là ont de la chance; ils peuvent remercier leur bonne étoile. Combien j'en vois passer qui, soignés ailleurs, ne s'en seraient pas si bien tirés, et même ne s'en seraient pas tirés du tout!
Une Extraordinaire Salle d'Hopital
Un billet m'apprend qu'un ami, grièvement blessé dans le secteur de Nieuport, vient d'arriver à l'Océan. Au bureau des renseignements, on me donne immédiatement son numéro et l'indication de sa salle.
C'est la salle B. À...
De la lumière, des petits rideaux coquets et des géraniums aux fenêtres, des parois en pitchpin, des dessus de lit en étoffes liberty, un grand massif de palmiers et de plantes vertes, un gramophone, des rires, et l'allée et venue des coiffes blanches d'infirmières accortes.
Sans les rangées de lits, on croirait entrer dans la salle de casino d'un petit bain-de- mer élégant et familial.
La salle B. A. est privilégiée. Une tradition veut que les blessés ne s'y plaignent pas, tandis que dans la salle voisine B. B. la nuit retentit de gémissements. Ici, ceux qui souffrent supportent leur mal en silence. Chacun attend son tour d'opération sans manifester d'angoisse. Lorsque les infirmiers ramènent sur un brancard un blessé inerte, brinqueballant à chaque mouvement et encore sous l'influence du chloroforme, nul ne s'émeut ostensiblement à le considérer. Les conversations continuent leur train. Seule, la perspective du dentiste provoque chez tous une appréhension hautement manifestée.
Le principal personnage de la salle est évidemment le gramophone. Il prend la parole avec une volubilité obsédante: toujours mêmes monologues à prétentions comiques, mêmes airs inlassablement serinés; le ténor fait toujours sa fausse note au même endroit: on l'attend venir... et elle vient. Et c'est peut-être la seule chose triste, cette répétition à jet continu d'une plaisanterie stupide par la voix nasillarde d'un chanteur de café-concert. Il y a des gens que cela amuse. Il faut que cet outil soit doué d'une constitution singulièrement robuste pour résister à l'entraînement intensif auquel il est soumis. Je me rappelle, en particulier, un gendarme... Vous connaissez cette affiche-réclame, qui représente un immense cornet de gramophone, et, devant, un petit chien aux écoutes, les oreilles dressées, la tête légèrement inclinée de côté? Comme lui, le gendarme incline de côté sa tête ronde, dresse l'oreille, et fixe les mystères de l'entonnoir d'un œil inquiet, se demandant sans doute d'où sort cette musique, et manipulant inlassablement l'appareil. Ah! Le bon gendarme que c'était!
Parfois, sans motif apparent, un courant traversait la salle. Subitement, le gramohone donnait sur les nerfs de tout le monde. Il déchaînait une tempête de cris, de sifflets, d'injures, de rires... et devait se taire. Jamais pour longtemps, hélas!
Chaque jour, à 16 h. 30, pour parler comme le règlement, une cloche sonne. A peine a-t-elle piqué les premiers coups que les blessés hurlent sur tous les tons, du fausset le plus suraigu à la basse la plus profonde:
— Pétrole! Pétrole!
C'est le thé des infirmières. Pourquoi « pétrole »? Une infirmière originaire d'Anvers a découvert l'explication. Dans le pays flamand, on rencontre parfois sur les routes, dans les villages, un camion peint en rouge, supportant une sorte de chaudière de locomotive, une sorte de tonneau de métal également passé au vermillon. A l'arrière, un seau pend à un robinet de cuivre, et sert à tirer le pétrole que le marchand livre aux ménagères. A l'avant, une cloche ballotte librement aux cahots de la route, à l'arrêt et au départ du cheval. Il en résulte un tintement irrégulier, caractéristique, que l'oreille reconnaît de loin, et exactement semblable à celui de la cloche qui sonne le thé des infirmières. Les blessés flamands ont de suite saisi l'analogie. De là « pétrole ».
On voit comme c'est simple.
Les Infirmières
La salle B. A. est dotée d'infirmières charmantes. Ce sont des Anglaises et des Belles. On appelle les Anglaises: « Sister », suivant la mode d'Outre-Manche; et comme l'appellation est commode, on la donne également aux Belges.
La sister-en-chef est anglaise. Le binocle en bataille ne suffit pas à lui donner l'air sévère auquel elle prétend, et que son regard dément. Elle a la charge de la discipline, pas toujours facile à faire rigoureusement observer par les gaillards placés sous ses ordres, et qui escomptent l'indulgence qu'inspire leur état. Jamais rien de grave, d'ailleurs : des gamineries pour lesquelles nul ne songerait à sévir, tant ces braves garçons montrent de bonne humeur et de bonne volonté. Mais enfin le règlement est le règlement; pour le nombreux personnel de l'ambulance, une discipline est indispensable; elle y fait régner l'ordre, comme par ailleurs, suivant la formule consacrée, elle fait la force des armées.
Mais malgré son binocle en bataille, personne n'a jamais pris la sister-en-chef au tragique.
Après elle, le tour de service amène dans la salle une petite sister anglaise, menue, qui glisse plus qu'elle ne marche, mais si vite qu'on l'a surnommée: « sister Galop », qui sourit gentiment à tout le monde, et dont la voix est un murmure. Elle ne se montre féroce qu'à l'endroit des différentes variétés d'indurations qui fleurissent la plante des pieds de ses blessés; le moindre durillon est son ennemi personnel; elle lui fait une guerre au couteau. Les patients souffrent, mais ne peuvent lui refuser cette satisfaction. Puis viennent une sister wallonne et une sister flamande, l'une élégante, l'autre silencieuse, et enfin deux gavroches, sister B. et sister N.
Sister B. est anglaise, légèrement teintée de sang hindou. Elle est grande, harmonieuse et souple; elle a la démarche de déesse dont parle Virgile, et les extrémités d'une finesse et d'une distinction rares. Elle possède un teint chaud, des dents éblouissantes, de grands yeux épais, et des cheveux de ce noir intense que ne connaissent pas les chevelures strictement européennes. Deux cocasses petits tire-bouchons de cheveux sortent de sa coiffe, et couvrent ses oreilles. Sister B. est le meilleur garçon du monde. Les blessés ne tardèrent pas à s'en apercevoir, et ils en profitent pour lui jouer le plus de tours possible. Suivant une expression populaire, ils trouvent l'occasion, à propos du moindre détail de service, de la faire » marcher »; et en pareil cas, sister B., qui est la bonté même, ne marche pas: elle court. Alors tout le monde s'esclaffe. Sister B. jamais ne se fâche, et rit avec les autres.
Quant à Sister N. elle est belge; petite, boulotte, blonde, et l'activité même; son profil n'a rien d'aquilin, et son petit nez offre au contraire un échantillon très pur du type dit: en pied de marmite. De temps à autre, elle prend la pose, de profil, et avec un sérieux tout à fait comique, elle dit:
— Admirez mon profil grec!
Il y a en elle autre chose qui ne se laisse admirer que malgré elle, c'est son excellent petit cœur. Elle est douée d'une exquise sensibilité; avec une délicatesse infinie, elle murmure les mots qui apaisent et réconfortent. Un de ses blessés souffrait visiblement, bien qu'il s'efforçât de n'en rien laisser paraître:
— Mon Dieu, mon Dieu! dit-elle, que pourrais-je bien faire pour vous soulager?... Si seulement je pouvais prendre pour moi un peu de votre mal...!
La température et le pouls des malades sont pris et enregistrés chaque jour, jusqu'à leur départ de l'ambulance. Naturellement les paris s'ouvrent sur le nombre de degrés et de pulsations que l'infirmière va trouver, et rien n'est amusant connue de la distraire et de l'embrouiller dans son compte. Sister N. tape du pied, et recommence, l'air grondeur. Pour ramener la colonne de mercure à son point de départ, elle secoue le thermomètre avec une rapidité et une énergie... avez-vous remarqué ce geste du chat qui par mégarde s'est mouillé la patte?
A 16 heures, les deux infirmières de service plient les couvre-lits, avant de procéder à la toilette des blessés. D'ordinaire, des convalescents valides les aident.
— Il faut bien faire quelque chose pour elles, me dit l'un d'eux; elles sont si gentilles et si dévouées.
Lorsque sister B. et sister N. sont de service le même jour, le pliage des couvre-lits fournit l'occasion d'un match. Haie, bousculade, cris et rires: lorsque essoufflé, le teint animé, chaque parti arrive au bout de sa tache, on constate que les derniers couvre-lits n'ont pas le moins du monde la forme géométrique qui doit résulter d'un pliage régulier, et l'on recommence l'opération... posément.
Quelques Blessés
Mon blessé, le sergent P., va mieux. Il se tire heureusement d'affaire. Déjà évacué deux fois au cours de la campagne pour des blessures relativement légères, il fut, cette fois, sérieusement « amoché ». Un 88 autrichien, traître parce qu'on le reçoit avant de l'avoir entendu partir, lui a fracassé l'épaule, emportant la clavicule, la tête de l'humérus, et un morceau de l'omoplate. Le coup fut reçu de face; la plaie de sortie est énorme et profonde.
— Je n'ai cessé, la première nuit, de le piquer, m'a confié sister B.; à tout instant, je croyais qu'il allait passer.
La jeunesse et le solide tempérament du sergent P. ont réagi. Beau type de normand, — et l'on sait combien cette race normande est belle quand l'alcoolisme ne l'a pas gâtée, — il était avant la guerre notaire et champion de tennis; je crois bien qu'en campagne le championnat lui fut plus profitable que le notariat.
Nous nous entretenons longuement aux sons criards du gramophone, parmi les joyeusetés de cette salle unique qu'est la salle B. A. Le blessé voisin, Hanssen, un sous-officier belge, se mêle à la conversation; il envisage l'avenir avec délices: sa sœur habitant Londres et sa mère Paris, il lui sera réglementairement loisible de partager entre les deux capitales un long congé de convalescence.
Un peu plus loin s'agite l'ami Gilbert, un grand diable exubérant de vie souriante et de jeunesse, toujours en mouvement en dépit de la blessure qu'il reçut à la jambe. Dès qu'il put se tenir debout, il envoya promener ses béquilles au bout de vingt- quatre heures, et sa canne au bout de quarante-huit. L'infirmier qui lui apporte son goûter ne sait jamais en quel coin de l'ambulance le dénicher; il y renonce, et laisse refroidir le café. Gilbert, excellent musicien, s'attarde au piano.
En face, deux civils: un rémouleur d'une cinquantaine d'années, qui s'obstina à remoudre sous le canon des Boches jusqu'à ce qu'il reçût un éclat d'obus à la jambe. Il engraisse. Jamais il ne connut le bien-être dont il jouit ici. En manière de reconnaissance, il offre à quiconque se présente de lui repasser son couteau. Chaque jour, ponctuellement, sa femme vient le voir à 15 heures, l'heure du goûter; sitôt le rémouleur servi, en silence elle absorbe les trois quarts de sa ration; et elle s'en va. Le second civil est un vieillard de 81 ans, atteint de gangrène sénile; il fallut l'amputer; dès le lendemain de l'opération, il fumait sa pipe. Lui aussi se complaît dans un bien-être ignoré au cours de sa longue existence; dans sa face immobile de marron sculpté, où le menton et le nez se rejoignent par-dessus les lèvres amincies, ses yeux gris brillent de satisfaction.
Et encore il y a Tom. Tom est un jeune Anglais de vingt ans. Il entrait dans la Marine royale lorsque la guerre éclata. Versé dans l'artillerie, détaché aux grosses pièces du secteur de Nieuport, il reçut un éclat dans le pied, qu'il fallut couper au-dessus de la cheville: la bonne blessure, dit-on par antiphrase. Vite rétabli, Tom, enchanté, explique que rentré chez lui, aux environs de Newcastle, il touchera 20 francs par semaine, et que dans quatre ans, il se mariera. Déjà, on lui propose trois situations; celle de berger lui sourit le plus: il a horreur des villes, et il adore la nature. Avant son évacuation, il compte aller dire au revoir à ses camarades de Nieuport.
— On va...
Et il termine la phrase en faisant le geste de lever le coude, très haut, à plusieurs reprises.
Il y est allé. Il tomba en plein marmitage. Au retour, il déclarait:
n Nieuport?... No good! n n Serviable, de bonne composition, il trouve son lit en portefeuille, et ne se fâche pas. Un jour, à l'heure du goûter, quelqu'un laisse tomber un œuf en équilibre instable sur une assiette, à l'autre bout de la salle; l'œuf se casse. Par quelle sorcellerie se retrouva-t-il exactement au pied du lit de Tom? La sister B. entre, et constate l'accident. Elle joue à la maman avec Tom; il arrivait sur ces entrefaites; elle désigne le corps du délit; de ce qu'elle dit, je n'entends que la conclusion:
— Tom! I'm ashamed of you!
« Je suis honteuse de vous! » Tom a beau n'être pas dans son tort, il baisse la tête, penaud, et contemple l'œuf cassé. Personne ne semble prêter attention à la scène, mais d'un lit à l'autre, des rires se répondent, étouffés dans les draps.
Visites Sensationnelles
Des visiteurs sensationnels traversent la salle B. A.. Le roi Albert, accompagné du prince Léopold, vient de temps en temps remettre en personne des croix aux blessés qu'il décora. J'y ai rencontré une reine d'Amérique, qui avait gratifié l'hôpital d'une installation radiographique. En la voyant, Gavroche n'eût pas manqué de s'exclamer:
— Mazette! Elle a de la branche!
Les cheveux légèrement poudrés sous un chapeau aux larges ailes, comme en portaient les modèles des portraitistes anglais d'il y a cent ans, la main royalement posée sur une haute canne aux allures de sceptre, elle passe, avec sa suite. En sortant, elle jette d'une voix mâle au dernier blessé de la rangée:
— Bonne chance!
Et cette vision s'évanouit.
Une autre fois, c'est un général belge avec son officier d'ordonnance. Les blessés se chuchotent d'un lit à l'autre:
— C'est le général Jacques!
Ils prononcent son nom avec respect. Ils le regardent avec des yeux qui n'en veulent rien perdre. Hommage touchant et mérité, qui honore à la fois ceux qui le rendent et celui qui en est l'objet.
Le général s'arrête devant chaque lit. Paternel, il interroge le blessé, lui parle avec sollicitude, s'enquiert de sa blessure, des circonstances de temps et de lieu où elle fut reçue. Arrivé devant le gendarme, le fameux gendarme à la tête et aux yeux ronds qui regarde inlassablement les airs sortir du cornet du gramophone, le général demande:
— Et vous? Qu'avez-vous?
— Des hémorrhoïdes, mon général. L'officier d'ordonnance attire vivement l'attention du général sur le blessé suivant.
La Guérison
Maintenant, quand je viens voir le sergent P..., je ne le trouve plus à son lit.
Sur l'initiative du docteur Depage, on a pratiqué sur lui une nouvelle opération, qui a réussi, et qui continue à réussir. Le sergent P... est présenté comme un « cas » intéressant aux autorités chirurgicales ou médicales qui visitent l'Océan. Après avoir failli succomber à sa blessure, non seulement il n'aura pas subi d'amputation, mais encore il pourra se servir de son bras. Le médecin-chef de l'hôpital d'évacuation pourra lui dire:
— On vous a trop bien raccommodé. Vous ne serez pas réformé.
En attendant, je cours après lui. Je finis par le dénicher dans l'ancien salon de l'hôtel de l'Océan, où le seul meuble qui reste est un piano sur lequel Gilbert, exécutant et compositeur de talent, s'escrime, tandis que Tom écoute, juché sur le radiateur à eau chaude. D'autres fois, nous nous tenons sur la digue de mer; les blessés, dans leur lit que l'on porte jusque là, dans des fauteuils, sur des bancs, y respirent l'air du large dès que le temps le permet. C'est là que le général Rouquerol apporte au sergent P... une médaille militaire et une croix de guerre bien gagnées.
Cette digue est un séjour idéal pour les blessés. Ils jouissent du spectacle de la mer: les monitors tirent; la riposte des Allemands fait jaillir de hautes gerbes d'eau; les chalutiers et les navires spéciaux évoluent lentement. Des avions se posent sur la plage, gracieux comme des mouettes; à droite, les 130 allemands encadrent par quatre nos aéros qui survolent leurs lignes, et notre artillerie anti-aérienne arrête les taubes et les aviatiks qui tentent sur notre territoire des excursions de plus en plus rares, parce que de jour en jour plus dangereuses.
Quant aux mélomanes, ils s'installent à l'entour des musiques militaires, à l'heure du concert quotidien.
Le sergent P... arbore une éblouissante vareuse bleu-horizon, toute neuve: cela sent le départ. Il ne tarde pas à être évacué.
Ma dernière vision de la salle B. A.: un avis manuscrit, placardé à l'entrée, annonce une séance de matchs et de jeux divers sur la plage pour les blessés suffisamment ingambes. Au programme, des courses en sac, à pied, à deux, trois ou quatre pattes, etc. Les candidats sont priés de s'inscrire. Au nasillement de l'éternel gramophone, je surprends sister B., si absorbée dans son occupation qu'elle ne me voit pas, en train d'inscrire, dans la colonne des courses à trois pattes, le nom du plus grave et du plus ventru des médecins de l'établissement.
En vérité, la salle B. A. est la plus inattendue et la plus extraordinaire salle d'hôpital que j'aie jamais vue.
Un Reliquaire et une Tombe
L'ensemble des constructions qui composent l'ambulance de l'Océan se situe à une extrémité de La Panne. Sitôt après, commencent les dunes.
Deux des plus proches attirent le regard.
Sur l'une s'élève une petite chapelle, modeste, neuve, mais dont la silhouette s'adapte heureusement à ce décor où elle est plantée. Cette chapelle est sacrée entre toutes: une pieuse pensée en a fait un monument du souvenir, un reliquaire des églises de Flandre mutilées et massacrées par la barbarie teutonne.
Semblables à des soubassements quasi-pélasgiques, de lourdes pierres tombales, timbrées de blasons anciens et gravées d'inscriptions solennelles en caractères gothiques, s'appliquent en plan incliné contre la base de la dune. Elles énuinèrent les titres sonores et rappellent les mérites de défunts jadis glorieux dans leur paroisse, et qui s'imaginèrent que ces dalles et l'abri des sanctuaires protégeraient leur dépouille, et conserveraient leur souvenir dans la mémoire des hommes.
Or, les sanctuaires sont détruits, et dans l'amoncellement de leurs ruines, la dépouille des défunts ajoute un peu de poussière à celle des décombres.
On gravit la dune par un sentier en pente douce. Voici la chapelle. A droite de l'entrée, un calvaire se dresse, abrité sous un auvent à la mode des églises du pays. Celui-ci est intact. Combien n'en ai-je pas vus, des Christs au flanc troué, non par la lance du païen, mais par l'acier sacrilège du Barbare; le corps gisait dans l'herbe, tombé de la croix où, retenus par les clous, pendaient encore les longs bras arrachés du tronc! Il fallait les auteurs de cette guerre diabolique pour ajouter un tel dernier acte au drame de la Passion.
Sauf les quatre murs, toute la chapelle es! faite d'objets sauvés des églises flamandes anéanties. Beaucoup d'œuvres d'art ail ère ni au ïfavre et au Petit-Palais; mais combien n'en restait-il pas! La provenance de ceux réunis ici est indiquée. Le passant lit le long martyrologe des bourgades, des villages dont chaque nom désormais tinte comme un glas: Saint-Georges, Nieuport, Ramscappelle, Pervyse, Oostkerke, Oudecappelle, Nieucappelle, Lampernisse, Loo, Caeskerke et d'autres! La chaire, les tables de communion, les autels, les balustrades, le chemin de croix, les candélabres, les tableaux, les statues, les ciboires, les crucifix, les bénitiers, bois finement sculptés, pierres taillées, fers forgés, cuivres ciselés, émaux, toiles peintes, toute cette matière diverse assouplie au gré de l'artiste, tous les jeux de la forme et de la couleur combinés au goût des maîtres flamands à l'Ame ardente, au tempérament sensuel et mystique, créateurs de cet art vigoureux, coloré, et qui sait s'amenuiser en finesses exquises, se nuancer en délicatesses infinies, art qui s'apparente étroitement au pays où il prit racine, tout cela se groupe ici en un ensemble saisissant. Car ces statues subirent des mutilations, ces ferronneries furent tordues, ces bois offrent des éclatements qui déchirent le manteau velouté des patines séculaires.... et ce sont des blessures aussi, non pas les blessures faites au corps des individus, mais les blessures plus profondes et plus inguérissables infligées à l'âme d'un peuple.
Montées sur des étais, des cloches sauvées du désastre. Non point les gros bourdons des cathédrales, mais les cloches à la voix claire et chantante des églises rurales, les cloches qui réglaient la vie matérielle et la vie spirituelle des habitants de la plaine, les cloches — les mêmes, — qui sonnèrent le tocsin d'alarme lorsqu'il y a plus de trois siècles les bandes d'iconoclastes parcouraient la campagne, et que les Gueux de Mer débarquaient sur la côte pour piller quelque riche abbaye. Aujourd'hui, immobiles et figées, leur battant arrêté comme un cœur qui aurait cessé de palpiter, elles attendent, dans le silence de ce reliquaire qu'est la chapelle de l'Océan, l'heure joyeuse où elles reprendront leur vol dans les clochers reconstruits, et lanceront allègrement en plein azur les notes joyeuses des alléluias de la délivrance.
Non loin de la chapelle, plus près de la grève, une autre dune où quelques plants d'oyats luttent contre l'ensablement. Au sommet, le rectangle d'une grille, un amoncellement de couronnes et de fleurs qui se fanent au vent de nier. Une tombe. Madame Depage s'était donné pour mission de plaider en Amérique la cause de ses compatriotes. Elle fut victime du crime allemand où sombra le Lusitanla. Le docteur Depage alla chercher le corps échoué sur la côte d'Irlande, et c'est ici qu'il lui donna la sépulture. Des inconnus gravissent la dune; une femme se signe; un homme se découvre; ils font à celle qui dort au bruit des flots insensibles l'hommage d'une fleur, l'offrande d'un souvenir.
Que de piété ne devrons-nous pas aux coins de sol où tant et de tels souvenirs s'accumulent!
Quant à l'homme dont la pensée règne ici en maîtresse, dont l'activité créatrice a fait surgir parmi les sables infertiles cet asile fécond en bienfaits, où la science apaise la douleur, vainc le mal, et recrée de l'humanité avec les chairs sanglantes et les os broyés qu'apportent les automobiles d'ambulances, nul ne peut sans un sentiment de respectueuse gratitude contempler sa haute et puissante figure, qui passe le long des lits où gisent les blessés, ou, sur la digue de mer, la lête légèrement penchée sous le poids de sa pensée.
Et jamais, comme dans le sien, je n'ai vu tant de bonté dans un sourire.
Chapitre XXVIII : Pendant l'Attaque sur la Somme
La Lange Marietje
Ce fut une belle détonation.
On ne s'y attendait plus; elle surprit tout le monde. Cependant, on aurait dû se méfier. L'autorité militaire avait prévenu les populations. Elle les avait engagées à coller du papier sur les carreaux de vitres de leurs demeures. On en colla partout, jusque dans des quartiers de la commune qui, vu leur éloignement, n'avaient rien à craindre. Même, quelques-uns ne saisirent pas la relation entre le collage prescrit et le bris possible. Ils ignoraient les vertus, sous ce rapport, de la croix de Saint-André. Leur sens esthétique naturel aidant, ils découpèrent le papier en dentelures, en cercles festonnés, et l'appliquèrent comme un ornement de manière qu'il satisfît le coup d'œil, sans apercevoir l'inutilité pratique de ce dispositif artistique.
Donc, on sursauta. Le fait est que la « lange Marietje », — la Marie-longue, — avait la voix forte. D'ailleurs, et bien que ce ne fût pas précisément le chant du rossignol, on avait plaisir à l'entendre. On écoutait avec satisfaction ce bruit de train-bloc qui vrombissait en s'éloignant dans la direction de l'ennemi. On se rappelait que, l'année précédente, les « petits colis » de 8 à 900 kilos passaient au-dessus de nos têtes dans la direction Est-Ouest, et l'on constatait avec sérénité que cette année ils suivaient un trajet exactement inverse.
La lange Marietje exécuta un tir d'essai, et quelques jours plus tard un tir de destruction. Avec une précision chronométrique, le coup partait de dix minutes en dix minutes. L'ennemi ne répondit pas. Ne voyait-il pas la haute flamme qui jaillissait à la hauteur d'un sixième étage? En tous cas, s'il ignorait qu'une Lange Marietje se fût installée là, — et puisque tout le monde le savait dans les environs, — la preuve se trouvait administrée que le service de Sûreté avait bien rempli son office. Le tir continua toute la journée sans être troublé.
Le lendemain, il recommença. Deux taubes le guettaient, outre la saucisse. Nos avions chassèrent les taubes; la saucisse ne fut dégringolée que quelques jours plus tard. Mais trois quarts d'heure après, la réponse arrivait. Des 280. Une réponse qui aurait pu peser sur nos destinées. A la deuxième, une fumée commença de s'élever dans les parages où la lange Marietje allongeait le cou. Les Allemands auraient-ils sitôt réussi à mettre le feu quelque part?
Je gagnai mon observatoire. Le nuage de fumée s'épaississait à vue d'oeil, montait, couvrait la plaine. Je reconnus alors qu'il était voulu, qu'il servait de masque pour dissimuler la grosse pièce. Les obus boches tombaient dedans: la haute colonne de fumée noire qui signale aux observateurs leur arrivée, s'y perdait, s'y noyait. Plus moyen d'apprécier le point de chute. Les Boches tiraient à l'aveuglette. Leur tir se raréfia. Parfois, ils envoyaient un coup très court, pour s'assurer que leurs obus ne s'en allaient pas dans la lune. Une petite cahute, atteinte par l'énorme projectile, disparut entièrement.
Et toujours, de dix minutes en dix minutes, la Lange Marietje envoyait son pruneau. Contemplant le nuage de fumée, le major de H., assis à côté de moi, disait:
— Ce n'est plus de la guerre: c'est du luxe!
Le major a raison. N'ai-je pas vu récemment, clans une auto, un militaire français caresser amicalement la ligure d'un soldat belge? Surpris de celle étrange manifestation de tendresse, je m'approchai, et constatai que le militaire français n'avait dans les bras que la moitié d'un soldat belge, sur le visage duquel il peignait une moustache et mettait du rouge aux pommettes. À quelques pas, stationnait un camion dont le contenu semblait sortir du magasin d'accessoires d'une de nos grandes scènes parisiennes. Ce n'est plus de la guerre, c'est du luxe. On apporta d'incroyables perfectionnements au procédé de la forêt de Macbeth. Des artistes spécialisés s'y emploient. Ils truquent des paysages entiers. Les Allemands camouflent jusqu'à leurs pigeons; j'ai vu de ces volatiles qui auraient pu passer pour des métis de serin et de perroquet: des bandes de couleurs d'aniline, alternativement jaunes et vertes, striaient leur poitrine et leurs ailes; un naturaliste y perdrait son latin, mais les pigeons y gagnent dans les airs une invisibilité appréciable.
Ce n'est plus de la guerre, c'est du luxe. A combien revient la pilule de la Lange Marietje? Et combien de Marietjes, ses sœurs, le long des fronts immenses? Elle tire toujours; elle tire pendant des mois, lançant la foudre du fond de son nuage, comme Jupiter. Elle accomplit de bonne besogne, impunément.
Ce n'est plus de la guerre, c'est du luxe, le luxe du carnage et de la mort.
Les Cycles de Fer et de Feu
Le temps est magnifique. Au crépuscule, le vent tombe. Dans le ciel, d'une pureté absolue, la lune monte, radieuse, vers le zénith. Elle couvre la campagne de son lumineux manteau d'argent. Les ombres des arbres, nettement découpées, s'allongent obliquement sur l'allée du jardin.
Nul ne s'abandonne à la sérénité de ce calme, sûr qu'il sera troublé tout-à-l'heure.
Les bourdonnements connus ne tardent pas à résonner, obsédants, ininterrompus. Nos escadrilles s'enlèvent, et vont chez l'ennemi, qui nous rend la visite. Les faisceaux des projecteurs commencent leur partie de quatre coins. Des fusées s'épanouissent en quadruple gerbe de pluie de feu, jaune-orangé, se détachant dans la clarté pâle, lancées par quelque pilote d'aviatik, et indiquant la route à ceux qui le suivent. La chute de lourdes bombes se répercute dans le sol. Des éclairs fuligineux. Des lueurs rouges d'incendie. Le spectacle est grandiose. On s’abandonnerai à le contempler, si la Camarde n'en fait le grand machiniste.
Le jour, la netteté idéale de l'atmosphère favorise favor.se les tirs de la Lange Marietje. D'autres dans le voisinage font chorus, car nous eu sommes largement approvisionnés au-jourdhui. Cinq saucisses tiennent l'air de notre côté, une, et rarement deux, du côté allemand.
De la digue de mer, je regarde vers Dun-kerque. En rade, une forêt de mais. Cent, cent vingt, cent cinquante bâtiments de divers modèles s'y groupent. Ainsi se groupaient jadis l'escadre du roi et les frégates de course, à l'abri des bancs de Flandre; ainsi se détachaient sur l'horizon les silhouettes de leurs carènes, et sur le ciel leurs mâtures élancées. C'est bien cela que le vieux pilote d'Enkhuysen a vu de ses yeux, et qu'il a consigné sur ses cartes marines et sur ses prolils de côtes. C'est le même tableau que la Sérénissime Infante examina du haut de la dune tandis que son carrosse attendait sur la route, et qu'à ses côtés se tenait respectueusement Monseigneur le marquis de Fuentès, ayant à la main son chapeau à larges bords dont la plume balayait le sable. C'est le même tableau qui captivait l'attention de Monsieur le chevalier Bart, lorsque, monté sur la Tour, il guettait l'instant propice pour brûler la politesse aux vaisseaux ennemis qui bloquaient le port, et dont, avec son audace et son habileté habituelles, il traversait impunément les lignes, le boute- feu à la main. Un mouvement se produit parmi les bâtiments de guerre. Des chalutiers, des torpilleurs se portent en avant dans notre direction; les destroyers, les monitors, les grands croiseurs les suivent. Arrivés à notre hauteur, ils s'embossent, prenant chacun leur position de combat. Le vol des hydravions sillonne l'air. De la surface des eaux s'élève le même épais nuage de fumée que j'ai vu s'élever de terre pour dissimuler la Lange Marietje; cette fois, il masque l'escadre entière. Et le tir commence.
Je compte une moyenne de trois coups de 380 à la minute. Les batteries allemandes ne jugent pas à propos de répliquer. Près de moi, des hommes disent, convaincus et satisfaits:
— Qu'est-ce qu'ils prennent, les Boches!... Non mais... qu'est-ce qu'ils prennent!
Le jour commence à baisser. Le feu cesse. De lourdes volutes de fumée panachent les cheminées des vapeurs. L'escadre regagne la rade de Dunkerque. Les hydravions rentrent au nid. Le grand nuage se dissipe lentement. Sur les eaux tranquilles, des patrouilleurs montent leur garde.
La nuit s'annonce claire et magnifique. Les cycles de fer et de feu continueront de nous étreindre.
Chapitre XXIX : Le 2 Novembre 1916
Au Jardin de la Mort, Une Reine a Passé...
L'herbe poussait plus drue que les tombes dans le petit cimetière qui entoure l'église. Les gros fermiers flamands, les gros brasseurs du village s'y étaient fait construire des monuments de belle pierre ou de marbre, dans le style funéraire, avec des urnes; l'inscription en lettres dorées ménageait un rectangle où s'encadrait la photographie du défunt, prise soit lorsqu'il était en vie, soit sur son lit de mort; et l'épreuve pâlissait et s'effaçait, comme pâlit et s'efface dans la mémoire des vivants le souvenir de ceux qui ne sont plus.
On distinguait même la dernière demeure d'un hobereau de la contrée, sur laquelle le marbrier avait sculpté des armoiries; et comme cet artiste en avait pris le modèle dans un livre de la bibliothèque du feu gentilhomme, la devise gravée commençait par ces mots: « Ex libris ».
Mais la généralité des tombes, celles des humbles, était de terre: un tertre, où le gazon dessinait une croix, jusqu'au jour où les herbes folles noyaient le gazon et le dessin de la croix sous l'uniformité de leur frondaison touffe.
Dès la bataille de l'Yser, qui se livrait à quelques kilomètres de là, la place libre dans le petit cimetière fut vite comblée. Par deux, par quatre, les tués s'étagèrent dans les fosses, comme leurs noms s'inscrivirent en colonnes sur les croix de bois noir. Une accalmie relative suivit. Les ambulances voisines envoyèrent les corps des malheureux que les médecins n'avaient pu sauver. Je me rappelle la tombe d'une jeune religieuse française tuée à Furnes, et dont un drapeau tricolore enveloppait étroitement le tumulus, comme un linceul. Une bombe visa l'église un dimanche, à l'heure de la messe. Elle bouleversa le sol, mit à jour quelques ossements, brisa des croix, érafla des inscriptions.
Bientôt, la place manqua pour les nouveaux venus. On creva le mur aux vieilles pierres noircies et moussues. On commença de tracer des alignements dans la prairie adjacente. De chaque côté de l'allée centrale, les files s'ajoutèrent les unes aux autres, petits rectangles pareils, exactement mesurés. Comme à la parade, un officier tint la tête de chaque file. Lorsqu'une action se produisait aux tranchées, elle se lisait ici par sa date, identique sur une série de croix.
Tombes belges, tombes françaises; tombes musulmanes avec la stèle hiératique aux caractères et à l'orientation rituels; tombes anglaises: l'une, au dernier Christmas, s'orna de la branche de gui traditionnelle, à laquelle une faveur rouge attachait cette mention écrite par une main de femme: « To our dear Bee », l'affectueux diminutif si doux à prononcer aux lèvres maternelles.
Quelques tombes allemandes... Nous ne faisons pas passer la charrue sur la terre où gisent à jamais nos ennemis.
Aujourd'hui, les tombes ont poussé plus dru que l'herbe dans le cimetière agrandi que domine la tour carrée de l'église flamande, et sur lequel le Christ du calvaire dressé auprès du porche étire douloureusement ses bras maigres. Il est orné de fleurs naïves, de plantes prises dans la dune ou dans les champs, entretenues avec soin. Cet automne, tout l'or de la saison somptueuse s'étala sur lui en un riche tapis, tissé de soucis et de capucines à la floraison attardée.
La Toussaint... La pluie ininterrompue empêche la cérémonie du Souvenir que l'on projetait.
Le Jour des Morts: le vent souffle de la mer du Nord, le temps est gris, pluvieux et morne, le paysage sans couleur.
Or, sur chaque tombe, une main pieuse déposa un chrysanthème, et nulle ne fut oubliée. Et voici venir dans l'allée la fine et menue silhouette qu'ont vue et que connaissent bien ceux qui souffrent, car toujours elle apporta quelque adoucissement à leur mal. De tombe en tombe, elle va; elle s'arrête devant chacune, et nulle n'est oubliée par elle.
Mais dès les premiers pas, l'eau du cœur, comme disaient si joliment nos pères, l'eau du cœur monte à ses yeux de violette. Et du plus grand au plus obscur, chacun de ceux qui dorment là reçoit l'hommage d'une larme et d'une prière de la souveraine, la souveraine de l'Yser, la petite reine au grand cœur. Dans l'horreur de la guerre, elle est la tendresse et la pitié du Monde. Elle est, vivante, la Légende que de génération en génération l'on se conte aux veillées d'hiver, la légende des saintes de missel et de vitrail, la légende poétique et charmante, qui pour les humbles et les miséreux attendrit la dureté de vivre en la douceur de rêver.
On distinguait même la dernière demeure d'un hobereau de la contrée, sur laquelle le marbrier avait sculpté des armoiries; et comme cet artiste en avait pris le modèle dans un livre de la bibliothèque du feu gentilhomme, la devise gravée commençait par ces mots: « Ex libris ».
Mais la généralité des tombes, celles des humbles, était de terre: un tertre, où le gazon dessinait une croix, jusqu'au jour où les herbes folles noyaient le gazon et le dessin de la croix sous l'uniformité de leur frondaison touffe.
Dès la bataille de l'Yser, qui se livrait à quelques kilomètres de là, la place libre dans le petit cimetière fut vite comblée. Par deux, par quatre, les tués s'étagèrent dans les fosses, comme leurs noms s'inscrivirent en colonnes sur les croix de bois noir. Une accalmie relative suivit. Les ambulances voisines envoyèrent les corps des malheureux que les médecins n'avaient pu sauver. Je me rappelle la tombe d'une jeune religieuse française tuée à Furnes, et dont un drapeau tricolore enveloppait étroitement le tumulus, comme un linceul. Une bombe visa l'église un dimanche, à l'heure de la messe. Elle bouleversa le sol, mit à jour quelques ossements, brisa des croix, érafla des inscriptions.
Bientôt, la place manqua pour les nouveaux venus. On creva le mur aux vieilles pierres noircies et moussues. On commença de tracer des alignements dans la prairie adjacente. De chaque côté de l'allée centrale, les files s'ajoutèrent les unes aux autres, petits rectangles pareils, exactement mesurés. Comme à la parade, un officier tint la tête de chaque file. Lorsqu'une action se produisait aux tranchées, elle se lisait ici par sa date, identique sur une série de croix.
Tombes belges, tombes françaises; tombes musulmanes avec la stèle hiératique aux caractères et à l'orientation rituels; tombes anglaises: l'une, au dernier Christmas, s'orna de la branche de gui traditionnelle, à laquelle une faveur rouge attachait cette mention écrite par une main de femme: « To our dear Bee », l'affectueux diminutif si doux à prononcer aux lèvres maternelles.
Quelques tombes allemandes... Nous ne faisons pas passer la charrue sur la terre où gisent à jamais nos ennemis.
Aujourd'hui, les tombes ont poussé plus dru que l'herbe dans le cimetière agrandi que domine la tour carrée de l'église flamande, et sur lequel le Christ du calvaire dressé auprès du porche étire douloureusement ses bras maigres. Il est orné de fleurs naïves, de plantes prises dans la dune ou dans les champs, entretenues avec soin. Cet automne, tout l'or de la saison somptueuse s'étala sur lui en un riche tapis, tissé de soucis et de capucines à la floraison attardée.
La Toussaint... La pluie ininterrompue empêche la cérémonie du Souvenir que l'on projetait.
Le Jour des Morts: le vent souffle de la mer du Nord, le temps est gris, pluvieux et morne, le paysage sans couleur.
Or, sur chaque tombe, une main pieuse déposa un chrysanthème, et nulle ne fut oubliée. Et voici venir dans l'allée la fine et menue silhouette qu'ont vue et que connaissent bien ceux qui souffrent, car toujours elle apporta quelque adoucissement à leur mal. De tombe en tombe, elle va; elle s'arrête devant chacune, et nulle n'est oubliée par elle.
Mais dès les premiers pas, l'eau du cœur, comme disaient si joliment nos pères, l'eau du cœur monte à ses yeux de violette. Et du plus grand au plus obscur, chacun de ceux qui dorment là reçoit l'hommage d'une larme et d'une prière de la souveraine, la souveraine de l'Yser, la petite reine au grand cœur. Dans l'horreur de la guerre, elle est la tendresse et la pitié du Monde. Elle est, vivante, la Légende que de génération en génération l'on se conte aux veillées d'hiver, la légende des saintes de missel et de vitrail, la légende poétique et charmante, qui pour les humbles et les miséreux attendrit la dureté de vivre en la douceur de rêver.








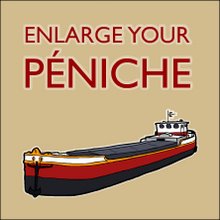

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire