L'épopée sénégalaise sur l'Yser
de la revue "l'Illustration" No. N 3375, 9 juin, 1917
Dans les Flandres, 1914
La «Journée de l'Armée d'Afrique» nous est une occasion d'exposer, avec plus de détails qu'on ne l'a fait jusqu'ici, le rôle joué en 1914 par les troupes noires, par les Sénégalais, dans la défense du dernier lambeau de terre belge et des approches de Dunkerque et de Calais. A l'heure où ils sont à l'honneur, il convient de rappeler celle où,. dès la première période de la guerre, ils furent si durement à la peine et où ils versèrent leur sang, pour nous et pour nos alliés, avec une prodigalité magnifique.
La «geste» splendide des fusiliers marins qui, du 7 octobre au 10 novembre 1914, se couvrirent de gloire à la défense de Dixmude, a été hautement louangée. On a fait une part magnifique aussi à la vaillance et au courage inouï de l'armée belge qui, toute meurtrie encore de deux mois de luttes incessantes pour l'indépendance du territoire national, après la hardie et pénible retraite d'Anvers, coopéra stoïquement à la résistance acharnée de la brigade navale de l'amiral Ronarc'h.
La «geste» splendide des fusiliers marins qui, du 7 octobre au 10 novembre 1914, se couvrirent de gloire à la défense de Dixmude, a été hautement louangée. On a fait une part magnifique aussi à la vaillance et au courage inouï de l'armée belge qui, toute meurtrie encore de deux mois de luttes incessantes pour l'indépendance du territoire national, après la hardie et pénible retraite d'Anvers, coopéra stoïquement à la résistance acharnée de la brigade navale de l'amiral Ronarc'h.
Mais, sur la sublime ardeur des troupes noires qui furent les mâles et précieux auxiliaires des Français et des Belges en ces circonstances uniques où se jouait le sort de deux patries, rien. En vain feuillette-t-on le "Bulletin des Armées de la République". Personne encore ne s'est constitué l'historiographe attentif de ceux qui, venus du continent africain où s'est installée notre civilisation, surent peiner et mourir pour notre cause et par amour pour la France. Et pourtant! Pourtant, adjoints aux indomptables fusiliers et ans fantassins du roi Albert, leurs émules, des milliers de soldats exotiques, farouches djebelli ou originaires du bled, de la brousse ou des déserts de sable, empourprèrent de leur sang généreux les prés du Veurne-Ambacht et les eaux lourdes du fleuve étroit, suprême frontière imposée à l'envahisseur germanique. Il y aurait ingratitude et injustice à continuer de se taire sur la contribution des contingents sénégalais aux actions insignes qui se déroulèrent dans la Flandre occidentale. Leur présence, durant ces heures tragiques, complète le grandiose tableau qui, sur les horizons de la Belgique blessée et dévastée, retrace les moments de la formidable mêlée des peuples.
Vers la fin du siège, les troupes belges, sentinelles avancées de la tête de pont de Dixmude, étaient à bout, fatiguées, épuisées, usées de toutes façons. Il était urgent de leur apporter enfin l'adjuvant et le réconfort escomptés. C'est alors que les formations noires entrent en scène.
Elles avaient déjà été largement réquisitionnées depuis le commencement de la guerre. Chacune de leurs étapes à travers la France envahie avait été marquée par de laborieux exploits. A la Fosse à l'Eau près de Rocroi, dans les marais de Saint-Gond, aux journées qui précédèrent la bataille de la Marne, elles avaient participé, d'un élan fabuleux, aux terribles heurts des premières rencontres avec l'ennemi. Il leur en avait coûté d'ailleurs. Les vieilles colonnes aguerries qui s'étaient illustrées, pendant la campagne marocaine, à Tadla et à Taza, se trouvaient, dès septembre, réduites des deux tiers de leur effectif. Ces survivants, réunis aux deux bataillons qui restaient, après la victoire de la Marne, des régiments coloniaux de la division du Maroc, formèrent un groupe mixte augmenté bientôt d'un troisième régiment de 3.000 recrues indigènes provenant de l'Afrique occidentale. Et, tandis que les vétérans, à Sillery, près de Reims, livraient sur la Vesle des combats quotidiens, la nouvelle troupe, à Berry-au-Bac avec l'armée de Franchet d'Esperey, autour d'Arras avec le général de Maud'huy, se trouvait, en quelques engagements, presque complètement décimée. Elle y laissait, en tout cas, ses trois chefs de bataillon, Chasles, Schneegans et Sapolin, et ne pouvait plus être d'aucune efficacité au général d'Urbal. C'est ainsi que les Sénégalais de la division du Maroc et de la division d'Algérie durent être acheminés vers la Belgique.
Tout frémissants encore des récentes échaufourrées, ils furent transportés de Tincques à Loo en automobile et, le 26 octobre, à 10 heures du matin, ils arrivaient sous Dixmude. D'un premier échelon de deux bataillons, l'un, commandant Debieuvre, fut dirigé immédiatement vers la Maison du Passeur, au nom tragique; l'autre, le bataillon colonial blanc, du commandant Claudel, s'en alla occuper Saint-Eloi, près d'Ypres. Le deuxième échelon comprenait le 3e bataillon de tirailleurs du Maroc, commandant Frèrejean, et le 1e bataillon de tirailleurs d'Algérie, commandant Brochot. Ce groupe, sous les ordres du commandant Peletier, de l'infanterie coloniale, demeurait à la disposition de l'amiral Ronarc'h. Il était appelé au périlleux et redoutable honneur de partager, avec les fusiliers marins et le mâle résidu des lignards belges, le lourd fardeau de la défense meurtrière de Dixmude. Et de la fin d'octobre au 10 novembre, sans être ni renforcées ni relevées, ces unités supporteront les chocs impétueux des assauts allemands rués contre l'Yser infranchissable, l'obstination orgueilleuse d'un ennemi halluciné par le mirage tentateur de Dunkerque et de Calais à conquérir.
En attendant les instructions de l'amiral, les nouveaux venus eurent un amer avant-goût de la région maudite où ils pénétraient. Quotidiennement, les Allemands bombardaient les ruines de la ville et les alentours. Telles étaient la régularité et la méthode rigoureuse de l'action d'artillerie que les fusiliers, habitués déjà au jeu mathématique de l'adversaire, pouvaient en prédire à coup sûr les phases et le développement. D'abord un arrosage en règle du quartier général situé près de la halte de Caeskerke, puis un balayage effréné de la chaussée, enfin un tir condensé sur toute la zone avoisinant le Haut-Pont qui reliait, à hauteur de la minoterie, les deux rives de l'Yser. Les marmites, pendant ce temps, bouleversaient sans répit le tas de briques et de pierres calcinées qu'était devenue la petite ville de béguinages fleuris et de vieux couvents qui dominait naguère les champs bas, les pâturages et les canaux du Blooteland. L'état-major des bataillons sénégalais avait avisé parmi les alignements de moellons et les éboulis informes une maison à peu près indemne qui, si elle n'offrait qu'une sécurité relative, présentait au moins l'avantage d'abriter contre les intempéries. A peine s'y trouvait-il installé qu'une série d'obus bien dirigés, disloquant les murs branlants, ensevelissait sous les décombres les trois chefs de bataillon et le major belge Hougardy. Celui-ci avait les deux jambes rompues; le commandant Peletier était relevé, l'épaule gauche brisée. Par bonheur, les deux autres officiers se tirèrent de là sans grand dommage, et le capitaine Frèrejean, quoique atteint à la figure, put néanmoins prendre le commandement du groupe.
Cependant, il avait été décidé d'opérer sans délai la relève dans les tranchées avancées de la tête de pont au Nord, vers la route de Beerst et dans les secteurs de l'Est et du Sud. L'opération n'allait pas sans inconvénient. Il n'y avait point de défilement préparé pour parvenir à ces lignes et on ne pouvait guère espérer avancer à couvert derrière les arbres rares de la route ou les haies défeuillées par l'automne. Tout de même, les compagnies Talin d'Eyzac et Silvani commencent le mouvement commandé. Mais elles sont aussitôt repérées par des observateurs ennemis à l'affût dans les clochers des villages environnants et dans la nacelle d'un drachen qu'on aperçoit qui se balance au-dessus de Beerst. Elles traversent la ville sans pertes sérieuses. Parvenues à la limite des habitations, c'est autre chose: elles sont prises sous un feu violent de batteries et, avant d'avoir fait un demi-kilomètre, une cinquantaine de tirailleurs jalonnent le chemin de leurs corps. Moins heureuse encore, la compagnie du capitaine Mercier, sans même avoir bougé, a dix-huit hommes blessés par un seul projectile. C'étaient là trop de pertes inutiles. La relève fut suspendue pour n'être reprise qu'à la nuit. Dès lors, les Sénégalais savaient à quoi s'en tenir sur les conditions de la lutte qui allait requérir leur courage.
Ce n'était rien pourtant. Quelque chose devait leur être plus pénible que le feu systématique et journalier dirigé contre les tranchées, plus terrible que les ravages de la mitraille écrêtant les parapets, effondrant les faibles remblais de terre, comblant les abris: l'immobilité même où ils étaient condamnés dans ces silos de glaise fondante que, malgré les puisards, l'eau s'obstinait à remplir. Il pleuvait comme il pleut en Flandre, à l'arrière-saison. Une petite pluie fine, incessante, implacable qui confond dans sa brume glaciale le ciel et la terre, noyant la campagne désolée. Ames de soleil plongées dans le précoce hiver du Nord, Equatoriaux ivres des grands espaces lumineux, impulsifs habitués aux charges fougueuses et conquérantes, d'être soudain parqués dans l'inertie de la défensive, prisonniers dans cette atmosphère de brouillards et d'humidité renverse toutes leurs idées sur la guerre. Ah! les étendues tropicales où bondir librement, se précipiter dans la clarté victorieuse! Inertes au bord de leurs gourbis fangeux, les tirailleurs grelottent, les doigts boudinés d'engelures, les pieds meurtris de tumeurs œdémateuses. A la nostalgie des chauds horizons quittés s'ajoute le spleen à mourir d'un paysage douloureux et d'un ciel sans rayonnement. Du tréfonds d'eux-mêmes, ils sentent monter le grand malaise inconnu, inexpliqué, inexplicable, fatal qui submerge d'une marée d'ennui leur cœur enfantin et ignorant. Et la contagion se propage et s'étend. Alors, il faut songer à remédier à cette épidémie morale qui menace de causer dans les rangs plus de déchets que l'artillerie acharnée de l'ennemi. On imagine de faire exécuter aux pauvres noirs, transis de corps et d'âme, des travaux d'amélioration de leurs tranchées. Ce fut salutaire et roboratif. Au fur et à mesure que boyaux, cheminements et méandres vers l'arrière se creusent, que des talus s'élèvent, que des positions de flanquement se créent, obligeant les hommes à une incessante activité, on les voit renaître comme par enchantement. Et dans les faces de bronze fermées et tristes le large rire s'épanouit de nouveau sur les dents blanches.
C'est pour eux une aubaine appréciée de pouvoir, à la faveur des nouvelles galeries, cesser de croupir des heures et des journées au même endroit, sous la protection dérisoire des volets et des portes amenés des ruines où l'on ne parvenait qu'en rempant et sur lesquels les artilleurs boches ajustaient, à tout moment, leurs canons-revolvers et leurs pièces de 77. Joyeux de se dégourdir un peu, les tirailleurs poussent la témérité jusqu'à l'extravagance. Ils se disputent les dangereuses corvées, tant il leur paraît bon de s'évader ainsi de cette vie stagnante où ils souffrent et s'annihilent. C'est à qui ira aux vivres et au café. Ils mettent à remplir ces besognes non point de la forfanterie certes, une chose dont ils ignorent jusqu'au nom, mais une ardeur gamine et une sorte d'émulation insouciante du péril. Il y a tellement chez eux d'imprudence et de désinvolture dans les allées et venues de l'avant à l'arrière que les officiers sont contraints d'en venir aux mesures énergiques: interdiction absolue de circuler, même pour le ravitaillement, sinon en pleine obscurité.
Cependant, entre le Beverdyck et l'Yser, de Saint-Georges à Dixmude, l'inondation tendue sur l'ordre du quartier général belge avait, d'une marche insensible et sûre, produit tous ses effets. Cette partie du front était devenue inviolable grâce à l'eau qui enlisait peu à peu les dernières batteries de l'adversaire surprises sur la rive gauche. Dès lors, l'intérêt et l'intensité des opérations refluèrent vers Dixmude, en particulier à l'Est et au Sud de la tête de pont. Au cimetière, les fusiliers n'ont quasiment pas une minute de repos. Sur le reste du front, on fait bonne garde certes, mais on peut souffler. Entre temps, les malins se livrent à des chasses fructueuses parmi le bétail abandonné par la fuite précipitée de ses propriétaires. Poussé par l'eau qui étendait de plus en plus sa nappe insidieuse de prairie en prairie, ce bétail s'était, comme les Allemands eux-mêmes, replié en masse des bords du canal vers les herbages moins vaseux de Beerst. Il y avait notamment un troupeau de cochons qui circulait familièrement à portée de nos lignes, rongeant les betteraves, retournant les jardins, se vautrant en liberté dans la boue. Vite, on prit l'habitude de varier le menu, à la fin fastidieux, de « singe » et d'endaubage et de bœuf de conserve par quelque rôti de lard et des grillades fraîches prélevées sans façon sur les truies et les vefïats, les gorets et les marcassins qui pataugeaient trop près des tranchées. Marins et fétichistes d'Ouadaï appréciaient, comme il sied, ce supplément de rations que n'avait point prévu le service des subsistances. Mais les tirailleurs musulmans, fidèles aux recommandations du Prophète, se détournaient avec dégoût de toute cette chair impure. Or, au cours d'une reconnaissance nocturne, près d'un moulin démoli, un sergent blanc et quelques noirs surprirent, au coude du canal, un groupe de porcs attardés parmi des cadavres allemands qu'on n'avait pu ensevelir. Horreur! avec des grognements de satisfaction, les pourceaux dévoraient les Boches en putréfaction. Du coup, il ne fut plus question d'améliorer l'ordinaire. Encore tout émus de cette épouvantable découverte, les Européens décidèrent sans hésitation de faire comme les musulmans et de s'abstenir désormais de la viande des bêtes immondes. On pense si l'on parla de la chose à la ronde. Au milieu des blancs consternés, un tirailleur s'esclaffait. Comme on s'étonnait de cet excès d'hilarité, le brave Sénégalais, tout fier de cette victoire inattendue du Coran, expliqua: "Ah! ti connaissais pas que cochon même chose que charognards. Quand ti vas Soudan, ti manges pas charognards. Faut pas ici manger aussi. Ti vois Mohamed y connaissait bien cochon, li! "
II n'y avait évidemment rien à répliquer à cette logique nègre. Et Mahomet avait raison!
D'après divers symptômes d'activité significatifs, il devint manifeste qu'une attaque allemande était prochaine. Le commandement prit ses dispositions en conséquence. Du Nord au Sud, l'ordre de bataille fut le suivant: à cheval sur la route de Beerst jusqu'au canal d'Handzaeme, une forte section de fusiliers marins; de la rive droite du canal à la voie ferrée, la 3e et la 4e compagnie de Sénégalais; entre le talus du chemin de fer et la route d'Essen, face à l'Est, une compagnie belge. Puis s'échelonna en infléchissant selon la parallèle de la voie ferrée la 2e compagnie de tirailleurs prolongée par trois sections de la lre compagnie; enfin, une section de marins appuyée à la route de Woumen. Aux deux extrémités de ce cordon, près du cimetière et vers l'Yser, des sections de renfort de fusiliers. Le poste du commandant Brochot était installé juste à la sortie Est de Dixmude. Il avait comme réserve, à califourchon sur la chaussée, la 4e section de la lre compagnie indigène et quelques fusiliers.
On est le 9 novembre. Durant toute la journée, sans pause, sans répit, sur la ville, sur les tranchées de l'Yser et l'emplacement présumé des réserves, l'artillerie de l'adversaire se livre à une débauche de projectiles. Le lendemain, dès le petit jour, les intentions allemandes s'affirment de manière plus précise et la fête de la mitraille reprend chez les artilleurs d'outre-Rhin avec une intensité et une prodigalité inouïes. La mort, les ailes large ouvertes, plane, en fauchant, des tranchées jusqu'à Caeskerke. L'heure du choc suprême, à n'en point douter, est près de sonner. Il pleut du fer sur la ville et à l'arrière, tandis que les rafales de 77 et de 105, percutants et fusants, pointent nos lignes. La situation ne tarde pas à être épouvantable.
Sous l'avalanche déconcertante de mitraille, les Sénégalais montrent ou affectent la plus parfaite impassibilité. Les uns pansent des camarades atteints. D'autres, de leur propre initiative, débarrassent la tranchée des matériaux et des cadavres qui commencent à l'obstruer. Pourtant, ils maugréent contre les Boches qui les obligent à une besogne sans fin. Pour éprouver le moral de leurs hommes, des chefs de section plaisantent: «As-tu ton gris-gris, Fatou?»
Mais chez Fatou, comme chez tous, il n'y a plus à ce moment qu'une pensée: s'élancer contre l'adversaire et venger les camarades «même chose frères» qui sont déjà tombés, çà et là, déchiquetés par les obus. A tous, l'attente paraît interminable. On leur a dit: «attention! les Allemands vont sortir.» Mais ils ne sortent pas encore. Quand enfin ils se décident à surgir de terre à 300 mètres, il faut user d'autorité pour empêcher les tirailleurs de se précipiter à leur rencontre. «Feu à volonté!» commandent les officiers. Et, dans le tas pressé des assaillants, une fusillade nourrie fait de larges entailles. Et chaque fois la culbute est ponctuée d'une longue acclamation des noirs.
Ce n'est là sans doute qu'un essai d'attaque, car bientôt la bande des lapins roux rentre dans ses terriers. L'action n'a pas duré trois quarts d'heure. Elle va reprendre d'ailleurs. Vers midi, un nouveau déclanchement se produit sur tout le front. Par vagues denses, en des points précis aménagés sans doute à cet effet, l'infanterie ennemie se débusque, se multiplie, tandis que des mitrailleuses entrent en jeu. Elle pousse avec une particulière insistance contre la 3e compagnie où, depuis le matin, une rude préparation d'artillerie a mis hors de combat la moitié de l'effectif. Le capitaine Talin d'Eyzac a été tué la veille, un sous-lieutenant qui a pris le commandement est atteint, au début de l'assaut, et doit être transporté à l'arrière. Le lieutenant Charbonnel, incomplètement guéri d'une blessure reçue près de Reims, veut se porter à la tète de sa compagnie provisoirement commandée par un adjudant. Il arrive en pleine action, et, avant d'avoir pu aborder ses hommes, il disparaît dans la tourmente. Une lutte désespérée et un corps à corps éperdu se livrent en cet endroit. Mais toutes les prouesses des braves Soudanais sont inutiles. La fatalité, dirait-on, se met de la partie.
Sans doute, malgré le terrain qui se prête à l'infiltration par petits paquets, les débris de la 3e compagnie parviendraient-ils à contenir l'ennemi qui tente de les déborder. Hélas! à ce moment, à leur droite, se produit un inexplicable fléchissement, bientôt suivi d'une vraie débandade. Alors c'est le désastre et le carnage. Les tirailleurs, bousculés, roulés, enveloppés, sont submergés par la vague irrésistible des assaillants. Ils vendent chèrement leur vie, à coups terribles. Que peut cependant cette poignée de héros contre le nombre? Un à un, ils succombent. A midi, il ne reste là que quelques hommes qui, ayant réussi à se défiler dans les fossés pleins d'eau à la limite des prairies, vont se joindre à la 4e compagnie et renouveler des actes de bravoure surhumains.
Celle-là aussi a été fortement éprouvée. Soutenue par une section de mitrailleuses, elle avait d'abord repoussé vigoureusement une première attaque. Et brusquement, à l'heure où l'élan de l'ennemi semble brisé, elle se trouve encerclée par les Allemands qui la fusillent à dos d'une série de constructions où ils ont pris pied à l'insu de tout le monde. Les mitrailleuses repérées sont bouleversées et le capitaine Silvani, qui cherche à sauver la situation, est tué net d'une balle au front. L'attaque, là aussi, dégénère en luttes particulières et là également la mêlée devient un chaos gigantesque. Là aussi l'héroïsme est vain. Ceux des tirailleurs qui survivent à la tuerie, on les retrouvera le soir, hirsutes, horribles, mutilés, fous de rage et de désespoir, luttant pied à pied derrière les barricades improvisées dans la ville.
Toutefois, dans le secteur Sud, les Sénégalais résistent furieusement. Ils font du bon ouvrage et leur figure se détend à voir l'hécatombe qui s'entasse, sous leur tir meurtrier, devant leurs retranchements. Une inquiétude néanmoins les angoisse: les munitions baissent; de la réserve aucun secours n'arrive. La déveine encore une fois joue son rôle. Voici qu'un agent de liaison apporte de la 2e compagnie une nouvelle doublement fâcheuse: le capitaine Mercier est tué; la ligne belge est quasiment sans défenseurs. Que faut-il faire?... La minute est critique. Le sous-lieutenant Paturon, qui a pris l'initiative de cette communication, reçoit ordre d'appuyer à sa gauche pour combler l'éclaircie signalée. La 1rec compagnie et les fusiliers, afin de réparer la brèche, vont essayer un glissement analogue. Opération risquée assurément, puisque les effectifs sont déjà tellement restreints, mais opération urgente estime-t-on. Trop tard! La 2e compagnie, en prononçant son mouvement d'extension, se rend compte que la tranchée belge est déjà occupée par l'ennemi. Alors, le mince cordon de défense craque et cède de plusieurs côtés à la fois. Le lourd bélier teuton redouble la vigueur de ses poussées. La réserve peut encore sauver sans doute la partie compromise. Mais les agents dépêchés au commandant Brochot ne reviennent pas. On ne les reverra plus. Quand ils parvinrent au poste de commandement, les hommes y étaient déjà aux prises avec l'ennemi. Eux succombèrent, en pleine confusion.
Témoins du recul des Belges, un capitaine de frégate avec ses fusiliers et le commandant Brochot avec sa section, entraînent la réserve dans l'espoir d'arrêter l'irruption. Les deux officiers ne vont pas loin. Visés à bout portant, on les voit s'affaisser l'un et l'autre presque au même instant. L'adjoint du commandant, le captaine Jerusalémy, lui, était déjà tombé sur le parapet de son poste, mortellement frappé avant d'avoir pu donner un ordre. Alors, privés de chefs, désemparés, décimés, obstacle dérisoire à la marée montante des assaillants, tirailleurs et fusiliers sont culbutés, emportés par l'afflux des arrivants qui piétinent leurs cadavres aux portes de la ville morte dont ils veulent malgré tout interdire l'accès.
Au Sud, toutefois, la 2e et la 1re compagnie des Sénégalais subissent, décuplant leurs inlassables énergies, assaut sur assaut. On ne sait rien de ce qui se passe dans le voisinage immédiat; on est seulement un peu anxieux à cause du retard des réserves et de la provision de cartouches qui touche à sa fin. D'autre part une progression de l'adversaire, que les fusiliers marins signalent par les fossés parallèles à la route de Woumen, provoque une compréhensible émotion. On n'abandonne pas néanmoins l'espoir de vaincre. Le tir est dirigé du côté menaçant et l'on y utilise les dernières munitions. Puis, sur les blessés qui ne peuvent plus combattre, sur les morts épars, on fait la récolte. Après, on foncera sur l'Allemand, à la baïonnette. Soudain la ruée de l'adversaire s'apaise autour des nôtres. Les Boches se sont aplatis à peu de distance dans les champs de betteraves. Va-t-on pouvoir respirer? Non. L'ennemi veut réduire les sublimes réfractaires. Sur l'îlot de résistance que forment les sections du Sud, l'artillerie allemande, de face, d'enfilade, de revers, braque ses lourds obusiers, comblant les tranchées de projectiles de tous calibres, de terre envolée et de débris humains. Entre temps, l'infanterie adverse est parvenue au cimetière d'où elle refoule les marins. Pour comble de surprise, entre deux éclatements de mitraille, on perçoit maintenant très nettement une vive fusillade à l'arrière. La situation apparaît dans tout son tragique. Et bientôt débouchent de Dixmude même, dans notre direction, des groupes d'Allemands qui prennent position près de la voie ferrée. Ils attendent évidemment que leurs batteries, modérant le feu, leur permettent d'approcher. La canonnade cesse. Nous sommes coupés. Il faut alors faire face devant, faire face derrière, alterner le sens des tirs, afin de donner l'illusion de la force et du nombre. Plus de secours à espérer, plus de munitions, plus rien qu'un indomptable courage. Les Sénégalais sont merveilleux de bravoure. Au fort de l'action combinée du canon, des mitrailleuses et de la fusillade, on voit un rude sergent indigène morigéner un de ses cadets qui ne peut s'empêcher, de temps à autre, de «saluer» balles et shrapnels au passage: "T'as pas fini faire silhouette, paraissant et disparaissant? De quoi ti as peur? Si c'est la balle, ton tête il est gris comme la terre, personne là-bas y a voir toi. Si c'est canon, t'en fous, y a trouver ti aussi bien dans le trou." A peine a-t-il achevé cette fière leçon de maintien, qu'un éclat lui fracasse la mâchoire.
Et l'encerclement s'accomplit autour des tranchées. Sur ces entrefaites, les marins reçoivent l'ordre de se replier à l'abri du talus du chemin de fer; les deux compagnies de Sénégalais, qui ont perdu plus des deux tiers des leurs, suivent le mouvement. Elles peuvent ainsi éviter le coup de filet qui se prépare.
Lorsque le reliquat de tirailleurs valides parvient au moulin du Sud de la ville, l'âpreté du combat s'est déplacée au Nord et à l'Ouest. En avant donc pour se frayer un chemin! Mais au carrefour des routes, une pièce d'artillerie est installée. Les premiers qui tentent de s'aventurer sur la chaussée sont balayés comme des feuilles par un vent d'automne. Pas d'issue possible entre le remblai de la voie ferrée et la lisière de la ville. La prairie qui s'étend là est une zone dénudée que le feu et la mort, de toutes directions, ravagent. Il n'y a plus qu'à rester sur place l'arme au pied. C'est ce qu'on fait. A quelques mètres de là, dans les lugubres ruines de Dixmude, l'ennemi grouille. Des fusiliers, des Sénégalais, des Belges, en groupes isolés, s'obstinent à barrer son avance. On se massacre de rue en rue, de barricade en barricade. Chaque tournant, chaque pan de muraille subit un siège. 40.000 Allemands se démènent sur le cadavre pantelant de la ville et sur les corps meurtris de ses derniers défenseurs, Africains et Européens confondus, marins et tirailleurs unis dans le suprême sacrifice.
L'obscurité enfin venue, Sénégalais et fusiliers marins sont résolus, coûte que coûte, plutôt que de courir le risque d'être faits prisonniers, à hasarder la périlleuse traversée de la ville jusqu'à l'Yser. Hardiment, ils entrent dans la mêlée hurlante et le chaos. A coups de baïonnette, à coups de crosse, à coups de poings, les tirailleurs mordant à belles dents, jalonnant de morts leur pénible chemin dans les décombres, ils pai'viennent au Haut-Pont. Comme l'a dit N'Drop si expressivement, plus de pont. L'amiral Ronarc'h l'a fait sauter et la minoterie proche que les obus ont épargnée est en feu. Elle illumine sinistrement l'horizon ruiné, comme une torche immense qui veillerait l'agonie de Dixmude et les morts fameux tombés pour sa défense. Ils sont nombreux, les morts, car aucun homme valide n'a voulu servir au triomphe de l'ennemi.
«Lorsque nous atteignîmes le fleuve, raconte un témoin, un Sénégalais se trouvait avec des fusiliers marins, à l'abri de la berge, attendant qu'une passerelle fût établie pour regagner la rive opposée. La minoterie brûlait près de là et le reflet de l'incendie permettait de voir que le tirailleur était horriblement défiguré: le maxillaire pendant retenu par un lambeau de chair, la langue percée. Je regardais cet homme, me demandant comment il tenait encore debout en cet état et je regrettais de ne pouvoir lui apporter aucun soulagement. Il n'était même pas possible de poser un pansement sur l'affreuse blessure.»
"Lorsque nous atteignîmes le fleuve, raconte un témoin, un Sénégalais se trouvait avec des fusiliers marins, à l'abri de la berge, attendant qu'une passerelle fût établie pour regagner la rive opposée. La minoterie brûlait près de là et le reflet de l'incendie permettait de voir que le tirailleur était horriblement défiguré: le maxillaire pendant retenu par un lambeau de chair, la langue percée. Je regardais cet homme, me demandant comment il tenait encore debout en cet état et je regrettais de ne pouvoir lui apporter aucun soulagement. Il n'était même pas possible de poser un pansement sur l'affreuse blessure. II s'avança vers moi. J'eus un sursaut; il me semblait reconnaître un sergent de ma compagnie, Moussa-Keita, un de ces Soudanais d'épopée peints par Baratier, un ancien du Chari, du Congo, du Ouadaï, du Maroc. Je voulus m'en assurer et me penchai sur sa plaque d'identité au poignet. C'était lui! "
Redressant sa haute taille, il me prit la main, qu'il porta à son front, puis sur son cœur; ensuite, il désigna du doigt sa pauvre tête mutilée. Je compris qu'il s'excusait, le malheureux, et j'interprétai ainsi son geste: «Je voudrais» bien servir encore; ma volonté est à vous, Français. Je vous aime; mais je ne peux plus rien. Je vais mourir, regarde-moi.»
L'officier et le brave noir se regardèrent en effet longuement, d'un regard où s'échangeaient les âmes.
«Regarde-moi!», c'est-à-dire: je n'ai pas failli au devoir et à la peine, je meurs en héros. Tous les Sénégalais qui repassèrent sur la rive gauche pouvaient en dire autant. Ils avaient jusqu'au bout accompli, par amour pour la douée France menacée, avec une abnégation sans murmure et une foi inébranlable, le suprême sacrifice. Il ne faut pas qu'on laisse la poussière d'oubli s'accumuler sur un tel holocauste.
L'officier et le brave noir se regardèrent en effet longuement, d'un regard où s'échangeaient les âmes.
«Regarde-moi!», c'est-à-dire: je n'ai pas failli au devoir et à la peine, je meurs en héros. Tous les Sénégalais qui repassèrent sur la rive gauche pouvaient en dire autant. Ils avaient jusqu'au bout accompli, par amour pour la douée France menacée, avec une abnégation sans murmure et une foi inébranlable, le suprême sacrifice. Il ne faut pas qu'on laisse la poussière d'oubli s'accumuler sur un tel holocauste.
Dans la nuit du 16 au 17 novembre, ces héros obscurs s'en allèrent vers Hoogstade. Le commandant Debieuvre avait ramené en cet endroit, de la Maison du Passeur, une centaine de ses hommes: 50 survivants du bataillon colonial Claudel étaient de retour déjà avec ce seul officier de leur garde meurtrière autour d'Ypres, la martyrisée.
Quand, le 1er décembre, le groupe mixte fut dissous à Gyveninchove, ce qui restait debout, après un mois, des quatre bataillons magnifiques était poignant à dénombrer. Ce résidu sublime se dirigeait ensuite sur Fréjus pour y compléter les nouvelles formations noires.
Et depuis, pendant l'expédition des Dardanelles, dans l'Aisne, sur la Somme en 1916, sous Verdun à la reprise de Douaumont et, hier, en Champagne, les tirailleurs d'Afrique ont été partout où il y avait un «coup de chien» à donner. Sans doute, les nouveaux contingents, levés et instruits en hâte, n'ont pas surpassé les prouesses de leurs aînés. Peut-être même n'ont-ils pas su atteindre toujours au courage terrible, sans lassitude et sans merci, de ceux qui combattirent sur l'Yser dans une lutte particulièrement inégale et défavorable. Mais les derniers venus aussi ont largement contribué au labeur de nos plus récentes offensives. Sans déchoir de leur réputation traditionnelle qui les rend si redoutés des Allemands, ils ont ajouté quelques faits dignes de mémoire aux strophes initiales du grand poème sanglant.
Leon Bouquet et Ernest Hosten








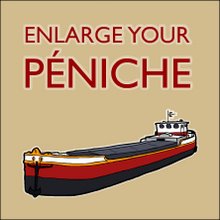

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire