Gorges Motte et les «vingt mille de Radinghem»
Dans un ouvrage paru au sortir de la Grande Guerre, le livre «Les vingt mille de Radinghem» est un témoignage poignant d’un Roubaisien, Georges Motte, qui obéissant à l’ordre d’octobre 1914 d’évacuer Roubaix avec les hommes valides se retrouve en pleine tourmente. Avec ses compagnons d’infortune partis comme lui rallier Gravelines, il est fait prisonnier par les Uhlans et entame une longue captivité.
Pris à Radinghem, il est dirigé sur Carvin puis Douai où un train l’emmène à Meersburg, près du lac de Constance. Sa captivité le mène aussi au château de Celle, à quelques kilomètres de Hanovre. Entre son arrestation et son retour à Roubaix par la Belgique occupée, il dresse des tableaux aussi effroyables qu’humains en décrivant ses conditions de détention, ses compagnons de captivité tant soldats que civils, le quotidien du prisonnier, les différentes nationalités qu’il côtoie, les bassesses comme les gestes grandioses…
Nous livrons donc au lecteur les premières pages de son ouvrage relatant sa fuite à travers les Weppes jusqu’à son arrivée entre une escorte prussienne à Carvin, première étape de sa longue détention qui le tient éloignée de son foyer jusqu’à la fin de 1915…
I. L’ordre d’évacuation
Reportons-nous au vendredi 9 octobre 1914, quand à une heure, parvint à la mairie de Roubaix l’ordre d’évacuation pour tous les hommes valides. Il fallait, sur l’instant, les Allemands approchant, quitter Roubaix et se diriger sur Gravelines selon un itinéraire qui nous serait communiqué à Lille. L’ordre, tout imprévu qu’il fût, n’avait rien de surprenant à première vue, même visant les non-mobilisables. A quoi bon, en effet, s’exposer à être emmené en Allemagne en captivité, comme tant d’autres d’Amiens, de Cambrai, de Valenciennes ? Ne valait-il pas mieux s’écarter pendant quelques jours, pour revenir une fois le flot passé, reprendre ses occupations. Nous ignorions tout de la situation réelle, nous ignorions que déjà le dimanche 4, quand on avait fait évacuer les autos (pourquoi pas les hommes en même temps ?) vers Saint-Omer, certaines de ces autos avaient essuyé des feux de la part des Allemands ; que depuis, Lille était déjà presque encerclé, et que nous allions de façon presque certaine, nous jeter dans la gueule du loup, en essayant de passer par le Nord.
Bref, mis au courant par l’agitation de la rue, de la nouvelle qui vient d’arriver, je me précipite à la Mairie où tout le monde semble avoir perdu la tête, pour avoir une confirmation : l’ordre est formel, tous les hommes valides sans exception doivent partir. Je n’hésite pas, mais je relève d’une maladie qui m’a tenu quinze jours au lit, et je n’aurai même pas la force, je pense, d’aller à Lille à pied. L’usage de la bicyclette m’est encore défendu par le docteur, il faut donc que je trouve place sur un véhicule quelconque. J’ai bientôt de la chance, en faisant mes achats de provisions de bouche pour la route, de rencontrer un aimable fournisseur qui consent à me prendre en supplément sur sa carriole.
Une heure après avoir été avisé de l’ordre de départ, mon petit bagage est fait, mes adieux à ma famille terminés et je monte en famille.
II. L’évacuation sur Lille
Notre voiture s’ébranle au milieu d’une agitation et d’une cohue bien difficiles à décrire. Toute la population est dans la rue, presque tous les hommes s’en vont, et femmes et enfants se pressent autour d’eux pour des adieux émouvants.
Chacun s’est muni d’un léger sac ou d’une petite valise ; la plupart s’en vont à pied, un assez grand nombre en bicyclette, enfin des voitures de tout genre, charrettes garnies de bancs, grands camions d’usines garnis de chaises, sur lesquels s’entassent parfois vingt ou trente voyageurs, tous les véhicules qui n’ont pas été réquisitionnés sont aujourd’hui mobilisés et prennent de la direction de Lille.
Le véhicule sur lequel j’ai trouvé place est une modeste charrette à deux roues où nous trouvons six voyageurs tassés les uns contre les autres.
Nous nous trouvons englobés dans une colonne interminable dont l’écoulement devait durer jusqu’à la nuit.
Le parcours jusqu’à Lille est assez lent à cause de l’encombrement des routes, si bien que nous n’arrivons à Lille qu’à l’obscurité tombante. Hésitant encore si nous allons continuer notre voyage dès le soir, nous voyons alors des groupes revenir vers la grande place de Lille, disant que les autorités ont fait fermer la porte de Béthune par laquelle nous devions nous engager, puis aussi que des Uhlans ont été aperçus aux environs. Bref, il ne paraît pas prudent de cheminer la nuit.
Nous allons donc chercher un logement où nous pouvons, ce qui n’est pas commode car la ville est encombrée de fuyards. Je trouve à me loger à l’hôtel de l’Europe où je prends le dernier repas confortable avant bien des mois et où pour la dernière fois aussi je couche dans un lit.
Le samedi matin, dans l’obscurité, par un temps sombre et triste, dans le brouillard glacial, notre groupe se reforme sur la grande place de Lille. Nous nous dirigeons d’abord vers la Préfecture pour savoir si l’ordre d’évacuation reste maintenu et de recevoir, s’il y a lieu, de nouvelles instructions. Bientôt la foule est nombreuse autour du monument où nous cherchons en vain à qui parler. Nous perdons dans cette attente des moments qui auraient été bien précieux, comme on le verra plus loin. Enfin paraît M. Delesalle, maire de Lille et bientôt de bouche en bouche, est communiqué le nouvel itinéraire : il faut marcher vers l’ouest sur Laventie, nous dit-on, puis de là, remonter au Nord sur Gravelines. Fâcheux conseil, car si nous avions pris au plus court, droit sur Armentières, nous passions dans l’espace libre entre les deux pinces qui allait se refermer.
Enfin, nous voilà en route, il est 7 heures. Nous grelottons de froid sous le brouillard qui tombe, quand, d’une maison près de laquelle nous faisons un arrêt, on nous apporte charitablement une couverture qui est la bienvenue.
Nous traversons Loos, puis Haubourdin, où nous déjeunons rapidement comme nous pouvons, nous étant procuré, non sans peine, un pain entier et de la bière.
A 8 heures ½ nous marchons sur Erquehem-le-Sec ; alors engagés sur une étroite route de campagne, tout à coup, nous voyons apparaître des soldats et rangeons aussitôt la voiture dans un champ pour les laisser défiler. En tête se présentent les artilleurs du 47e, je crois, avec deux canons, puis des fantassins des 7e et 8e territoriaux. Quelques compagnies paraissent absolument harassées. Derrière elles des chasseurs à cheval, ceux de l’active, et bien alertes, puis enfin quelques goumiers montés sur de petits chevaux arabes fringants richement harnachés. Cela faisait au total 2.700 hommes qui allaient pendant deux jours arrêter l’armée allemande en marche sur Lille.
III. La bataille de Radinghem
Nous venons de croiser les troupes se dirigeant sur Lille. A nos ovations, les cavaliers répondent en nous criant : Avancez, la route est libre. Pourtant nous n’avions pas encore quitté les derniers goumiers que nous voyons quelques flanc-gardes, sur un appel, se rassembler, galoper à travers les champs, puis se disperser et se dissimuler les uns derrière des buissons, les autres derrière des meules de paille pour observer avec soin l’horizon. Cette manœuvre n’est pas sans nous causer quelque inquiétude ; pourtant, après les paroles rassurantes que nous venons d’entendre, nous nous décidons à avancer sur un terrain que nos troupes viennent de quitter. Nous parcourons environ un kilomètre, nous classant peu à peu dans les premiers de la colonne des évacués.
Tout à coup, des cyclistes isolés, reviennent vers nous, pédalant à toute vitesse, et semblant saisis de panique. Impossible d’obtenir d’eux un renseignement au passage ; ils fuient aussi vite qu’ils le peuvent, parmi nos groupes de plus en plus serrés.
Nous continuons donc à avancer, maintenant presque seuls, car le gros de la colonne a rebroussé chemin pêle-mêle, après l’alerte donnée par les cyclistes. Nous sommes maintenant dans le village de Radinghem dont nous dépassons l’église. Une route vient couper perpendiculairement celle que nous suivons et nous approchons du carrefour, quand un cavalier allemand traverse ce carrefour au galop, venant de notre gauche et continue vers la droite. Nous comprenons avec terreur qu’il est trop tard, et que nous allons être cernés. A moins que ce cavalier n’annonce qu’une simple patrouille de reconnaissance, et qu’après le passage de celle-ci, si nous ne sommes pas vus, nous puissions encore nous échapper !
Essayons donc de nous cacher ! Précisément, nous sommes près d’une maison qui semble abandonnée, et, à côté de cette maison, dans une cour dont la porte est grande ouverte, se trouvent des hangars, écuries et remises, où nous pourrions nous dissimuler. Nous nous y jetons au trot de notre cheval, puis sautant à terre, nous claquons la porte d’entrée derrière nous, poussons la voiture dans un coin et nous nous cachons dans l’écurie, en silence. Le calme s’est fait autour de nous, et de tous les piétons qui suivaient nous n’entendons plus personne arriver ; tous ont dû prendre la fuite.
Soudain un coup de feu, puis un galop de cheval dans la rue. Puis le silence. Au bout de quelques minutes, je sors de ma cachette pour me rendre compte de la situation. Je jette un coup d’œil dans la propriété qui nous a servi de refuge ; elle est complètement abandonnée ; je m’avance prudemment dans le jardin, et à travers les haies de clôture, j’aperçois deux ou trois cavaliers allemands galopant à travers champs, et semblant chercher l’ennemi soudain évanoui.
A nouveau quelques coups de feu isolés à proximité, puis, tout à coup, le crépitement si caractéristique des mitrailleuses se fait entendre à quelques cent mètres de l’endroit où nous sommes. Je m’attends à ce que les Allemands qui doivent s’être approchés de nous ripostent et nous prennent entre deux feux.
Le danger, toutefois nous l’avons vu presque aussitôt après, n’était pas pour nous car l’action s’est déroulée sur notre gauche, mais beaucoup de nos compagnons furent dans la situation que j’avais redoutée pour nous-mêmes. Surprise en tête par l’arrivée des cavaliers allemands, ne pouvant reculer, la foule se porta vers les troupes françaises mais n’eut pas le temps de s’abriter derrière elles. La panique se mit parmi elles ; hommes, femmes, enfants, se réfugièrent en masses dans les maisons environnantes ; mais la plus grande partie, au moment où les mitrailleuses commencèrent à parler, bientôt suivies par la canonnade, n’eut d’autre ressource que de se terrer dans les fossés de la route, ou même dans les champs de betteraves ou de choux, en proie à la plus compréhensible des terreurs, au milieu des balles qui venaient de tous les côtés.
Après quelques minutes de canonnade et de fusillade, nous sommes un peu rassurés pour notre existence en constatant que nous ne sommes pas dans le rayon de l’action. Nous n’entendons près de nous que le galop des cavaliers isolés qui passaient sur la route sans ralentir, et peu à peu nous reprenons un léger espoir de pouvoir échapper, si, après la bataille qui semble cesser, les Allemands reculent, ou même si suivant la colonne française, ils s’éloignent de nous. Vain espoir ! Tout d’un coup, au lieu d’un bruit de galop, nous entendons le trot moins pressé d’un cheval que son cavalier arrête à maintes reprises, sans doute pour inspecter les environs. Ce cavalier stoppe malheureusement juste à notre porte, et se hissant sur ses étriers, il aperçoit dans la cour une voiture abandonnée.
Aussitôt, à ses cris de triomphe, aux coups de lance qu’il donne dans la porte, nous comprenons qu’il n’y a plus rien à faire. Nous nous montrons. La porte ouverte, il nous chasse sur la grand’route, nous donne l’ordre d’attendre et, premier soin, va inspecter nos valises sur la voiture. Ma valise, contenant quelques conserves appétissantes, et du linge neuf, a l’honneur d’être attachée à sa selle. Un autre honneur m’était encore réservé par mon vainqueur, qui, voulant avoir fait un prisonnier de marque, me demanda dans son « baragouin » si j’étais le « bourgmestre », après quoi, il me pria, aimablement du reste, de lui offrir un cigare, et se saisit de mon étui, en voyant qu’il était bien garni.
IV. Première étape : de Radinghem à Carvin
Au bout de quelques minutes, notre Uhlan, après avoir pris dans nos sacs tout ce qui pouvait l’intéresser, nous pousse devant lui sur la route, la lance en arrêt. Nous rebroussons chemin vers Radinghem. Il est 10 heures du matin, et le soleil qui perce enfin le brouillard, nous permet de voir un spectacle émouvant.
De tous les points de l’horizon apparaissent des groupes de civils, hommes, femmes, enfants, pourchassés par des soldats allemands ; il en sort de toutes les routes, de tous les sentiers, de toutes les maisons. Partout se voient les traces de la panique qui s’est produite ; des bicyclettes abandonnées par vingtaines dans les fossés, contre les maisons, des valises de toutes dimensions abandonnées par les fuyards ; des cannes, des chapeaux sont semés de ci de là.
Les femmes et les enfants s’approchent des officiers, et essaient, mais en vain, de les apitoyer. Vite et brutalement, nous sommes massés puis mis en colonne par quatre, et houp ! au pas de gymnastique ! Il s’agit de mettre en sûreté le précieux butin ! Et, comme les Français ne sont peut-être pas loin, il n’y a pas une minute à perdre ; il faut faire de la vitesse. Nous marchons et nous courons tour à tour à travers champs.
A l’abri derrière une ferme, nous voyons un brillant état-major, un général, je crois, avec son porte-fanion, et ses officiers, dont l’un braque sur nous un gros revolver, en répétant à chaque instant : « Pas un mot ! Pas un geste ! » pendant qu’on nous fait entrer dans un chemin creux qui conduit dans une autre direction que celle suivie jusqu’alors.
Pendant une heure au moins, nous marchons à toute allure, principalement au pas de course, talonnés par nos gardiens, qui distribuent les coups de lance dans le dos à ceux qui ralentissent le pas.
Ce n’est qu’un peu plus tard, quand nous sommes arrivés à Fournes, localité occupée par les troupes allemandes, qu’il nous a permis de ralentir un peu notre allure essouflante. C’est là que nous avons eu la première impression d’une ville sous l’occupation allemande.
A l’entrée de la ville se trouve un château ; sous les arbres de l’allée, des soldats attablés buvaient le champagne au goulot ; la ville paraissait morte et déserte, tous volets fermés aux maisons et les habitants apeurés se cachaient. Un autre groupe de prisonniers venant d’une autre direction vient grossir notre colonne, et après quelques instants d’arrêt, nous reprenons notre marche.
Peu après Fournes, nous commençons à voir les traces de récents combats. Ce sont d’abord des cadavres de chevaux abandonnés et gisant sur la route, les membres raidis, des carcasses de bœufs qui avaient été dépecées et dont les os et la peau avaient été laissés sur place ; puis, plus loin, des meules de blé fumant, les unes réduites en un monceau de cendres, d’autres ayant conservé après l’incendie leur forme et presque leur volume ; plus loin ensuite des maisons aux toitures trouées puis d’autres incendiées dont il ne restait que les murs. A gauche de la route, un grand moulin à vent brûle encore et sur une grosse poutre en flammes, un soldat allemand, dans une énorme poêle, fait cuire une omelette de Gargantua.
Après trois heures de marche rapide, et un trajet que j’estime à 16 ou 18 kilomètres, nous sommes, semble-t-il, sortis des régions dangereuses pour les Allemands, car on nous autorise à nous arrêter un quart d’heure. Nous nous laissons tomber le long du chemin, et nous nous étendons sur les talus ; je me souviens qu’en sautant dans un fossé pour m’asseoir sur le talus, je découvris sous mes pieds une cuirasse française cachée sous un tas d’herbes.
Pendant ce repos si nécessaire, la plupart de mes compagnons commencèrent à toucher à leurs provisions de route, mais pour mon compte, dépouillé comme je l’ai dit des miennes, je ne pus que les regarder manger.
Notre marche, recommencée bientôt, devait encore pour ce premier jour durer quelques heures, sans incident heureusement, et un peu moins pressée qu’au début ; du reste, la fatigue commençait à être grande chez des gens aussi peu entraînés que nous l’étions généralement ; car, j’insiste sur ce point, notre foule ne comprenait alors que des hommes non mobilisés jusqu’alors, parce que débiles : ou trop jeunes ou trop vieux.








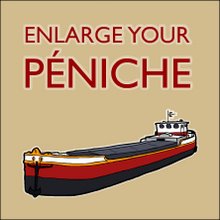

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire