Déportées par les Allemands
par Mme Henriette Celarié
Crimes de guerre
La civilisation, pensions-nous, avait consacré la liberté de l'individu et condamné à tout jamais l'esclavage. Nous nous trompions. Il appartenait aux Allemands de le faire revivre. Pour savoir à quel degré de barbarie, de cruauté peut en arriver un peuple sans scrupules, lisons le récit d'une Lilloise, Marie X... Quand elle a été enlevée, elle venait d'avoir vingt ans: «Une enfant, une vraie enfant», dira l'un des soldats chargés de l'emmener.
I
Les enlèvements ont commencé en avril 1916. Le premier a eu lieu le Samedi Saint, à Fives, en pleine nuit. Les Allemands prirent indifféremment jeunes filles, jeunes gens, pères de famille. Des scènes terribles se produisirent. Ceux qu'on avait désignes ne voulaient pas se laisser emmener. Les Allemands apportèrent des mitrailleuses et tirèrent sur la foule.
«A Lille, notre angoisse était grande. Vainement nous essayions de nous rassurer en pensant que Monseigneur Charost avait protesté, ainsi que le Maire, M. Delesalle, auprès du gouverneur allemand; nous savions les Allemands capables de tout.» Marie X... a raison de trembler. Vers deux heures et demie, dans la nuit du lundi de Pâques, elle est réveillée en sursaut,
Des soldats passent dans la rue. Devant chaque maison, ils s'arrêtent par petits groupes. Je me précipite dans la chambre de mes parents:
- Les Allemands sont là; ils vont m'enlever. J'ai peur; j'ai peur...
Mon père se lève et, pour me tranquilliser:
- Va te recoucher; «ils» font les maisons de l'autre côté de la rue; ils ne viendront pas ici...
Au même instant, la sonnette tinte, violemment agitée. Marie X... descend. Dix soldats sont dans le vestibule. L'un d'eux prend la parole:
- Tenez-vous prêts. L'officier va passer pour désigner les personnes qui devront partir.
- Nous habitions une grande maison à appartements, explique Marie X... Bientôt tous les locataires sont dans le vestibule. L'officier arrive.
Les Allemands ont décidé que les mères de famille ayant des enfants au-dessous de 14 ans ne seraient pas enlevées. Toutes les jeunes femmes qui habitent la maison sont dans ces conditions. L'officier parcourt la feuille de recensement apposée dans le vestibule.
Il arrive à mon nom, demande où je suis et dit:
Préparez-vous à partir.
Petite et gracile, Marie X...est d'aspect délicat. Ses cheveux tressés, pour la nuit, en une natte qui flotte sur son dos, la font paraître plus jeune que son âge. Son père supplie l'officier:
- Monsieur, ce n'est pas possible. Vous ne ferez pas cela. Ma fille n'est pas forte; elle est trop jeune...
L'officier répond, narquois:
- Justement, l'air de la campagne fera du bien à Mademoiselle.
- M. X.:. insiste:
- Prenez-moi à sa place. Vous y gagnerez. Je travaillerai mieux qu'elle.
L'officier secoue la tète et montrant sa victime, en riant:
- Non, non; c'est elle que nous voulons; elle, la petite «Mademoiselle ».
Il fait demi-tour. Alors, un des soldats considérant Marie X... s'écrie:
- C'est une enfant, une vraie enfant...
A quoi l'un de ses camarades réplique:
- La vie qu'on va lui faire mener la développera.
- Moi, raconte Marie X..., je sanglotais sans pouvoir m'arrêter.
Cependant elle doit s'apprêter:
Mon père, qui a un permis de circulation , peut m'accompagner; mais, il me faut dire adieu à maman, dont jusqu'ici je n'ai jamais été séparée.
C'est un vrai déchirement. Mme X... se cramponne à sa fille, les soldats la lui arrachent; Mme X... se traîne sur le dallage, s'accroche aux uniformes des Allemands, les supplie:
- Ma fille, mon enfant, ah! ah!...
- Dans la rue, raconte Marie, aussi loin que j'ai pu voir maman, je l'ai aperçue, penchée à la fenêtre de la salle à manger et me criant à travers ses larmes:
- Adieu, adieu...
M. X... porte la valise de sa fille. Dix soldats, baïonnette au fusil, les encadrent. Dix soldats pour emmener une enfant!
II
Marie est conduite dans un café. Cinquante captives y sont déjà réunies. Jusqu'au dernier moment, M.X... montre une attitude courageuse: "Pauvre papa, il m'embrasse sans verser une larme; mais quand il m'a quittée je le vois tirer son mouchoir; il pleure".
Captifs et captives continuent d'arriver: « Je cherche si je ne vois pas quelque figure amie. Soudain, j'aperçois Jeanne B..., une de nos voisines.
Je vais à elle; nous nous promettons de rester ensemble. L'ordre du départ arrive. On nous fait monter dans un tramway; mais au lieu de nous mener directement à la gare, on nous fait faire le tour de la ville.
On dirait que les Boches veulent nous exhiber pour narguer nos concitoyens.»
Après une longue journée d'attente dans le hall de la tir gare « Fives-Magasin », les captives montent dans des wagons à bestiaux dont on boucle la porte. Le convoi part. Et, voilà qu'en passant, près d'Hellemmes, une clameur parvient jusqu'aux prisonnières. Leurs parents, leurs amis, massés sur le pont du chemin de fer, leur crient adieu: « Nous ne pouvions les voir, nous ne pouvions leur répondre; mais leurs cris résonnaient dans nos cœurs. »
III : Le Voyage
Le voyage s'accomplit avec une extrême lenteur: «Dans notre wagon nous sommes entassés à trente. La plupart de mes compagnons sont des hommes. Au bout de peu de temps, ils ont lié connaissance. Ce sont de braves gens, sans doute; mais ils sont d'une grande grossièreté: Ils fument, chiquent, crachent.» La plupart sont en état d'ébriété. La fête de la veille, ils l'ont passée au café: «Ils tiennent des propos comme je n'en avais jamais entendu; des propos qui me révoltent et ajoutent à mon chagrin. Je me disais: Mon Dieu! où suis-je tombée!»
A la douleur morale de Marie, s'ajoute la souffrance physique: « Nous avons soif; depuis le matin où, à deux heures, nous avons été enlevés, nous n'avons rien bu qu'un peu de café dans le hall de la gare. Nous demandons aux soldats qu'ils nous donnent de l'eau. Ils ont pitié de nous et nous versent de leur café de malt dans un quart; nous nous le partageons buvant à la ronde. »
Pas mauvais au fond, dira-t-on, ces soldats; pourtant quel manque de respect ne montrent-ils pas, au cours du voyage, pour la pudeur de leurs prisonnières:
«Plus d'une de nous éprouve le besoin de descendre. La marche du wagon étant très haute, les Allemands nous portent dans leurs bras, nous serrent contre eux plus qu'il n'est nécessaire. Une fois à terre, la sentinelle prétend nous accompagner.»
Apercevant un wagon sur une voie de garage, Marie X... court pour s'abriter derrière. L'homme la suit et, au lieu de se détourner, il observe la jeune fille, la regarde curieusement avec une mine à souffleter. Après un long arrêt à Hirson le train repart, roule toute la nuit. Vers les six heures, les prisonniers arrivent à D... En attendant qu'on les emmène, on les parque, au soleil, sur la route. Ils y restent jusqu'au soir, sans que nos ennemis s'inquiètent de leur donner à boire et à manger.
IV
Vers cinq heures et demie les maires de communes voisines arrivent avec des chariots pour transporter les cap tifs dans les villages où ils devront travailler. «Celui dans lequel je monte avec Jeanne s'enfonce dans la campagne; nous traversons des bois, nous descendons dans des vallées. Enfin, vers neuf heures, nous arrivons dans un hameau. Le chariot s'arrête devant une ferme. Jeanne et moi descendons. La fermière nous guide à travers la cour, nous conduit à une maisonnette délabrée et divisée en deux parties: l'une sert d'étable, l'autre, depuis 15 ans, sert à loger les poules et les lapins.» Dans la journée, dès qu'elle a été prévenue qu'elle aurait à loger des «émigrées», la fermière s'est hâtée de déménager ses bêtes; mais une croûte épaisse d'ordures couvre encore le sol, des toiles d'araignées demeurent dans les coins; une odeur abominable imprègne la pièce. Les deux jeunes filles se regardent atterrées: «Nous sommes tellement fatiguées, cependant, que notre désir est de nous coucher au plus vite, dormir, oublier. Pourtant c'est ce que nous ne pouvons faire. Dans le wagon, où nous avons voyagé, nous avons attrapé de la vermine. Des démangeaisons nous tiennent éveillées. Puis notre poulailler n'est guère paisible: tantôt, par la cheminée, ce sont des chats-puants qui jettent leurs cris lugubres; tantôt ce sont de gros rats.» Ils viennent de l'étable, ils entrent par les trous du mur, ils grimpent sur le lit et inspirent aux pauvres petites, une peur, un dégoût insurmontables.
Au petit matin, à peine levées, Marie et Jeanne vont à la rivière faire leur toilette car elles n'ont ni broc, ni cuvette; puis elles bouchent de leur mieux les trous du mur; avec des brindilles, elles font un balai; après quoi, elles vont chercher du bois pour cuire leur repas. Jusqu'ici à Lille, chez ses parents, Marie X... aidait aux soins du ménage, mais tout gros travail lui était épargné, La plus grande partie de ses journées, elle l'occupait en travaux à l'aiguille ou à jouer du piano: «Ici, au contraire, il nous faut tout faire par nous-mêmes. Nous manœuvrons la hache mais nos mains sont écorchées; il nous faut plusieurs heures pour faire nos fagots, plusieurs heures pour les rapporter, les débiter en petits morceaux et quand nous avons fini, nous constatons auec désespoir que nous avons du bois au plus pour une demi-journée.»
V
Les captives sont menées militairement. Ne sont-elles pas « soldates »? N'ont-elles pas le grand honneur de faire partie du VIe corps de l'armée du Prince de Bavière! Des sous-officiers les commandent. Parmi ceux-ci, l'un, Hickel, se montre particulièrement odieux. Il a remarqué Marie X... Il ne cesse de tourner autour d'elle:«Il y avait environ 15 jours que nous étions déportées quand, un après-midi, le garde- champêtre publie que nous allions subir une visite médicale! » Pour en avoir entendu parler, Marie n'ignoré rien des détails monstrueux qui accompagnent cette visite. Des femmes qui ont refusé de la subir, ont été déshabillées de force par les gendarmes et, devant eux, ont eu la honte d'être examinées par le major:
- «Mon tour vient. J'entre dans la chambre où se tient le major. Hickel entre sur mes talons. Il ferme la porte.
Le major me dit:
- Déshabillez-vous.
Je me tourne vers Hickel:
- Pas tant que «Monsieur» sera là. Il n'était pas ici, pour les autres; pourquoi veut- il y être pour moi? Hickel rit; le major n'a pas l'air d'attacher d'importance à ce que je dis; il me réitère son ordre, mais je m'enferme dans la même réponse; alors le major dit quelques mots à Hickel qui se retire l'air vexé. La visite a lieu. Mais en sortant de la chambre, je dois signer sur un registre; Hickel est devant la table; il me sourit:
- Ma petite chérie, quand pourrai-je aller te voir?..
Je ne lui réponds pas; alors se tournant vers les soldats, il s'écrie:
- Elle est bien méchante; mais c'est un joli cœur!
- Elle est bien méchante; mais c'est un joli cœur!
VI
Son projet, Hickel le met a exécution. Profitant des moments où Jeanne est absente, presque chaque jour, il vient harceler Marie. Il entre, il s'assied sur l'unique chaise, il lance la fumée de son cigare:
- Bonjour, mon trésor; pourquoi es-tu si méchante avec moi?
Il se lève, s'approche du lit et avec un clin d'œil:
- Est-ce que ton lit est bon? Ma petite chérie, coucher toute seule! Pas bon!
Il essaye de prendre la jeune fille sur ses genoux, de l'embrasser. Elle se défend.
Mais, dit-elle, je suis livrée à sa fantaisie le jour où il voudra la satisfaire. Crier? Appeler? Personne ne viendra. Qui donc, dans le village, aurait envie, pour moi, une «émigrée», de s'attirer une affaire avec un chef!
Jeanne, elle, est importunée par l'un des gendarmes; un matin, elle est en train de faire sa toilette; elle a seulement sa chemise, son jupon. Le gendarme entre sans frapper, il va la saisir; Jeanne a juste le temps de sauter par la fenêtre.
- La crainte d'être prise par un de ces Allemands était pour nous ce qu'il y avait de plus épouvantable. Savoir si nous aurions de quoi manger, savoir si l'on nous ferait travailler encore davantage, nous n'y pensions que par instants. Une seule idée nous obsédait, nous faisait sursauter au moindre bruit de pas...
Une nuit, un choc léger éveille Marie. Avec le bout du doigt, on frappe à la vitre. Marie secoue Jeanne:
"Entends-tu?" A voix basse, mais très distinctement, un allemand dit:
- Mademoiselle, ouvrir, ouvrir vite...
Les deux jeunes filles, muettes de peur, se serrent l'une contre l'autre.
Le soldat continue son manège:
- Ouvrir vite.
Il fait le tour de la maison, il tourne le bouton de la porte. Heureusement, le verrou est poussé; l'homme essaye d'enfoncer le vantail; il revient à la fenêtre, répète les mêmes mots.
- Vite ouvrir, vite.
Jusqu'à quatre heures du matin, il tient les jeunes filles haletantes de frayeur.
- Nous n'osions faire un mouvement. De temps en temps, Jeanne me chuchotait:
- Il est toujours là!
Je répondais dans un souffle.
- Oui...
Des nuits analogues à celle-là, se renouvellent à maintes reprises.
- Nous n'osons plus dormir ou plutôt nous n'osons nous endormir qu'à l'aube; alors les paysans se lèvent, nous nous imaginons que Hickel ou l'un de ses camarades ne se risquera pas à pénétrer dans notre chambre. C'est épouvantable, ces nuits sans sommeil à cause de la peur.
Pourtant, nous n'étions pas encore les plus malheureuses:
A B..., village tout proche de notre hameau, cent cinquante femmes sont logées ou plutôt parquées dans un grenier. Elles couchent pêle-mêle sur la paille. Elles sont dévorées de vermine. Là, la prostitution est organisée publiquement. Chaque soir, sur le pas de la porte, des sortes d'enchères s'organisent; les soldats font l'appel des femmes qu'ils désirent pour la nuit.
« - Charlotte... trois tablettes de chocolat...
« - Louise... un mark et une tablette...
Les malheureuses sortent de la paille où elles sont nichées, suivent celui qui les appelle.
Pour s'excuser, les Allemands affirment que leurs prisonnières sont toutes des prostituées. Ils mentent. Nous savons qu'ils ont enlevé indifféremment les femmes honnêtes et les filles publiques: «Une des choses les plus pénibles de ma captivité, se rappelle Marie X..., ça a été de sentir peser sur moi le regard méprisant de ceux qui, ne me connaissant pas, me prenaient, sur le dire des Allemands, pour ce que je n'étais pas; ça a été d'entendre les petits enfants bien souvent me salir, au passage, de mots injurieux qu'ils répétaient pour les avoir entendu dire à leurs parents:
« - P..., garce..., femme à Boches!
Femme à Boches! Impossible de leur faire comprendre, de leur expliquer. Je n'avais qu'à rentrer dans ma chambre pour m'y cacher.»
Quelle tristesse dans cet aveu rendu plus poignant de ce qu'il est fait par une enfant de vingt ans.
VII
Courbées sur la terre, brûlées par le soleil, trempées par la pluie, les captives doivent travailler sans relâche. De sept heures du matin, jusqu'au crépuscule, elles n'ont d'autre répit qu'un quart d'heure dans la matinée et l'après-midi et deux heures au milieu du jour: onje heures de labeur: «Le soir, je rentrais tellement exténuée que je n'avais même pas le courage de manger. Je me jetais sur notre paillasse.» Les travaux se suivent ininterrompus. A la fenaison succède la moisson: « Les gerbes de blé sont lourdes, il faut les soulever, les tendre à bout de bras avec la fourche. A force d'appuyer le manche de celle-ci contre ma hanche, j'ai le côté meurtri. Une fois, dans un mouvement à faux, je me donne un effort. Je dois continuer de travailler. Quand je pense qu'à ta maison, je me couchais pour une migraine!... Les jours de pluie, nous ne pouvons même pas nous reposer. Le blé qui est rentré, nous devons le battre à la machine. La poussière est suffocante. Il y a des instants où je n'en peux plus, je suis à bout. Je voudrais me reposer, ne serait-ce qu'une minute; mais alors paraît Hickel ou le chef de culture boche:
- Vous n'avez pas l'air de vous donner beaucoup de peine. Travaillez.
Parfois l'ordre s'accompagne d'un coup de bâton, d'un coup de cravache. Celles qui refusent de travailler, on les y contraint sous la menace des fusils; on les condamne à quinze jours de cachot, dans une cellule absolument obscure ou encore: «on les met dans une cave avec de l'eau jusqu'aux genoux; on les y laisse plusieurs heures, plusieurs jours, jusqu'à ce qu'elles cèdent...»
La moisson finie, les avoines rentrées, les «esclaves» doivent arracher les pommes de terre. «Jamais un jour de repos; même pas une demi-heure, le dimanche, pour aller à la messe!» Tous ces travaux, les malheureuses les exécutent, à peine nourries. Les Allemands ne pourvoient pas à leur alimentation: « Nous n'avons que ce que nous fournit le ravitaillement américain: un peu de riz, des haricots et du saindoux. Pas un jour, où nous n'ayons eu faim!»
VIII
Ainsi, durant plus de six mois, Marie X... ne cesse de peiner pour ceux qui la tourmentent. Enlevée en avril, c'est seuement à la mi-octobre qu'elle est «repatriée».
Elle rentre dans Lille. « Mes parents n'ont pas été prévenus de mon retour. Personne ne m'attend à la gare. Je me dirige vers la maison. Aux fenêtres, des têtes, se penchent, on me reconnaît. Maman m'ouvre la porte: Je suis dans ses bras; nous rions, nous pleurons, nous nous embrassons puis nous recommençons à rire et à pleurer. Maman me regarde comme si elle ne pouvait croire que je suis là:
- Ma pauvre chérie, dit-elle, dans quel état tu es! comme tu es maigre; tes pauvres joues, tes yeux creux... Comme tu as souffert! ...
Cependant, tandis que je déjeune d'un bol de bouillon et d'un œuf, j'entends la voix de mon père. Il demande à nos voisins:
- Est-ce vrai que ma fille est là?
Je crie:
- Oui, oui!
Je cours au devant de lui; mais en me voyant, papa ne peut plus avancer. Il s'appuie au mur pour ne pas tomber. Je l'aide à entrer dans la salle à manger et tous les trois, nous recommençons à nous regarder, à nous embrasser, à pleurer, sans pouvoir nous arrêter.
Telles sont ces notes dans leur douloureuse simplicité. La victime les a rédigées dans la forme, non d'un réquisitoire mais d'un procès-verbal: «Les choses se sont ainsi passées; «Ils» nous ont fait cela...» Cette impersonnalité produit, sans y prétendre, une impression plus forte que ne le ferait une violence pourtant bien justifiée.
Quant à moi, je me bornerai à dire à chacun des lecteurs, à chacune des lectrices:
- Imaginez-vous que celle dont le supplice vient de vous être décrit est votre propre fille.
Et demandez-vous si de telles infamies peuvent n'être pas payées, si les nations civilisées peuvent renouer avec leurs auteurs un lien quelconque. Il ne s'agit plus ici d'actes de guerre, mais de simples crimes de droit commun. Ils doivent être châtiés comme tels. Flétrir les criminels ne suffit pas. Il faut les traduire devant les tribunaux qui, sans colère, mais impitoyablement, comme il convient à des juges, les jugeront et les condamnez!
(tiré d'une brochure)








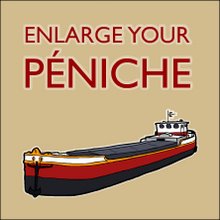

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire