Bientôt le 11 novembre, jetons un regard en arrière
de la Revue 'L'Illustration' no. 3962 de 8 février 1919
'à Travers les Régions Libérées du Nord'
par Emile Henriot
Misère et Destruction
Lille, Ville Anglaise. - Un Village qui Renaît. - Ce qui Fut fa Fosse 13, à Hulluch. - Une Terre ou Rien ne Pourra Plus Pousser. - Le Désert de Lens. - Comment les Allemands Ont Détruit les Mines, et Comment Elles Vont Revivre. - à Valenciennes.- Sur les Ruines d'une Grande Aciérie. - Un Contraste.
Lille, 26 janvier
Bien que la guerre soit finie et que le front en soit maintenant éloigné de près de 500 kilomètres, Lille est encore une ville de guerre et continue à faire partie de la zone des armées, secteur anglais. Par une anomalie singulière, Lille apparaît comme une ville anglaise aux yeux du voyageur étonné. Elle présente ce spectacle bigarré que nous avons autrefois connu à Amiens, à Rouen, à Calais. De là sans doute, malgré la bonne volonté et la courtoisie de nos alliés britanniques, beaucoup de difficultés relatives au prompt règlement de tant de questions compliquées: transports, réfection des voies, des canaux, remise en état des fabriques, des usines détruites. Autorité militaire anglaise, pouvoir civil français, municipalités, administrations locales... trop de services se superposent et se gênent. Dans la rue, cependant, le bizarre mélange des uniformes, le va-et-vient des attelages, des camions, des convois, les soldats qui flânent, créent une animation factice qui rend la ville presque gaie.
Pourtant, plus de tramways, faute d'électricité; quelques rares omnibus à chevaux sont ressortis. La plupart des magasins n'ont pas rouvert, et les devantures montrent des étalages aux trois quarts vides... Beaucoup de ruines aussi, aux alentours de la gare: tristes murs rongés par les flammes, encore miraculeusement debout, vastes amas de décombres noircis où l'herbe croît déjà. Lille sent la guerre encore.
Ce matin, sur la grande place encombrée de camions, d'automobiles, la fanfare d'un régiment de nos chasseurs cantonné aux alentours donnait un alerte concert de cuivres, au milieu d'un cercle de badauds charmés et de tommies oisifs. D'une rue, débouche une colonne aux uniformes vert-de-gris, vert aigre. Ce sont des Allemands, car il y a encore des Allemands à Lille... mais prisonniers. Ceux-ci, sous bonne garde anglaise, baïonnette au canon, vont travailler, non loin. C'est bien le moins qu'ils réparent aujourd'hui ce qu'ils ont détruit hier. La morne troupe s'éloigne, sous les regards indifférents des promeneurs. Vraiment, nous avons, en France, la haine courte...
En auto, sous l'obligeante conduite de M. Labbé, inspecteur de l'Enseignement technique, et zélé secrétaire général du Comité d'alimentation auquel les régions libérées doivent d'être enfin convenablement ravitaillées, nous filons, le dessinateur Jonas et le signataire de ces lignes, vers la campagne voisine, pour aller voir sur place comment la vie renaît dans les ruines... A peine sommes-nous sortis de la ville, nous entrons dans la zone dévastée qui borde.
Sur une profondeur de plusieurs kilomètres, l'ancien front. Voici des terre en friche, les réseaux barbelés des secondes lignes; de-ci, de-là, un trou d'obus un pont détruit, une route explosée. Puis des ruines.
C'est le village de Wavrin - ou plutôt c'était... Wavrin ne se trouvait pas sur le champ de bataille; ce n'est pas le combat qui l'a tué, mais l'Allemand qui, avant de partir, l'a systématiquement détruit. Le mode de destruction était laissé au choix de la troupe chargée de l'exécuter: elle varie, suivant les villages, et l'on peut distinguer, entre les ruines, la méthode qui fut employée.
Là, c'est le feu: murs debout et noircis, débris calcinés, toits effondrés; ici, la dynamite. Une bombe a été placée dans la cave, ou bien une rangée de pétards le long d'un mur; mise à feu électrique, tout a sauté...
En général, quand il s'agit d'une maison à deux ou trois étages, l'explosion a détruit toute la cage intérieure de la bâtisse, et sur la poussière de débris qui en reste, jonchant le sol, la toiture s'est effondrée, comme le chapeau d'un vol-au-vent qui aurait fondu en cuisant. Or, un curieux détail qui montrera bien avec quel esprit de perverse malice les Allemands ont prévu et méthodiquement organisé la destruction des contrées qu'ils devaient évacuer, dans leurs parties les plus riches, c'est que toutes les belles maisons ont été ainsi jetées à bas: tout-ce qui avait une cave n'existe plus.
A Wavrin, les quelques pauvres masures qui subsistent ne valaient pas la charge de poudre nécessaire à les réduire en cendres, et c'est à quoi quelques-unes doivent de survivre. Le village, détruit aux deux tiers, comptait 4.000 âmes, avant la guerre. Quand les Allemands l'occupaient, 2.500 habitants y vivaient encore; aujourd'hui 2.700 sont revenus dans ses ruines. Ce chiffre n'est-il pas éloquent, ne dit-il pas quel aimant mystérieux est cet amour de la terre natale qui fait revenir où ils sont nés tant de malheureux, même assurés de n'y plus rien trouver de ce qui leur fut cher?...
Nous avons assisté au spectacle émouvant de ces retours. D'un amas de briques effritées, de bouts de bois brisés, un homme sort et nous salue. Il rit, et hochant la tête: « Voilà ma ferme, nous dit-il. C'était une belle ferme à deux étages. L'étable était là, la maison ici... » Nous interrogeons ce pauvre diable. Il ne se plaint pas. Il dit que le ravitaillement va bien, et qu'il sait qu'on s'occupe de lui. Et, tout de suite, il nous parle de ce qui lui tient le plus à cœur: sa terre. Il veut travailler, il a déjà entrepris de défricher son champ. Pour le moment, il loge avec sa femme dans une maison voisine, restée intacte; et d'ici quelque temps, il pense s'être fait un abri dans ses ruines mêmes.
Nous quittons cet homme; un soldat passe; c'est un permissionnaire qui revoit son village pour la première fois depuis cinq ans. Celui-là, paysan riche, avait trois maisons à Wavrin; toutes les trois sont anéanties. Il nous dit ces choses sans amertume, sans colère, et savez-vous comment il conclut? - « C'est 200.000 francs que je perds, toute ma fortune. Mais ça ne fait rien, j'en ai bien tué... On est Français, on ne manque pas de courage! » ...
Un peu plus loin, sur une échelle, un autre, la truelle en main, reconstruit un mur éboulé: voilà déjà une maison qui renaît. Au milieu d'un toit en lambeaux, un petit filet de fumée monte, qui va se perdre dans le ciel: c'est une cheminée qui fume, un foyer s'est repris à vivre. Ici, chacun s'entr'aide. Dans une humble ferme où nous entrons, nous trouvons deux pièces: les propriétaires du lieu, un vieux paysan, sa femme et sa fille habitent la première; pour la seconde, large de 3 mètres sur 4, ils l'ont donnée à une autre famille qui, elle, est sans toit:
c'est huit personnes qui occupent cet étroit espace; deux des enfants, malades, avec la fièvre, tremblent et grelottent dans le lit... En vain essaie-t-on de persuader à ces pauvres gens de renoncer à leur village, pour un temps, de venir à Lille, par exemple. A une proposition de cette sorte, une vieille femme répond devant nous avec énergie: « J'aime mieux rester dans m'niche à lapins qu'aller habiter dans vot' Lille! »
Ces gens ne se plaignent pas et ne réclament rien, mais leur résignation n'a rien d'inerte. Ils veulent travailler. Ils demandent seulement des chevaux pour labourer leurs terres, des outils, des brouettes, des baraquements, pour attendre, à l'abri, qu'on ait pu reconstruire leurs demeures effondrées.
On s'occupe d'eux, c'est certain; mais le fait-on assez vite? Nous avons vu, dans ce village, une baraque terminée, garnie de douze lits chauffée par trois poêles, et destinée à servir d'hôpital pour les malades. C'est très bien; mais il n'y manque que le médecin, les infirmières et la pharmacie... Est-ce si difficile à trouver?
Nous avançons, nous voici sur l'ancien champ de bataille, et tout à coup nous pénétrons dans une ville. A 200 mètres, on ne pouvait pas la deviner seulement... C'est La Bassée.
Faut-il encore entreprendre de décrire, une fois de plus, le spectacle navrant de cette ruine totale, de cet amas de pierraille brisée, de ferraille tordue, de ce vaste champ désertique où pas un être ne peut vivre? Nous croisons sur notre route des camions qui portent du charbon de Bruay à Lille: des groupes d'évacués couronnent le noir chargement. Un de ces camions s'arrête, une vieille en descend, avec deux fillettes qui, chacune, tiennent un cabas: tout leur avoir... Mais la vieille s'est trompée. Elle a cru être dans son village, et, bien qu'elle soit du pays, elle s'est trompée farce qu'elle ne peut plus rien reconnaître... Le camion, reparti, est loin. C'est 4 ou 5 kilomètres qu'il faut faire à pied. Que trouvera-t-elle, dans son village? Pas plus qu'ici, - rien.
La destruction a été totale; aucun retour n'est possible dans ces déserts; et quand il s'agira de reconstruire La Bassée, Hulluch ou Loos, c'est à côté qu'il faudra le faire. Sur place, on ne pourra pas. Néanmoins, bien qu'on les déconseille doucement, les gens du pays reviennent, « pour voir ». Ils ont presque tous caché quelque chose, avant de partir, dans leur jardin ou dans leur cave. Ils reviennent... et devant le monceau de débris qu'est leur maison effondrée depuis deux, trois, quatre ans, ils comprennent alors et s'en vont.
Comme nous nous arrêtons, au milieu des terres dévastées, pour examiner un extraordinaire amalgame de chaudières retournées, de chevalets abattus, de fers tordus, enchevêtrés, vision apocalyptique, - un homme sorti d'on ne sait quel décombre vient à nous. Il nous dit son nom: Potier, Alfred, mineur, et, désignant du doigt la masse informe, il nous apprend que nous sommes à Hulluch, devant ce qui fut la fosse 13, - une des plus productives des mines de Lens.
A la Sainte-Barbe, qui est la fête des mineurs, au moment de la « longue coupe », travail à force qui permettra de toucher davantage pour boire mieux, on en extrayait jusqu'à 4.000 bennes de minerai par jour. L'homme nous montre ce qu'il reste là du puits de la mine, cet enchevêtrement de maçonnerie fracassée et de métal broyé, d'où monte comme un glas funèbre; quelque tôle pendante, brinquebalant au vent...
Là, ces chaudières défoncées, surmontées de dômes crevés, c'était une batterie de générateurs. Pour donner une idée approximative de cette destruction effroyable, sachez que lorsqu'il s'agira seulement de déblayer ce décombre, on ne le pourra faire qu'en découpant au chalumeatu, par petites pièces, l'inextricable lacis des charpentes de fer, des tuyaux, des tôles...
Ce brave homme qui nous fait ainsi les tristes honneurs de sa mine est revenu là, poussé par on ne sait quel besoin de vivre quand même à l'endroit où il a vécu, travaillé, pendant trente-six ans. Avec des planches arrachées aux mines, des tôles gondolées prises aux tranchées voisines, il s'est construit une baraque qu'il nous présente en riant: « Vlà mon château! » dit-il; et il nous conte ses projets: cultiver un carré de légumes, en rapportant un peu de terre arable sur un coin du sol retourné, et faire de son « château » un estaminet pour les passants...
Pendant qu'il parle ainsi, au loin, sur la plaine morte, des explosions se font entendre. On croit rêver... être à nouveau dans la bataille, un jour d'accalmie. Le décor est resté le même. Des petits groupes passent, à l'horizon, courbés sur le sol... Ce sont des prisonniers qui font la récolte des grenades et des obus dans ces champs dévastés, qui de longtemps ne produiront rien d'autre.
Un peu plus loin, un détachement de Chinois ramassent les fils de fer, les débris informes du champ de bataille... Tout à l'heure, nous les verrons d'un peu plus près, troupe grimaçante et nasillarde autour de Jonas, descendu d'auto pour prendre un croquis...
Aussi loin que se porte la vue, le morne paysage plat offre le même désolant spectacle d'une terre grêlée, trouée d'obus, comme un visage l'est par la petite vérole, - où de longues traînées crayeuses figurent le dessin des anciennes tranchées, sol presque uniformément blanc, à cause du calcaire remonté à la surface, à travers la mince couche de bonne terre, sous le retournement des explosions.
Voici Loos, maintenant: plus rien. Puis Lens: et ici, moins encore. Après être restée quatre ans en pleine bataille, la riche cité du charbon, où vivaient 40.000 mineurs, est complètement morte. Une route, bordée par des petits tumulus de briques effritées: c'est tout ce qui reste de Lens. Un tumulus un peu plus élevé que les autres, c'est l'église; un autre tumulus, c'est la mairie; un monticule noir, surmonté d'une ferraille tordue dressant vers le ciel un étrange échafaudage, c'est un puits de mine et son crassier...
'à Travers les Régions Libérées du Nord'
par Emile Henriot
Misère et Destruction
Lille, Ville Anglaise. - Un Village qui Renaît. - Ce qui Fut fa Fosse 13, à Hulluch. - Une Terre ou Rien ne Pourra Plus Pousser. - Le Désert de Lens. - Comment les Allemands Ont Détruit les Mines, et Comment Elles Vont Revivre. - à Valenciennes.- Sur les Ruines d'une Grande Aciérie. - Un Contraste.
Lille, 26 janvier
Bien que la guerre soit finie et que le front en soit maintenant éloigné de près de 500 kilomètres, Lille est encore une ville de guerre et continue à faire partie de la zone des armées, secteur anglais. Par une anomalie singulière, Lille apparaît comme une ville anglaise aux yeux du voyageur étonné. Elle présente ce spectacle bigarré que nous avons autrefois connu à Amiens, à Rouen, à Calais. De là sans doute, malgré la bonne volonté et la courtoisie de nos alliés britanniques, beaucoup de difficultés relatives au prompt règlement de tant de questions compliquées: transports, réfection des voies, des canaux, remise en état des fabriques, des usines détruites. Autorité militaire anglaise, pouvoir civil français, municipalités, administrations locales... trop de services se superposent et se gênent. Dans la rue, cependant, le bizarre mélange des uniformes, le va-et-vient des attelages, des camions, des convois, les soldats qui flânent, créent une animation factice qui rend la ville presque gaie.
Pourtant, plus de tramways, faute d'électricité; quelques rares omnibus à chevaux sont ressortis. La plupart des magasins n'ont pas rouvert, et les devantures montrent des étalages aux trois quarts vides... Beaucoup de ruines aussi, aux alentours de la gare: tristes murs rongés par les flammes, encore miraculeusement debout, vastes amas de décombres noircis où l'herbe croît déjà. Lille sent la guerre encore.
Ce matin, sur la grande place encombrée de camions, d'automobiles, la fanfare d'un régiment de nos chasseurs cantonné aux alentours donnait un alerte concert de cuivres, au milieu d'un cercle de badauds charmés et de tommies oisifs. D'une rue, débouche une colonne aux uniformes vert-de-gris, vert aigre. Ce sont des Allemands, car il y a encore des Allemands à Lille... mais prisonniers. Ceux-ci, sous bonne garde anglaise, baïonnette au canon, vont travailler, non loin. C'est bien le moins qu'ils réparent aujourd'hui ce qu'ils ont détruit hier. La morne troupe s'éloigne, sous les regards indifférents des promeneurs. Vraiment, nous avons, en France, la haine courte...
En auto, sous l'obligeante conduite de M. Labbé, inspecteur de l'Enseignement technique, et zélé secrétaire général du Comité d'alimentation auquel les régions libérées doivent d'être enfin convenablement ravitaillées, nous filons, le dessinateur Jonas et le signataire de ces lignes, vers la campagne voisine, pour aller voir sur place comment la vie renaît dans les ruines... A peine sommes-nous sortis de la ville, nous entrons dans la zone dévastée qui borde.
Sur une profondeur de plusieurs kilomètres, l'ancien front. Voici des terre en friche, les réseaux barbelés des secondes lignes; de-ci, de-là, un trou d'obus un pont détruit, une route explosée. Puis des ruines.
C'est le village de Wavrin - ou plutôt c'était... Wavrin ne se trouvait pas sur le champ de bataille; ce n'est pas le combat qui l'a tué, mais l'Allemand qui, avant de partir, l'a systématiquement détruit. Le mode de destruction était laissé au choix de la troupe chargée de l'exécuter: elle varie, suivant les villages, et l'on peut distinguer, entre les ruines, la méthode qui fut employée.
Là, c'est le feu: murs debout et noircis, débris calcinés, toits effondrés; ici, la dynamite. Une bombe a été placée dans la cave, ou bien une rangée de pétards le long d'un mur; mise à feu électrique, tout a sauté...
En général, quand il s'agit d'une maison à deux ou trois étages, l'explosion a détruit toute la cage intérieure de la bâtisse, et sur la poussière de débris qui en reste, jonchant le sol, la toiture s'est effondrée, comme le chapeau d'un vol-au-vent qui aurait fondu en cuisant. Or, un curieux détail qui montrera bien avec quel esprit de perverse malice les Allemands ont prévu et méthodiquement organisé la destruction des contrées qu'ils devaient évacuer, dans leurs parties les plus riches, c'est que toutes les belles maisons ont été ainsi jetées à bas: tout-ce qui avait une cave n'existe plus.
A Wavrin, les quelques pauvres masures qui subsistent ne valaient pas la charge de poudre nécessaire à les réduire en cendres, et c'est à quoi quelques-unes doivent de survivre. Le village, détruit aux deux tiers, comptait 4.000 âmes, avant la guerre. Quand les Allemands l'occupaient, 2.500 habitants y vivaient encore; aujourd'hui 2.700 sont revenus dans ses ruines. Ce chiffre n'est-il pas éloquent, ne dit-il pas quel aimant mystérieux est cet amour de la terre natale qui fait revenir où ils sont nés tant de malheureux, même assurés de n'y plus rien trouver de ce qui leur fut cher?...
Nous avons assisté au spectacle émouvant de ces retours. D'un amas de briques effritées, de bouts de bois brisés, un homme sort et nous salue. Il rit, et hochant la tête: « Voilà ma ferme, nous dit-il. C'était une belle ferme à deux étages. L'étable était là, la maison ici... » Nous interrogeons ce pauvre diable. Il ne se plaint pas. Il dit que le ravitaillement va bien, et qu'il sait qu'on s'occupe de lui. Et, tout de suite, il nous parle de ce qui lui tient le plus à cœur: sa terre. Il veut travailler, il a déjà entrepris de défricher son champ. Pour le moment, il loge avec sa femme dans une maison voisine, restée intacte; et d'ici quelque temps, il pense s'être fait un abri dans ses ruines mêmes.
Nous quittons cet homme; un soldat passe; c'est un permissionnaire qui revoit son village pour la première fois depuis cinq ans. Celui-là, paysan riche, avait trois maisons à Wavrin; toutes les trois sont anéanties. Il nous dit ces choses sans amertume, sans colère, et savez-vous comment il conclut? - « C'est 200.000 francs que je perds, toute ma fortune. Mais ça ne fait rien, j'en ai bien tué... On est Français, on ne manque pas de courage! » ...
Un peu plus loin, sur une échelle, un autre, la truelle en main, reconstruit un mur éboulé: voilà déjà une maison qui renaît. Au milieu d'un toit en lambeaux, un petit filet de fumée monte, qui va se perdre dans le ciel: c'est une cheminée qui fume, un foyer s'est repris à vivre. Ici, chacun s'entr'aide. Dans une humble ferme où nous entrons, nous trouvons deux pièces: les propriétaires du lieu, un vieux paysan, sa femme et sa fille habitent la première; pour la seconde, large de 3 mètres sur 4, ils l'ont donnée à une autre famille qui, elle, est sans toit:
c'est huit personnes qui occupent cet étroit espace; deux des enfants, malades, avec la fièvre, tremblent et grelottent dans le lit... En vain essaie-t-on de persuader à ces pauvres gens de renoncer à leur village, pour un temps, de venir à Lille, par exemple. A une proposition de cette sorte, une vieille femme répond devant nous avec énergie: « J'aime mieux rester dans m'niche à lapins qu'aller habiter dans vot' Lille! »
Ces gens ne se plaignent pas et ne réclament rien, mais leur résignation n'a rien d'inerte. Ils veulent travailler. Ils demandent seulement des chevaux pour labourer leurs terres, des outils, des brouettes, des baraquements, pour attendre, à l'abri, qu'on ait pu reconstruire leurs demeures effondrées.
On s'occupe d'eux, c'est certain; mais le fait-on assez vite? Nous avons vu, dans ce village, une baraque terminée, garnie de douze lits chauffée par trois poêles, et destinée à servir d'hôpital pour les malades. C'est très bien; mais il n'y manque que le médecin, les infirmières et la pharmacie... Est-ce si difficile à trouver?
Nous avançons, nous voici sur l'ancien champ de bataille, et tout à coup nous pénétrons dans une ville. A 200 mètres, on ne pouvait pas la deviner seulement... C'est La Bassée.
Faut-il encore entreprendre de décrire, une fois de plus, le spectacle navrant de cette ruine totale, de cet amas de pierraille brisée, de ferraille tordue, de ce vaste champ désertique où pas un être ne peut vivre? Nous croisons sur notre route des camions qui portent du charbon de Bruay à Lille: des groupes d'évacués couronnent le noir chargement. Un de ces camions s'arrête, une vieille en descend, avec deux fillettes qui, chacune, tiennent un cabas: tout leur avoir... Mais la vieille s'est trompée. Elle a cru être dans son village, et, bien qu'elle soit du pays, elle s'est trompée farce qu'elle ne peut plus rien reconnaître... Le camion, reparti, est loin. C'est 4 ou 5 kilomètres qu'il faut faire à pied. Que trouvera-t-elle, dans son village? Pas plus qu'ici, - rien.
La destruction a été totale; aucun retour n'est possible dans ces déserts; et quand il s'agira de reconstruire La Bassée, Hulluch ou Loos, c'est à côté qu'il faudra le faire. Sur place, on ne pourra pas. Néanmoins, bien qu'on les déconseille doucement, les gens du pays reviennent, « pour voir ». Ils ont presque tous caché quelque chose, avant de partir, dans leur jardin ou dans leur cave. Ils reviennent... et devant le monceau de débris qu'est leur maison effondrée depuis deux, trois, quatre ans, ils comprennent alors et s'en vont.
Comme nous nous arrêtons, au milieu des terres dévastées, pour examiner un extraordinaire amalgame de chaudières retournées, de chevalets abattus, de fers tordus, enchevêtrés, vision apocalyptique, - un homme sorti d'on ne sait quel décombre vient à nous. Il nous dit son nom: Potier, Alfred, mineur, et, désignant du doigt la masse informe, il nous apprend que nous sommes à Hulluch, devant ce qui fut la fosse 13, - une des plus productives des mines de Lens.
A la Sainte-Barbe, qui est la fête des mineurs, au moment de la « longue coupe », travail à force qui permettra de toucher davantage pour boire mieux, on en extrayait jusqu'à 4.000 bennes de minerai par jour. L'homme nous montre ce qu'il reste là du puits de la mine, cet enchevêtrement de maçonnerie fracassée et de métal broyé, d'où monte comme un glas funèbre; quelque tôle pendante, brinquebalant au vent...
Là, ces chaudières défoncées, surmontées de dômes crevés, c'était une batterie de générateurs. Pour donner une idée approximative de cette destruction effroyable, sachez que lorsqu'il s'agira seulement de déblayer ce décombre, on ne le pourra faire qu'en découpant au chalumeatu, par petites pièces, l'inextricable lacis des charpentes de fer, des tuyaux, des tôles...
Ce brave homme qui nous fait ainsi les tristes honneurs de sa mine est revenu là, poussé par on ne sait quel besoin de vivre quand même à l'endroit où il a vécu, travaillé, pendant trente-six ans. Avec des planches arrachées aux mines, des tôles gondolées prises aux tranchées voisines, il s'est construit une baraque qu'il nous présente en riant: « Vlà mon château! » dit-il; et il nous conte ses projets: cultiver un carré de légumes, en rapportant un peu de terre arable sur un coin du sol retourné, et faire de son « château » un estaminet pour les passants...
Pendant qu'il parle ainsi, au loin, sur la plaine morte, des explosions se font entendre. On croit rêver... être à nouveau dans la bataille, un jour d'accalmie. Le décor est resté le même. Des petits groupes passent, à l'horizon, courbés sur le sol... Ce sont des prisonniers qui font la récolte des grenades et des obus dans ces champs dévastés, qui de longtemps ne produiront rien d'autre.
Un peu plus loin, un détachement de Chinois ramassent les fils de fer, les débris informes du champ de bataille... Tout à l'heure, nous les verrons d'un peu plus près, troupe grimaçante et nasillarde autour de Jonas, descendu d'auto pour prendre un croquis...
Aussi loin que se porte la vue, le morne paysage plat offre le même désolant spectacle d'une terre grêlée, trouée d'obus, comme un visage l'est par la petite vérole, - où de longues traînées crayeuses figurent le dessin des anciennes tranchées, sol presque uniformément blanc, à cause du calcaire remonté à la surface, à travers la mince couche de bonne terre, sous le retournement des explosions.
Voici Loos, maintenant: plus rien. Puis Lens: et ici, moins encore. Après être restée quatre ans en pleine bataille, la riche cité du charbon, où vivaient 40.000 mineurs, est complètement morte. Une route, bordée par des petits tumulus de briques effritées: c'est tout ce qui reste de Lens. Un tumulus un peu plus élevé que les autres, c'est l'église; un autre tumulus, c'est la mairie; un monticule noir, surmonté d'une ferraille tordue dressant vers le ciel un étrange échafaudage, c'est un puits de mine et son crassier...

Parmi ces ruines, quelques indigènes (revenus fouillent les débris. Deux femmes s'en vont une chaise sous le bras: tout leur bien. A un carrefour, une roulotte: estaminet. Des soldats anglais se chauffent devant un feu de bois... Ici se pose un des plus grands problèmes parmi ceux dont va dépendre le sort de ces riches contrées. Renaîtront-elles de leurs cendres, et comment? - Voici ce qui va se passer pour Lens. « C'est de la mine que Lens a vécu; c'est d'elle que viendra sa renaissance », a dit justement M. Basly, député-mire de la ville laborieuse. Grâce à une parfaite compréhension des nécessités actuelles, et sachant ce que l'on peut attendre de la seule cohésion des efforts, les diverses sociétés des mines et houillères françaises se sont unies, afin de travailler à remettre, dans le plus bref délai possible, les mines dévastées en état.
Dès à présent, on retravaille, à Lens. La Société des Mines se fait fort de reconstruire 2.000 maisons par an, pour son personnel. Si l'on ne peut reconstruire sur l'emplacement des anciens corons, on rebâtira à côté, mais on rebâtira.
Déjà les ingénieurs, les travailleurs sont réunis; déjà l'on commence à évaluer les dommages causés à la superstructure des mines, entrées de puits, chevalets rompus, chaufferies, instruments producteurs de la force motrice, machines d'élévation. Ceci fait, il faudra aborder la mine elle-même. Or, elles sont pour la plupart inondées, du fait des Allemands. On sait que, pour atteindre aux gisements du minerai, les puits d'ascension rencontrent et traversent d'abondantes nappes d'eau, souvent véritables rivières souterraines. Dans l'impossibilité de les détourner, il a fallu blinder, étancher la partie du puits voisine de ces eaux: cette partie du puits s'appelle le cuvelage. C'est cet organe essentiel de la mine que les Allemands, partout, ont attaquée, en sachant bien ce qu'ils faisaient, et la dynamite ayant fait son œuvre, les eaux de se précipiter par les cuvelages brisés, envahissant les galeries inférieures, remplissant peu à peu les puits. Quelques-uns de ces puits atteignent 700 à 800 mètres de profondeur...
L'eau montant sans arrêt affleure maintenant presque à la surface du sol. La mine est noyée. Il va falloir la vider, la sécher. Pour cette gigantesque entreprise, la Compagnie de Lens vient de décider la construction, sur le territoire d'Harnes, d'une centrale électrique destinée à produire la force nécessaire au fonctionnement des pompes d'assèchement; cette force pourra ensuite servir à l'extraction du minerai, quand la mine sera en état de produire.
Mais, d'abord, il faudra considérer dans quelle mesure les cuvelages sont susceptibles d'être réparés, ou refaits tout entiers, ou si même il ne vaudra pas mieux forer de nouveaux puits; enfin, examiner la condition du sous-sol lui-même, ce que sont devenues les galeries après plusieurs années d'inondation. Travail immense, qui fait penser aux Titans de la fable antique, - mais devant lequel les puissantes compagnies des mines ne se laissent pas décourager, bien loin de là...
On estime que la seule Compagnie de Lens pourra rebâtir en quatre ans, par ses seuls moyens, le même nombre des maisons ouvrières qu'elle possédait avant la guerre, et assurer ainsi le logement de presque tout son personnel. Car, le mineur étant attaché à sa mine comme à son foyer, presque tous ceux qu'elle employait lui reviendront. C'est un point important, et au milieu des grands problèmes sociaux en présence desquels on se trouve après le bouleversement causé par la guerre, une personnalité compétente nous signale ce fait nouveau, curieux à enregistrer: devant le spectacle de la misère patronale, le travailleur qui revient comprend que la ruine du patron engendrera sa propre ruine, s'il n'aide pas de toutes ses forces à la réparer.
Quand ces employeurs sinistrés demandent à ceux qui leur reviennent: « Que voulez-vous gagner? », beaucoup répondent: « Ce que vous pourrez nous donner. » On veut voir là un bon augure pour les relations futures du travail et du capital.
27 janvier
Valenciennes. Il neige. Voici l'hiver et ses rigueurs. Sur le sol noir, l'épais tapis de flocons durcit au vent qui siffle. N'était-ce pas assez de misères, déjà?
Non, la nature n'a pas plus pitié que les hommes. Sous le blanc linceul, bientôt boue infecte à l'heure du dégel, les ruines se découpent, fantomatiques, plus tristes encore... Et tandis que l'on avance, à travers ces rues bordées par ces maisons éventrées, les pieds gourds, le visage fendu en quatre par l'âpre brise, le cœur se serre... La souffrance humaine n'a pas de limites...
Valenciennes avait déjà bien assez souffert, pourtant. La fin de la guerre n'a pas mis un terme à ses maux. Intacte, ou presque, pendant les années si longues de l'occupation - elle n'avait guère que 1.200 maisons détruites aux premiers jours d'octobre! -la vieille cité des dentelles devait n'attendre sa libération que de sa ruine. Comme il y a des soldats qui, après avoir passé quatre ans dans la fournaise, ne sont tombés qu'au dernier jour, certaines villes n'ont été dévastées qu'à la veille de la victoire. Valenciennes est de celles-là.
Le 10 octobre dernier, les Allemands faisaient évacuer la ville par ses habitants. Sur 35.000, 3.000 à peine restaient, malades intransportables, à l'hôpital, le reste enfermé dans les caves. Les autres, emmenés en captivité, en exil, jonchaient tristement les routes de Belgique; beaucoup mouraient d'épuisement.
Quinze jours, la bataille fait rage aux portes de la ville, bombardée sans répit... Puis les Anglais entrent, le Prussien s'en va... Il laisse derrière lui une ville en débris, 55 % de ses maisons effondrées, déchiquetées, inhabitables... Cependant, bravant les consignes, les habitants reviennent. On en compte aujourd'hui 24.000. Comment logés? En vrac, en tas, dans les demeures intactes ou susceptibles encore d'abriter une famille, en quelque coin. Mais imaginez ceci: les propriétaires évacués, les démobilisés, les prisonniers libérés reviennent chez eux; s'ils ont la chance de trouver un toit - le leur - la place est prise. C'est qu'il a fallu y loger des habitants des cités, des campagnes voisines, évacués de leurs villages détruits: les Anglais cantonnés à Valenciennes occupent le reste.
Devant sa maison ainsi remplie, le propriétaire n'a qu'un parti à prendre: coucher dans la rue. Mais il neige... alors, il s'en va.
Que fait-on pour ces malheureux? On voudrait des baraquements. Mais il n'y a ni bois, ni clous. Il faut attendre. Le gouvernement promet, - sans pouvoir tenir. Dans les maisons bombardées, à demi détruites, les toits sont percés, les fenêtres n'ont plus un seul carreau. Ni papier huilé pour remplacer ceux-ci, ni toiles goudronnées pour couvrir le dessus. L'eau et la neige dégoulinent. Plus de meubles, les Allemands ont tout emporté. Plus un matelas dans la ville. Nous y couchons, dans le meilleur hôtel, d'ailleurs réquisitionné pour les officiers anglais, à même le sommier, très contents encore d'en avoir un.
A la mairie, où la pluie, passant à travers les plafonds défoncés, s'accumule en mares dans la salle des délibérations, dans le musée municipal, vidé de ses meilleures pièces, le vent qui souffle par les fenêtres sans vitres balance ce triste écriteau: « Il n'y a plus de couvertures... »
A l'hospice, rempli de malades, le nombre des morceaux d'étoffe qui en peuvent tenir lieu est si restreint, qu'on ne peut même pas les nettoyer: la vermine y pullule. Pas de charbon non plus. Le maire, M. Tauchon, vénérable vieillard emmené pendant dix-huit mois en captivité par les Allemands, nous dit avec un air rayonnant de bonheur qu'il va enfin pouvoir faire une première distribution de charbon aux habitants. Un train vient d'arriver. Il y aura juste de quoi donner 50 kilos par famille, pour un temps indéterminé... jusqu'au prochain train. Pas de gaz. L'usine est détruite. A peine un peu d'électricité, juste de quoi éclairer vaguement les rues, le soir, et fournir un peu de force motrice, dans la journée, aux petites industries...
Les ponts sont détruits; une partie de la région est inondée. Au milieu d'un de ces lacs formés par l'infiltration des eaux dans les dépressions du terrain, nous avons vu émerger le faîte d'une quinzaine de croix. C'est un de ces innombrables petits cimetières de fortune, comme on en voit tant dans ces tristes régions, - submergé... La gare a sauté, et bien sauté: chaque pilier de fer est rompu à la base, la charpente en fer du hall pend, retenue par on ne sait quel miracle; la gare elle- même, fendue en deux, moitié éboulée, moitié droite encore...
Ceci n'est pas le fait de la bataille, - mais ressortit au système de destruction à grande échelle entreprise par les Allemands, à la fin de leur ère.
Dans la contrée environnante, pas une usine, pas une forge, pas une aciérie intacte. Tout est mort, pour des années. Et, la loi des dommages n'étant pas votée, faute d'entente aussi, peut-être, chacun hésite à reprendre son affaire, à déblayer même ses ruines. Ne faut-il pas d'abord que les experts viennent faire leurs constats? Situation inextricable. Sous la tristesse de chacun, ici, on sent gronder une colère qui fait peur. Les formalités administratives sont si longues! Depuis trois mois, on a fait tant de promesses aux sinistrés, - et tenu si peu!...
De là à conclure injustement: « Personne ne s'occupe de nous! Il n'y en a que pour l'Est et que pour le Midi! » - il n'y a qu'un pas. Il est vite franchi.
Nous venons d'aller visiter les usines de la Société des Forges et Aciéries de Denain et d'Anzin, une des plus grandes de France, pour voir sur place l'état dans lequel les Allemands ont laissé ce magnifique établissement. Imaginez une ville de fer, sept à huit cents hectares couverts de constructions métalliques, et supposez le plus formidable tremblement de terre qui se puisse concevoir: vous aurez une faible idée de l'état où sont aujourd'hui réduites ces usines, - un désert, un fantôme de ville, une destruction sans fin.
Pas une pièce, pas une machine, pas un tuyau, pas une charpente, pas un bâtiment n'est intact. Ce n'est, partout, que brique en poussière, ferraille tordue, enchevêtrée. L'ingénieur qui nous accompagne, dans notre lamentable exploration, me dit qu'il faudra commencer par jeter à bas tout ce qui reste ou semble rester debout, et, du premier moellon au dernier boulon, refaire tout: c'est des centaines de millions qui ont été envoyés par les airs. Ce savant spécialiste nous explique qu'on ne peut pas imaginer le génie avec lequel les Allemands ont poussé l'art de la destruction à ses limites. Ne laissant pas au hasard le soin de détruire, ils faisaient venir des ingénieurs, des techniciens qui choisissaient dans chaque pièce la partie vitale où frapper, la plus invisible, parfois, et qu'un spécialiste seul pouvait connaître, celle qui, entre cent, une fois brisée ou faussée, nécessitera le démontage complet et la réparation totale, de la machine.
A Denain et Anzin, la destruction systématique a commencé en 1916. Dès 1915, après le refus de remise en marche opposé par la Société aux Allemands, les usines avaient été consignées et inventoriées par un certain capitaine Bôcking, de l'inspection des Etapes: les minerais, les fontes, les cuivres enlevés; les produits fabriqués réquisitionnés; les machines, wagons de déchargements, grues roulantes, locomotives, ponts roulants, moteurs, machines-outils, enlevés et emmenés en Allemagne.
En 1916, les parcs des produits finis vidés, un hôpital installé dans les bureaux de la direction, les archives, qui avaient pu jusque-là être mises à l'abri, furent détruites et envoyées en Allemagne pour servir de pâte à papier, et, finalement, l'usine mise en liquidation par l'autorite supérieure. Des ingénieurs allemands vinrent y faire leur choix dans ce qui restait. Le choix fait, ce qui n'avait pas convenu fut détruit à la dynamite et au marteau-pilon, et livré ensuite comme mitraille aux ferrailleurs. Des protestations successivement élevées par les ingénieurs de la société à différentes dates amenèrent un certain ralentissement dans la destruction des usines; mais elle fut reprise et poursuivie jusqu'à la fin, sur des ordres supérieurs venus de Berlin et de Metz. Aux réclamations portées devant elle, l'autorité civile allemande, chargée du soin d'anéantir méthodiquement l'industrie française dans les régions occupées, répondit qu'elle ne laisserait rien debout de la totalité des usines et n'abandonnerait que le sol nu et défoncé.
Si nous ajoutons que les usines de Denain et d'Anzin produisaient et vendaient avant la guerre 350.000 tonnes de produits métallurgiques par an, occupaient 7.500 employés et assuraient l'existence de 22.000 personnes avec leurs familles, et qu'il faudra, suivant les calculs d'ingénieurs compétents, plus de dix ans pour les remettre en l'état où elles se trouvaient en 1914, - on aura ici un exemple parfait du beau travail de destruction systématique exécuté par les Allemands dans notre pays.
- Qu'allez-vous faire? demandons-nous aux ingénieurs gardiens de ces ruines, devant l'inextricable amas.
- Rien pour l'instant. Que pouvons nous faire? Va-t-on seulement nous indemniser? Nous ne pouvons même pas entreprendre le déblaiement. Sommes-nous seulement assurés de pouvoir revivre? On ne peut rien dire avant que la loi des dommages de guerre soit votée. Nous verrons ensuite. Attendons...
Contrastes singuliers de la guerre! Nous revenons à Valenciennes, tristes d'avoir vu trop de ruines. Des officiers anglais que nous rencontrons nous invitent. - « Venez au théâtre!» - « Il y a donc un théâtre ouvert à Valenciennes? » - « Oui, le théâtre anglais. Venez voir cela. Vous vous amuserez... » Nous traversons la vieille place sombre, encombrée de camions, d'autos, animée par l'incessant va-et-vient d'un flot militaire: un bataillon français défile, des Anglais flânent; une théorie d'évacués rentrent, pitoyables, dans le noir, la tristesse, la boue glacée...
Au fronton de l'Hôtel de Ville, sous une belle femme nue qui se lève, où Carpeaux a figuré Valenciennes, ce rappel des temps anciens: « Valenciennes a bien mérité de la patrie. Convention nationale, An II » Toujours les mêmes à la peine!... Nous suivons nos guides.
Voici le théâtre. Il est anglais, maintenant. Pas une place vide. Acteurs excellents, actrices charmantes. Je le dis à mon voisin, qui éclate de rire: ces jolies actrices, c'est le capitaine W..., le lieutenant S..., le major L..., - des amateurs camouflés en femmes, et qui dansent, et chantent, et jouent à merveille. C'est ici le théâtre aux armées britanniques: organisation différente du nôtre. Chez nos alliés, chaque division, ou presque, a son théâtre: pièces de soldats, acteurs soldats, musiciens, décorateurs, metteurs en scène soldats. Mise en scène soignée: costumes de chez Poiret, chef d'orchestre de Covent Garden; 1.500 francs de recette tous les soirs au bénéfice d'œuvres de guerre, et changement de spectacle tous les huit jours.
Ce théâtre ne chômait pas pendant les attaques. Il n'y a qu'en mars 1918, au moment du grand push allemand sur Amiens, que les « Rouges et Noirs » (c'est le nom de la troupe) ont fait relâche, et se sont bravement mis à creuser des tranchées... Pendant que mon guide me donne ces renseignements divers, ainsi que les noms du manager et des acteurs, je regarde sur la scène un tommy décolleté, collier de perles, rouge aux lèvres, bas de soie, robe de tulle et de velours, danser à ravir un fox-trott à variantes savantes... et, malgré moi, je songe à ceux qui, non loin, rentrent dans leurs maisons en ruines, aux foyers sans feu, à la misère qui nous entoure, à la neige qui tombe, et je pense qu'il est, dans la vie, des moments où le cœur le mieux accroché a beaucoup de mal à rester optimiste...
Emile Henriot








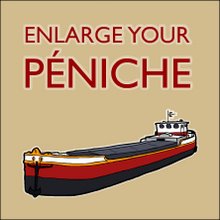

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire