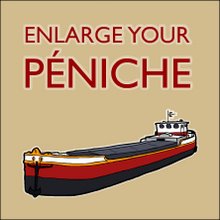de la revue 'l'Illustration' No. 3761, 3 avril 1915
par Emile Vedel
Les Fusiliers Marins à Dixmude
Dans la seconde quinzaine d'août, alors que les nouvelles de Belgique commençaient à devenir mauvaises, les Parisiens eurent la surprise de voir leurs principales rues gardées par des marins. Venus pour coopérer à la défense éventuelle de la place, on les avait provisoirement chargés d'y maintenir l'ordre, c'était avec condescendance et bonhomie que les sergents de ville les initiaient aux lentes promenades et stations que comporte le métier. Les uns réservistes, anciens chauffeurs ou mécaniciens de la flotte, provenaient de centres industriels importants, et ne dissimulaient pas leur satisfaction de se retrouver sur le pavé d'une grande ville. Les autres, au contraire, étaient de jeunes marins levés avec la dernière classe, longs-courriers, pêcheurs ou caboteurs aux yeux candides dans des visages imberbes, qui s'ennuyaient déjà de ne plus apercevoir la mer au bout de chaque avenue. Ils roulaient en marchant, et ne savaient surtout quoi faire de leurs pauvres bras ballants. Mais bientôt cols bleus et vareuses disparurent sous de grandes capotes; des cartouchières pleines vinrent alourdir les ceinturons, tandis que; l'épée-baïonnette se mettait à battre plus sec contre les mollets guêtrés de cuir. Tout en veillant sur la capitale, nos matelots se transformaient peu à peu en soldats.
Aux survivants de l'année terrible, leur présence rappelait le siège: le Bourget, où les fusiliers-marins, commandés par le capitaine de frégate Lamothe-Thenet, avaient si bien bousculé la garde royale prussienne; le plateau d'Avron, sur lequel les eanonniers de l'amiral Saisset accomplirent des prodiges d'héroïsme et d'adresse; la fameuse «Joséphine», une pièce de 190 de marine, géante pour ce temps-là, que l'on avait hissée tout en haut de Montmartre d'où elle réduisit au silence plus d'une batterie allemande; la canonnière la Farcy, les gabiers qui montaient les ballons, et tant d'autres... Est-ce que, par hasard, nous allions revoir les sombres jours que l'apparition des bérets à pompons rouges ramenait à la mémoire de tous?
Non! La France, cette fois, n'avait pas attendu qu'il fût trop tard pour faire le suprême effort. Endormie par la captieuse chanson des amants de la paix à tout prix, il suffit que fût déferlée l'affiche du grand branle-bas de combat, pour qu'elle sortît de son dangereux sommeil. Et, instantanément, elle fut debout, tout entière, à commencer par ceux qui, la veille, criaient le plus fort: «A bas l'armée!» Une France que nul ne soupçonnait, elle-même moins que quiconque, calme, résolue, à la hauteur de tous les périls qui fondaient sur elle. Plus de divisions politiques, plus seulement de classes: la fraternité sous les armes, réalisée dès l'embarquement des partants dans les trains de mobilisation, et imposant au reste l'union sacrée de toutes les volontés. Malgré quoi il nous fallut céder d'abord, sous la pression des masses par trop énormes, tenues toutes prêtes à se jeter sur un pays dont le plus grand tort était de ne pas croire à la guerre. Mais nos admirables troupes ne reculaient que pour prendre du champ, et faire tête au bon endroit. Pendant que, sur leurs talons, se ruaient deux millions et demi d'Allemands qui hurlaient à la déroute et à la mort, les nôtres marchaient à la victoire de la Marne. Car, toujours et partout, le dernier mot reste aux forces morales les mieux trempées, - et personne ne se doutait de celles que nous tenions en réserve. En attendant, Paris se préparait fiévreusement à recevoir l'ennemi...
Depuis le débarquement de la première compagnie de fusiliers-marins, il n'avait cessé d'en arriver de nouvelles, provenant des différents ports militaires, de Brest et de Lorient principalement. A la fin du mois d'août, elles formaient deux régiments à trois bataillons chacun, soit un total d'environ 6.000 hommes. Et je ne parle pas ici des canonniers de la flotte qui vinrent armer certains forts des environs, où il fallut réaliser de véritables tours de force pour être prêts à tirer dans le délai fixé. Pas davantage de la flottille organisée sur la Seine, non plus que des sections d'autocanons, automitrailleuses et autoprojecteurs, tout cela monté par nos mathurins, et sorti comme par enchantement du Grand Palais des Champs-Elysées, devenu leur quartier général. Car l'aris, qui a toujours eu un faible pour eux, n'avait rien trouvé de trop beau pour les loger.
Le meilleur moyen de défendre une place consistant à en écarter l'adversaire, l'armée du camp retranché fut envoyée au-devant de celle de von Kluck, qu'elle battit sur les bords de l'Oureq. Un détail, peu connu, mais caractéristique de la prévoyance allemande: leur horde de tête comprenait tous les «directeurs» des grands hôtels parisiens, concierges, polyglottes, garçons de restaurants, commis et autres espions déguisés qui pullulaient chez nous jusqu'à la veille de la guerre. Ils devaient guider les cambrioleurs à casque pointu dans leurs opérations de déménagement, et avaient même préparé des fiches indiquant ce qu'il ne fallait pas oublier d'emporter, ainsi que la rançon à exiger des principaux habitants. J'ignore s'il existait également une liste des femmes et des enfants à égorger; mais, comme on le voit, rien n'avait été oublié pour rendre aussi fructueux que possible le grand pillage auquel le Kaiser devait présider en personne. Malheureusement pour lui, entre la coupe et les lèvres, se dressa... l'armée de Paris. Les deux régiments de marine, qui en faisaient partie, avaient quitté le Grand Palais dans la matinée du 2 septembre. Pas encore assez entraînés pour être exposés en première ligne, ils formaient réserve dans le secteur Nord-Est de la défense. Dès le lendemain, ils creusaient des tranchées autour du fort de Gonesse, et y passaient les journées suivantes, attendant l'ennemi à tout moment. On sait pourquoi il ne vint pas. Aussi, le 9 au soir, la brigade navale fut-elle replacée en cantonnements dans la banlieue, où elle acheva de s'organiser.
Car ces 5000 hommes de mer, qui se trouvaient réunis pour la première fois de leur vie, étaient presque complètement étrangers aux choses militaires. Inexercés à la marche, beaucoup n'avaient jamais tiré un coup de fusil, et la marine s'était vue dans l'impossibilité de leur fournir les objets de grand et de petit équipement dont elle-même n'était pas approvisionnée. Et le convoi! Il était composé de voitures de livraison de tous les commerces, portant les réclames les plus hétéroclites - par la suite on les peignit uniformément en gris - et attelés de bêtes rassemblées au petit bonheur, parmi lesquelles un malin hasard s'était complu à rapprocher chevaux entiers et juments. On devine les ruades et bousculades qui s'ensuivaient, surtout sous la conduite de cochers improvisés, beaucoup mieux préparés à mener une embarcation qu'un attelage. Et lorsque la caravane arrivait à la halte du soir, c'était un concert de hennissement qui empêchait tout le monde de dormir. Mais chacun y mit tellement du sien qu'au bout d'une quinzaine la brigade se trouva pourvue de tout le nécessaire. On parvint même à lui adjoindre un groupe de seize mitrailleuses. Par ailleurs, son instruction avait été poussée hâtivement, et elle possédait d'ores et déjà assez de cohésion pour être employée n'importe où et contre qui, comme elle n'allait pas tarder à le montrer.
Le 7 octobre, sept trains partis de Saint-Denis et de Villetaneuse emportaient nos matelots, enfin expédiés au front. Et trois jours plus tard, ces hommes, habitués à vivre nu-pieds sur le pont de leurs bateaux, fournissaient des étapes de 30 et 40 kilomètres, après avoir, pour leurs débuts, tenu tête aux meilleures troupes allemandes! En dehors de l'ardeur vraiment patriotique qu'ils déployèrent pour se mettre le plus vite possible à la hauteur de leurs nouveaux devoirs, il faut rapporter tout le mérite d'un pareil résultat aux efforts surhumains de leurs officiers, à commencer par le contre-amiral Ronarc'h. Car - c'est bien le cas de le dire - tel chef, tels soldats. Et je m'en voudrais de changer un seul mot au portrait que me traçait de lui un de ses jeunes lieutenants: «Taille moyenne, mais bien prise. Une tête énergique sur un corps solidement muselé. Actif et résolu. Breton dans toute l'acception du terme, y compris la légendaire opiniâtreté. Exigeant des autres autant qu'il est prêt à donner lui-même, quoique plus sensible à leurs fatigues qu'aux siennes propres. Appelle le mot éternellement vrai, que l'homme de guerre vaut surtout par le caractère.» Mais les entraîneurs directs de la brigade furent plus spécialement les lieutenants de vaisseaux, capitaines des com- pagnies qui, heureusement, avaient presque tous passé par le bataillon-école de Lorient. Leur infatigable dévouement reste au-dessus de tout éloge, comme l'exemple qu'ils donnèrent sans marchander.
Ce n'est plus un secret pour personne que les Anglais et nous avons tenté l'impossible afin de secourir Anvers. Or les fusiliers-marins devaient se joindre aux forces que nous concentrions à cet effet dans la région de Dunkerque. Mais aucun ciment armé, pas plus à Anvers qu'à Liège, Na-mur on Mnubeuge, ne se montra capable de résister aux monstrueux obusiers allemands de 420, non plus qu'aux canons autrichiens de 305, ceux-ci doués d'une portée supérieure à celle de nos batteries de forteresse qui, par suite, ne pouvaient même pas riposter. C'était la faillite du béton, amenant en très peu de jours la chute des places réputées les plus imprenables.
Quand la brigade navale entra en gare de Dunkerque, humant à pleines narines les senteurs familières de la marée, elle reçut avis de continuer directement sur Anvers. La nouvelle fut accueillie par un double cri, longuement répété, de: «Vive la France!» «Vive la Belgique!» Recevoir le baptême du feu à côté de nos sauveurs, les Belges, avec le roi Albert comme parrain et au son du plus fameux carillon qui soit au monde, le tout accompagné par une distribution de dragées de la taille de colles que jetaient les Allemands, il y avait, en effet, de quoi satisfaire les plus difficiles. Et voilà les deux régiments de marins roulant à travers la Belgique, acclamés partout, et demandant à chaque station où se trouve l'ennemi, avec lequel il leur tarde d'en venir aux mains.
«Nous devions d'abord nous arrêter à Dunkerque - écrit le quartier-maître fourrier M. F... - mais nous n'y étions pas depuis dix minutes qu'on nous faisait repartir. Et comme nous avons mis le cap à l'Est, j'en ai conclu que nous allions en Belgique. Le voyage s'est admirablement passé. A la petite gare de Noyelles, des dames «de la haute», avec de petits tabliers de dentelle, nous ont fait des tas de cadeaux. Exemple: j'ai eu un caleçon en laine, une bougie, des allumettes, du pain et une pomme, cinq cigarettes et deux sous. J'en suis resté baba, et la charmante jeune femme qui me les offrait encore bien plus, quand je lui eus baisé la maïn en lui disant que la faveur qu'elle m'accordait mettait le comble à ses gâteries, et que je pourrais me battre gaiement après le sourire d'une jolie Française. Et ces choses idiotes, il fallait voir le pauvre être ignoble qui les débitait, sale à faire honte à l'aveugle du pont roulant de Saint-Malo. Jci, en Belgique, nous sommes reçus à bras ouverts, mais en notre qualité de marins, un peu regardés comme des bêtes curieuses. Tout va bien et continuera d'aller pour le mieux, soyez-en sûrs. Mort aux Boches!»
A Gand, ordre de descendre, la voie étant coupée au delà. Anvers va capituler et les Allemands avancent en force par la ligne Bruxelles-Alost, pour essayer de prendre en flanc l'armée belge qui opère fièrement sa retraite sur Bruges, en laissant Gand à gauche. Mais si l'on veut sauver l'artillerie et les convois, c'est-à-dire de quoi continuer la lutte ailleurs, il faut arrêter l'ennemi pendant quarante-huit heures. Puisque voilà des marins qui tombent du ciel, on va les adjoindre aux troupes du général Clothen (Belge), chargées de faire digue et de tenir le temps nécessaire. La seule faveur qu'ils réclament est de se voir confier le poste le plus avancé, en extrême pointe sur les deux routes par où viendront les Allemands.
Le soir tombe, quand les premiers matelots descendent à Gand. C'est l'heure magique où les façades de ses délicieuses vieilles maisons se reflètent en violet dans les eaux vives qui courent partout, tandis que se mettent à rougeoyer leurs hauts pignons à escaliers. Alentour règne un horizon de velours vert, partout coupé de calmes rivières, et que tachettent les dernières floraisons d'automne. Plus loin, des fouillis de villages et de fermes cossues au milieu de bouquets d'arbres: toutes les magnificences par lesquelles le travail et l'art ont su embellir et varier une nature aussi grasse que monotone. Mais les arrivants n'ont pas loisir d'admirer. La seule chose qu'ils voient de la ville, c'est l'élan qui porte sa population tout entière au-devant d'eux, dont elle espère le salut. Ils annoncent qu'une division anglaise les suit, et les bonnes gens de Grand se reprennent à espérer, ne sachant comment assez bienvenir leurs défenseurs imprévus. Ceux-ci, qui continuent de débarquer pendant toute la nuit, sont logés n'importe où, pour passer les dernières heures de cette suprême veillée des armes.
Le lendemain matin, 9 octobre, la brigade effectue son rassemblement sur le champ de manœuvres de Ledeberg, situé dans le Sud-Est de la ville. Après quoi, déjeuner hâtif, pendant lequel on vient prévenir que les avant-gardes ennemies ont franchi la Dendre, et peuvent déboucher d'une minute à l'autre. Les deux régiments sont immédiatement envoyés: le premier sur la rive gauche de l'Escaut, en aval de la ville, pour barrer la route de Termônde; le deuxième, sur la rive droite, où il va occuper le front Gontrode-Quadrecht qui ferme, en amont de Melle, la route d'Alost. Ils y trouvent des tranchées toutes préparées et n'ont plus qu'à attendre l'ouverture du bal. C'est l'artillerie qui, de loin, commence le branle, et le même petit fourrier que tout à l'heure se hâte de griffonner quelques lignes à sa famille: «Je vous ai envoyé hier soir une lettre de Gand qui nous a fait un accueil émouvant d'enthousiasme. Je profite d'un repos en plein champ, pour vous envoyer toute ma tendresse sur cette carte, la dernière qui me reste de France. Quelle joie! Nous sommes déjà «pompettes» d'entendre le canon.» Et ils sont tous comme ça, en proie à cette sorte d'ivresse que l'approche du danger inspire aux vrais braves...
Ce fut la 1(tm) compagnie du 2e bataillon (2e régiment) qui eut l'étrenne des Allemands. Déployée entre Gontrode et Quadrecht, elle tint bon jusqu'au moment où de grosses pertes - dont son capitaine, le lieutenant de vaisseau Le Douget, un des premiers tués de la brigade - l'obligèrent à se replier sur la ligne de chemin de fer de Gand à Audenarde. Là, elle s'établit solidement, contre le remblai de la voie, et renforcée du 3e bataillon, repousse toutes les attaques de l'ennemi qui, surpris d'une pareille résistance, fait mine de se retirer vers le soir, en abandonnant plusieurs, centaines de cadavres sur le terrain. Ce n'est bien entendu que pour revenir un peu plus tard et beaucoup plus nombreux. Seulement cette fois, profitant de là nuit noire, les Allemands essayent de se présenter en amis: «Ne tirez pas, disent-ils, nous sommes des Anglais.» Comme les nôtres ne sont pas encore au fait de leurs ruses diaboliques, ils éprouvent quelque hésitation: «Envoyez-nous quelqu'un», leur répond le commandant Mauros. Et, personne ne se présentant, le feu est ouvert. Il n'était que temps. Déjà ils ont réussi à surprendre un quartier-maître mécanicien qu'ils assomment à coups de crosse, parce qu'il refuse de crier à ses camarades de ne pas tirer. Le quartier-maître devint par la suite le héros d'une véritable odyssée que nous ne résistons pas au plaisir de résumer en quelques mots. Conduit devant un officier supérieur bavarois (c'était à un corps de sa nation que nos marins avaient affaire) et interrogé sur nos forces, avec menace' d'être fusillé s'il ne s'exécutait pas, il regarda l'officier bien en face et lui demanda: «Et vous, si vous étiez prisonnier, et qu'on vous posât la même question, est-ce que vous répondriez!» L'autre fut désarmé par cette fière présence d'esprit: «Tu es un brave», fit-il en lui tapant sur l'épaule, et il l'envoya à l'hôpital dans une grande ville belge, où d'héroïques bonnes sœurs risquèrent tout pour lui fournir un déguisement sous lequel notre homme parvint à gagner Anvers d'abord, puis la Hollande. De là il rentra en France et n'eut rien de plus pressé que de retourner sur le front. On comprendra pourquoi nous nous abstenons de le désigner, non plus que les religieuses qui l'ont fait évader. Si nous le connaissions, nous nous garderions encore davantage de citer le nom de l'officier bavarois, par crainte de le desservir auprès de chefs qui ne lui pardonneraient certainement pas de ne pas avoir achevé un blessé quand il se refusait de trahir son pays.
La fusillade dura toute la nuit, accompagnée par le grondement de l'artillerie belge, établie près de Meirelbeke, qui répondait aux batteries ennemies. Dans le lointain s'allumaient des lueurs sinistres: fermes incendiées, Allemands brûlant leurs morts, meules se mettant à flamber comme des torches. Et, inlassablement, à rangs serrés, compagnies après compagnies, les Bavarois montaient à l'assaut de nos tranchées. Quand ils n'étaient plus qu'à 10 mètres, les marins sortaient, chargeaient à la baïonnette, et rentraient jusqu'à la prochaine alerte. C'étaient de vraies luttes héroïques, où les apostrophes ne manquaient même pas, d'effroyables corps à corps dans lesquels on ne faisait ni quartier ni prisonniers: enfin, la mêlée qu'a si tragiquement rendue M. Charles Fouqueray. Mieux que n'importe quels mots, ses saisissants dessins rendent l'horreur de tout cela, en même temps que la toujours fière désinvolture de nos marins. Au petit jour, l'attaque ayant cessé, ordre fut reçu de réoccuper Gontrode, résultat que l'on obtint presque sans coup férir, tellement l'ennemi était las. En avançant, nos hommes trouvèrent entre autres morts un officier bavarois, à demi dévoré par les porcs. C'était le même que, la veille au soir, le Dr Castang (de la marine) avait été soigner au péril de sa vie, ce dont les Allemands avaient immédiatement pris avantage pour tirer sur lui.
Entre temps, une division anglaise débarquait à Gand, et envoyait au fur et à mesure des renforts sur la ligne qu'occupait notre 1er régiment, de l'autre bord de l'Escaut. On y redoutait un mouvement tournant qui eût mis en péril la retraite de l'armée belge, alors en pleine marche sur Eecloo. Mais nos adversaires avaient des moyens d'informations dont nous manquions. Un Taube d'abord, puis une automitrailleuse, opérèrent des reconnaissances complétées par des espions soi-disant belges. Voyant leur manœuvre déjouée, ils se rabattirent du côté où nous étions restés les plus faibles. Attaqués avec plus de violence que jamais, les fusiliers-marins du 2e régiment furent contraints d'évacuer Gontrode pour la seconde fois, et de se rabattre sur la voie ferrée, comme le soir précédent. Ils y étaient à peine quand se leva une brume qui faillit leur devenir fatale, en permettant aux Allemands de s'approcher sans être signalés. On perçut, heureusement, le coup de sifflet d'un de leurs sous-officiers, et quand ils escaladèrent le talus du chemin de fer, précédés par une espèce de géant roux, ils furent reçus par une décharge à bout portant qui les faucha comme blé mûr. Dans leur épouvante, ils firent des marins une nouvelle espèce de diables, les «diables bleus», à ajouter aux «diables noirs» déjà représentés par nos incomparables chasseurs, et le reste de la nuit se passa un peu plus tranquillement. Ils n'avaient qu'à attendre d'être cent contre un, ce qui ne tarderait pas, maintenant qu'ils pouvaient disposer de toutes les forces précédemment retenues autour d'Anvers.
Mais nous avions atteint notre but. L'armée belge était désormais sauve, et cela, on ne le dira jamais assez haut, grâce à nos braves petits matelots qui, pour leur coup d'essai, venaient d'arrêter 50.000 Allemands en marche, et de les tenir en respect aussi longtemps qu'il le fallut. Par ailleurs, les troupes rassemblées autour de Gand ne formaient plus qu'un îlot complètement isolé, tandis que la marée ennemie gagnait sur les deux rives de l'Escaut, menaçant de tout envelopper. En ce qui concernait plus spécialement la brigade navale, il allait y avoir deux jours et deux nuits qu'elle se battait sans trêve ni relâche, sans dormir et ne trouvant même pas le temps de manger. Pour toutes ces raisons, le 11 octobre au matin, il fut décidé que la retraite s'opérerait à la faveur de la nuit, et qu'elle serait commencée par les fusiliers-marins, que des Anglais viendraient relever afin de permettre leur «décrochage».
A 6 h. 1/2 du soir, nos matelots traversèrent Gand, anxieusement rogés par les habitants, auxquels on n'osait pas dire la vérité. Comi eût mieux fait, pourtant! Et non seulement là, mais partout où, confiants que les Allemands respecteraient les lois les plus sacrées de la guerre, nous leur abandonnâmes de malheureuses populations auxquelles ils allaient faire renouer connaissance avec toutes les barbaries oubliées depuis des siècles, pillage à blanc, destructions systé- ' matiques, incendie, viol, massacres en foule, abominables persécutions et cruautés les plus atroces, - en un mot, l'infernal aboutissement de la fameuse Kultur germanique... Mais on ne savait pas encore de quoi elle était capable, et c'était avec l'insouciance propre aux gens de mer que les nôtres quittaient la Venise de l'Escaut.
Aux portés, deux rangées d'hommes allongés coude à coude les mettent en joue. C'est l'arrière-garde anglaise qui les prend pour des Allemands, erreur reconnue à temps. Puis, la vaste plaine. Une nuit de rêve dans un paysage à la Kodenbach. Des eaux fuligineuses monte une brume fantastique, dont les écharpes blanches s'accrochent aux arbres. Avec cet étrange éclairage, tout prend des aspects inquiétants; surtout aux yeux d'hommes exténués qui marchent à demi endormis, pesamment chargés et le ventre vide. Us se dirigent sur Thielt, mais en passant par Aeltre, pour laisser la route aux atte- lages, et cela représente une première étape de 35 kilomètres qui sera vaillamment franchie dans la nuit, sans laisser un seul traînard. A Aeltre, où les deux régiments arrivent entre 7 et 9 heures du matin, on prend des cantonnements d'alerte, «quelques heures de repos dans de mauvaises granges, - inscrit le lieutenant de vaisseau Cantener sur son journal. On allait déjeuner, quand arrive l'ordre de rassemblement. Départ à midi, en abandonnant avec regrets l'omelette préparée. On déjeunera en chemin d'une boîte de conserve».
De Aeltre à Thielt, 20 kilomètres de route pavée, sous de grands beaux arbres. De chaque côté, fermes et riches cultures forment un tableau dans le genre de ceux où Van der Meulen a peint les guerres de Louis XIV en Flandre. Arrivée à 4 heures du soir, en même temps que la 7e division anglaise. Celle-ci salue avec admiration notre intrépide brigade navale qui, après quarante-huit heures de combat, succédant à deux jours de voyage, vient de couvrir 55 kilomètres en vingt heures. Grand remue-ménage, bien on le pense, dans cette petite ville où se trouvent rassemblés quelque 40.000 ou 50.000 hommes de toutes armes comme de toutes nationalités, et que traversent d'interminables files de batteries d'artillerie, d'escadrons de cavalerie, d'émigfants, de convois et d'automobiles. Une malheureuse créature est poursuivie par la foule, qui veut l'écharper. L'un de nos officiers s'interpose et découvre en elle une sœur converse des Dames Assomp-tionnistes que le peu d'agréments de sa personne et un costume dénué de la moindre coquetterie avaient fait prendre pour un espion allemand déguisé en femme. Le lendemain matin, 13 octobre, on se sépare. Les Anglais descendent sur Yp'res en passant par Roulers, où ils se battront avec acharnement. Nos marins filent vers Thourout, et y entrent au soir, sous une pluie diluvienne. La, ils ont l'insigne honneur d'être placés sous les ordres immédiats de S. M. le roi des Belges.
Va-t-on essayer de sauver Osténde, et pour cela faire tête sur le front: marais de Ghistelles - bois de Wynendaele - Cortemarck - Staden - Menin? Il en est question, et, après une; nuit de repos largement gagné, les fusiliers-marins se portent à l'Ouest de Peereboom, pour s'y organiser défensivement, en formation articulée. On leur adjoint un groupe d'artillerie belge (commandant Ponthus) qui ne les quittera pas de longtemps. Mais, à minuit, décision est prise de se replier derrière l'Yser, dont la ligne offre un meilleur point d'appui. Le mouvement commence vers 4 heures du matin, le 15, par des routes de plus en plus encombrées. Itinéraire: Werken, Eessen, Dixmude, que l'on atteint un peu avant midi. Les Allemands nous suivent à vingt-quatre heures près, ayant couché le 13 à Thielt et le 14 à Thourout. Ils vont arriver en colonnes profondes, déterminés à conquérir Calais, la mer, Paris, l'Angleterre, que sait-on d'autre? L'ambition de leur Kaiser ne connaît plus de bornes! Mais s'ils ont l'avantage du nombre et la supériorité de l'armement, il nous reste l'invincible résolution que les outrages accumulés, la moins justifiée des agressions et la perspective d'être brutalement spoliés de tout mettent au cœur des plus pacifiques. L'ordre est de tenir coûte que coûte. Pour la brigade navale en particulier, qui sera encore l'héroïne de cette nouvelle fête, il s'agit de garder à tout prix, mais cette fois pendant quatre jours, la gare de Dixmude par où doit s'écouler tout le matériel provenant d'Anvers. C'est là que se déroulera le second chant de son épopée. Et pour en finir avec le premier, inscrivons ici le nom qu'il portera dans l'histoire, celui de Melle, la jolie petite ville dentellière autour de laquelle se sont livrés les combats que nous venons de relater sommairement. Ce nom désormais fameux, il est d'ailleurs plus que probable que nous aurons incessamment occasion de le lire, doré en or éblouissant, sur le bel étendard tout neuf de nos marins, où il voisinera avec ceux de Dixmude et de Nieuport, en attendant mieux.
de la revue 'l'Illustration' No. 3763, 17 avril 1915
par Emile Vedel
II - La Défense de Dixmude
Dixmude est - ou était plutôt, car il n'en reste qu'un monceau de décombres - une paisible petite ville de 4.000 âmes. Jadis port mouvementé, quand l'Yser y creusait son estuaire (aujourd'hui reculé jusqu'à Nieuport), ensuite place de guerre, elle a connu des fortunes plus brillantes, avant de se voir réduite à la silencieuse quiétude d'un marché au beurre. De ce temps-là datent la Grand'Place, l'église Saint-Nicolas, célèbre par les merveilleuses ciselures d'un jubé où fleurissent toutes les mignardises de la Renaissance, et un béguinage blanc et rosé, mais d'un rosé délicieusement passé, près d'un pont rouillé qui se mire dans une eau dormante, entre des quais aux pierres disjointes et couvertes de saxifrages. Une vieille maison décorée d'ancres en fer forgé, à l'enseigne du Papegai (Perroquet), reste le seul souvenir de son passé maritime.
À part un faubourg, auquel la relie un pont-route, Dixmude est tout entière bâtie sur la rive droite de l'Yser canalisé, et dresse - je veux dire dressait - son beffroi gothique au centre d'une plaine basse et marécageuse, le schoore, que des centaines de petits fossés divisent en champs minuscules. Là dedans paissent les nombreux troupeaux, source du beurre tant vanté en Angletene. Abandonnées par leurs maîtres qui ont dû s'enfuir précipitamment devant l'invasion, les malheureuses bêtes erreront entre les Allemands et nous jusqu'à ce qu'elles aient été toutes mangées, et occasionneront plus d'une alerte nocturne. Quant à l'Yser, il roule ses flots limoneux entre deux digues surélevées, comme le sont aussi les chemins et villages du pays, afin de ne pas être submergés à la moindre averse. Peu d'arbres, sauf le long des routes, mais beaucoup de moulins. Chose curieuse, leurs ailes se remettront à tourner après l'exode des meuniers, et cela chaque fois que nos marins esquisseront un mouvement quelconque. Car, des espions, l'ennemi a trouvé le moyen d'en avoir partout. A quelques centaines de mètres dans le Sud de Dixmude est le cimetière, où nous serons obligés de nous retrancher. Il s'y passera des scènes dignes de iigurer dans une nouvelle Danse Macabre; entre autres lorsqu'une «marmite» déterrera le cercueil .d'une jeune fille, dont les marins horrifiés verront sauter le pauvre corps en pleine décomposition...
Tel est le cadre dans lequel va se jouer la première partie de l'interminable bataille des Flandres, qui dure encore. L'enjeu: Calais, que les Boches espèrent bien prendre après Anvers, et où l'empereur Guillaume se tient prêt à faire une entrée triomphale, comme à Paris, puis à Nancy, plus tard à Varsovie... et partout avec le même succès. D'un côté, 250.000 Allemands qui arrivent à la façon du choléra, sous le commandement du prince de Wurtemberg. De l'autre, nous avons vu les Belges se replier d'Anvers sur Bruges, couverts par nos héroïques matelots, puis de Bruges sur l'Yser. L'armée du roi Albert en. occupe maintenant tout le cours inférieur, de Dixmude à la mer, que surveillent nos troupes. En amont, il y a de la cavalerie française, qui sera prochainement remplacée par une division territoriale, et plus loin, vers Ypres, les Anglais. Mais Dixmude reste le nœud de la position, à cause d'une gare où se croisent les lignes Ypres-Nieuport et Furnes-Grand.
C'est pourquoi on en confie la défense à la brigade navale, avec ordre de tenir coûte que coûte - le mot reviendra souvent dans ses fastes - pendant au moins quatre jours, le temps qu'arrivent des renforts. Aucun retranchement préparé. Comme artillerie, des pièces de campagne belges, incapables de riposter aux écrasantes batteries lourdes que les Allemands vont amener, et toujours à court de munitions, hélas! D'ailleurs ni avions, ni ballons captifs pour régler le tir, et absence complète de tout service de renseignements. La brigade belge du général Meyser, réduite à 5.000 hommes, coopérera efficacement à la résistance, il est vrai. Mais l'amiral Ronarc'h n'en aura pas moins un front de 7 kilomètres à garnir avec seulement six bataillons, alors que le double serait nécessaire. Ce qui n'empêchera pas ses marins d'y rester cramponnés trois semaines en plus des quatre jours demandés, et quand, diminués de moitié, ils devront évacuer la bicoque en ruines qui a fini par leur crouler sur le dos, ce ne sera que pour passer le pont et recommencer. Aussi le général Joffre les appellera-t-il sa «garde impériale» à lui, déclarant qu'il ne les céderait pas contre 20.000 n'importe quels autres.
«Jeudi 15 octobre. - Nous arrivons à Dixmude vers 9 h. 30 du matin, au milieu d'un encombrement indicible. Campé, pour déjeuner, dans un champ labouré et détrempé à la sortie Ouest de la ville, passé l'Yser. (Journal du lieutenant de vaisseau Cantener.) A midi nous traversons la ville en sens inverse pour établir, aux abords, des tranchées défensives. Le secteur Nord est dévolu au 3e bataillon du 1e régiment (commandant Rabot) et à ma 11e compagnie revient la portion comprise entre la route de Keyem et le canal d'Handzaëme (qui se jette dans l'Yser, à Dixmude même). Heureusement nous ne perdons pas de temps, car à peine nos tranchées sont-elles couvertes, à la chute du jour, que nous recevons une première volée de balles et de shrapnels.
"Vendredi 16. - Perfectionné nos tranchées. Les pauvres fermiers, dont nous occupons terres et granges, font en hâte leurs paquets et se sauvent. Nous avons déjà cuisiné leur basse-cour. C'est la dernière fois que nous payerons nos réquisitions. Nous ne trouverons plus ensuite que du bétail à l'abandon. Le soir, grosse attaque des Allemands. A 4 heures du matin, le docteur Chastang trouve un espion rôdant au fond d'un fossé qui longe nos lignes... J'ai bien regretté de ne pas l'avoir fait fusiller sur place, au lieu de le remettre à la gendarmerie belge qui le relâchera peut-être.» »
C'est ainsi que la brigade prit terre à Dixmude. L'amiral en partagea aussitôt la garde entre ses deux régiments: le premier, chargé de la zone située au Nord du diamètre Caeskerke-Dixmude-canal d'Handzaëme; le second, de la partie restant au Sud de la même ligne. Comme on vient de le voir, le plus pressé fut de creuser, à 500 mètres en avant de la ville, un demi-cercle de retranchements dont les deux extrémités s'appuyaient à l'Yser. La rive gauche du canal, également fortifiée, abritait réserves, artillerie, convoi, munitions, poste de commandement, et assurait la retraite. Les mitrailleuses du lieutenant de vaisseau Meynard, toujours traînées à bras par leurs infatigables servants, demeurèrent groupées au centre de la défense, prêtes à se porter où besoin s'en ferait sentir. En réalité, c'était presque uniquement avec des poitrines d'hommes qu'on allait barrer le passage aux Allemands, mais d'hommes accoutumés à braver la colère de tous les éléments.
Le 18, un général belge, à la silhouette mince et fière, passe rapidement en revue la garnison de Dixmude, alignée sur la chaussée en bordure du canal. C'est le roi Albert, roi de l'Yser comme Charles VII fut un temps celui de Bourges. Il est venu s'assurer que nous sommes prêts à repousser de nouveaux assauts, imminents et formidables. Mais l'ennemi trouve le morceau trop dur à entamer, et préfère tâter la ligne d'un autre côté, entre Leke et Beerst. Laissant leurs tranchées à la garde de la brigade belge, les marins courent au canon.
Le 2e régiment marche en tête, mené par son chef, le capitaine de vaisseau Varney, d'une bravoure qui demeurera proverbiale. L'avant-garde est formée par le bataillon Jeanniot, qu'éclairent des goumiers dont les grands manteaux rouges et les petits chevaux arabes sont assez imprévus sous les arbres dénudés d'une route des Flandres. Mais Beerst est fortement occupé par les Allemands, et à peine la compagnie de Maussion de Candé arrive-t-elle à portée qu'elle est décimée. Sur sa droite se déploient les compagnies Pertus et Hébert. Celui-ci parvient à occuper une première ferme, et envoie ses lieutenants, l'enseigne de vaisseau de Blois et l'officier des équipages Fossey, s'emparer de maisons crénelées, d'où sort une fusillade des plus meurtrières. Nos hommes n'avancent que péniblement, en rampant dans la boue, et leurs pertes sont si lourdes qu'il faut remplacer le bataillon engagé par celui du commandant Pugliesi-Conti, opération dangereuse entre toutes, sous un feu pareil. On y parvient néanmoins, en même temps que le bataillon Kabot débouche de Vladsloo, et, à 5 heures du soir, le village de Beerst est occupé. Succès chèrement acheté! Deux cents tués, dont le lieutenant de vaisseau de Maussion de Candé, de tout premier ordre; l'enseigne de vaisseau Boussey et l'officier des équipages Fossey, deux héros. Parmi les blessés, les lieutenants de vaisseau Pertus, qui pleurait d'abandonner sa compagnie, de Roucy, Hébert, grand apôtre de la culture physique et fondateur de ce collège des athlètes de Reims qui a préparé tant de solides défenseurs de la patrie; les enseignes du Réau de La Graignonnière et de Blois, lequel, sous le pseudonyme d'Avesnes, a écrit des livres charmants que tout le monde a lus. Mais, à 6 heures, ordre de se replier sur Dixmude, qu'on traverse par une pluie battante, pour rentrer, vers minuit, dans les cantonnements de Saint-Jacques-Cappelle. Ce sont de véritables arches de Noé où les marins s'entassent pêle-mêle avec des artilleurs et des cavaliers, et leur premier soin est de préparer un peu de café chaud.
Bientôt, les Allemands mettent en batterie de l'artillerie lourde: 105, 150, 210 et jusqu'à du 280, pour se livrer à un bombardement intensif de Dixmude et des tranchées environnantes. L'Hôtel de Ville reçoit une des premières ces marmites », dont l'explosion tue 17 hommes et en blesse 26 autres. Le lieutenant de vaisseau Sérieyx fut le seul à en revenir. Projeté à terre par la secousse, il eutt en se relevant, la pénible surprise de voir le fourrier avec qui il parlait gisant à son côté, la moitié de la tête emportée; un autre, les yeux fixes, grands ouverts, avait un énorme morceau de fer planté dans le front; celui-ci retenait à deux mains sa cervelle, «elui-là qui criait: «Ma jambe! J'y suis!»... Visions d'horreur, mais auxquelles on s'endurcit assez vite. Après quoi, attaques renouvelées de jour" et de nuit, tranchées constamment prises et reprises, mais finissant toujours par nous rester. Combats furieux, dans lesquels nos matelots se ruaient comme à l'abordage, creusant chez l'ennemi de profonds sillons, malheureusement rebouchés presque aussitôt: ils étaient tellement plus nombreux! La baïonnette y jouait le rôle le plus important, et c'était à qui des «Jean-Le Gouin» - équivalent maritime du «poilu» - embrocherait le plus de Boches. Au vingtième, un Breton devint subitement fou furieux, tandis que l'arme d'un petit Parisien se brisait dans le ventre de son cinquième Wurtembergeois: «M....! - s'écria ce gavroche incorrigible - voilà que j'ai perdu mon épingle à chapeau!» Et prenant son fusil comme une massue, il continua de se battre. Ailleurs, un marin désarmé faisait le coup de poing contre trois Allemands. Des traits pareils, on en citerait jusqu'à demain. Et sortis de là, ils retrouvaient encore leur vieille gaieté française, témoin la chanson ci-dessous, rimée dans la tranchée, sur l'air: Auprès de ma blonde:
Sur les bords de l'Yser
Le plus moch' dans 'l'affaire,
Les marins ont tenu
C'est qu' l' vieux maît' commis
Les Allemands en arrière,
Etait loin sur l'arrière,
Si bien qu'ils n'ont pas pu
Et l' pinard avec lui!
Traverser la rivière et la flott' d' la rivière
Comme ils l'avaient convenu.
Charriait des corps pourris.
Su' l'bord de l'Yser-e
Su' l' bord de l' Yser-e
Contre Jean y s' sont butés,
Jean, qu' avait la pépie,
Et Jean, sans s'en faire,
Par les meurtrières
S' creusa des tranchées.
R'cueillait l'eau d' la pluie.
La pression des Allemands devenait de plus en plus écrasante. Le 22, ils réussirent à percer les lignes belges et à prendre pied sur la rive gauche de l'Yser, dans la boucle que celui-ci forme au Nord de Tervaete. Menacé d'être tourné, l'amiral envoie les deux bataillons Rabot et Jeanniot, pour enrayer l'infiltration et établir un front d'arrêt de ce côté. Vivement menée, l'affaire réussit, malheureusement au prix des sacrifices les plus pénibles. Tués: environ 100 hommes par compagnie, les lieutenants de vaisseau Cherdel, de Chauliae et Féfeu, les enseignes Sérieyx (cousin du lieutenant de vaisseau), Vigouroux, l'officier des équipages Hervé, qui tombe en criant à ses hommes: «Mes enfants, vengez-moi!», et Carrelet, ce dernier emporté à l'ambulance où il mourut "d'une mort héroïque et sainte».
Mais que deviendrait-on quand l'ennemi aurait établi des batteries qui nous prendraient à revers? C'est alors que le quartier général belge recourut au moyen suprême, consistant à submerger les terrains en contre-bas de la mer. Les écluses de Nieuport furent ouvertes et, de proche en proche, l'inondation se "tendit", semblable à une étoffe que l'on déploie très lentement. De rage, nos adversaires se rabattirent sur Dixmude, et ne laissèrent plus un instant de répit à la brigade, dont la tâche devenait de plus en plus lourde au fur et à mesure que ses forces allaient s'épuisant.
«Dimanche dernier, dans la nuit - écrit un de mes correspondants - comme nous venions d'être relevés, il a fallu retourner à la tranchée et repousser un terrible assaut. D... a été magnifique. Nous avons fait prisonniers un capitaine, un lieutenant et 200 hommes qui méritaient d'être fusillés, ayant été trouvés porteurs de balles dum-dum.»
Car les Allemands continuaient d'avoir recours aux moyens les plus déshonorants, surtout lorsqu'ils étaient employés par un major de la Garde, comme le Herr Graf von Pourtalès, qui criait, en excellent français: «Ne tirez pas, nous sommes des Belges!» Mais il fut démasqué par le «Wer da?» d'un de ses hommes, et abattu comme un chien par un de nos officiers qui cueillit sur lui des dépouilles opimes: «un beau sabre armorié et damasquiné, une paire de jumelles à prisme, un jeu complet des cartes de Belgique au 60.000e et une lampe électrique perfectionnée, le tout gluant de son sang, mais à la guerre il ne faut pas être trop difficile».
Dans la nuit du 25 au 26, se produisit une alerte encore inexpliquée. Une colonne ennemie, forte d'un demi-bataillon, trouva le moyen de s'introduire en ville, soit qu'elle ait réussi à se faufiler entre deux tranchées dont la défense était harassée, soit plus probablement par un souterrain aboutissant aux caves de certaines maisons suspectes. Refoulant tout devant eux, les Allemands parvinrent jusqu'au pont-route, où la sentinelle fut tuée. L'enseigne de vaisseau de Lambertye, qui veut, nouvel Horatius Coclès, leur barrer le chemin à lui tout seul, tombe percé de deux coups de baïonnette, - auxquels il échappa miraculeusement. Au bruit, tranchées et mitrailleuses de la rive gauche ouvrent le feu et couchent les trois quarts des assaillants par terre. Mais une centaine passent et continuent droit devant eux, tirant sur tout ce qu'ils rencontrent. C'est ainsi que sont fusillés à bout portant le médecin principal Duguet-Leffran (tué) et l'abbé Le Helloco, aumônier du 2e régiment (blessé). Un peu plus loin, ils surprennent et emmènent le capitaine de frégate Jeanniot, de repos cette nuit-là, qui sortait pour mettre en action la réserve du secteur. Puis les Allemands, avec quelques Belges et marins qu'ils ont ramassés chemin faisant, vont se raser derrière une haie, où ils sont découverts au petit matin et bientôt cernés. Avant de se rendre, ils eurent malheureusement le temps d'assassiner une partie de leurs prisonniers, dont le commandant Jeanniot. L'amiral fit exécuter séance tenante un certain nombre de ces misérables, en attendant que la gendarmerie eût établi le plus ou moins de responsabilité des autres. Et les officiers de la brigade, les rares qui survivent à l'enfer de Dixmude, se demandent toujours: si cette échauffourée n'était pas une répétition préparatoire à la surprise, du 10 novembre.
Depuis longtemps la ville n'est plus qu'un amas de briques et de moellons noircis par le feu, d'où s'échappent de lourdes fumerolles, comme d'un volcan mal éteint. Demeurent seuls debout quelques pignons veufs de leurs toitures, avec des châssis de fenêtres vides qui pendent lamentablement. D'immenses entonnoirs, creusés par les «marmites», coupent les rues: au fond de l'un d'entre eux, gît une charrette et son attelage. Blessé par deux balles de shrapnel, le lieutenant de vaisseau de'Meynard est porté dans une maison un peu plus épargnée que les autres, mais pendant que le docteur Lecœur achève son pansement, le tout dégringole dans la cave, et ce ne fut pas sans peine qu'on parvint à les en retirer tous deux. A un moment donné, nous manquons d'être enfoncés du côté du cimetière, où le lieutenant de vaisseau Martin des Pallières, après avoir repoussé plusieurs attaques d'une violence inouïe, est coupé en deux par un boulet. Le jour suivant, ce sera ailleurs qu'il faudra tenir bon, car les Allemands ne nous laissent pas une minute de répit, tournant autour de Dixmude comme une bande de chacals qui attendent l'heure de la curée. Des troupes fraîches, ils en amènent constamment et toujours, alors que, semblable à l'écueil qui s'émiette sous le refrain des vagues perpétuellement renouvelées, la brigade s'épuise, fond comme de la cire. Tant pis! On en sera quitte pour se dédoubler, par un prodige que va nous expliquer le quartier-maître-fourrier M... F..., déjà cité: « 3 heures après-midi. Je vous écris sous la tente de toile cirée et dans celle des événements, - mauvais calembour, sans doute, mais que les circonstances rendent presque sublime. La situation n'est pas brillante, et si je réchappe de ce coup-là, c'est que je suis «increvable». Nous nous battons depuis hier soir, et ne restons plus ici, dans ce coin de tranchée, que sept malheureux «Jean-Le Gouin», dans l'eau jusqu'au ventre, très gais quoique ça, fumant et «bouffant» comme quatre, tout en veillant à ne pas nous laisser cerner. Moi, pour me distraire, je note ce qui se passe. - 4 heures. Le reste de la compagnie est en tirailleurs sur notre gauche. J'envoie demander du renfort, mais le le «type» est tué. Je m'y glisse moi-même; on me promet de ne pas nous oublier, dès que la chose sera possible. - 4 h. 25. Nous ne sommes plus que deux, et les Boches arrivent en rampant. Pour donner l'illusion du nombre, nous prenons chacun deux fusils et tirons à toute vitesse, un fusil contre chaque, épaule, en courant derrière une haie. L'ennemi s'arrête et rebrousse chemin. Arrive une escouade de renfort, il était temps... Je ne sais plus exactement ce qui s'est passé ensuite, ayant dormi onze heures d'une traite: 35 hommes manquent à l'appel, mais nous avons fait 300 prisonniers et pris 5 mitrailleuses.»
On sent quand même que la fin approche. Les officiers en ont conscience et certains inscrivent à tout hasard des rencontres de camarades, dont chacune menace toujours d'être la dernière, «Notre aumônier passe (l'abbé Pouchard, du 1" régiment), venant des lignes avancées, infatigable malgré le surmenage. Un serrement de mains aussi à de Malherbe et à d'Albiat: nous sommes les trois seuls capitaines du régiment primitif! Puis je bavarde un quart d'heure avec ce brave de Montgolfier, aussi plein d'allant que jamais; nous ne nous reverrons plus...» Mais rien ne peut ébranler le moral de pareils hommes chez qui la mer a trempé les âmes à toute épreuve.
Ainsi, le même qui se livrait aux mélancoliques réflexions ci-dessus, continue par cette boutade: «Fait la connaissance de Grégoire, petit lieutenant d'artillerie belge, qui a la spécialité de bombarder les nids à mitrailleuses des Allemands. Il s'est mis en tête de démolir une grange occupée par l'ennemi, et vient s'installer dans la cour de la ferme où nous sommes en train de préparer le déjeuner. Nous prévoyons le résultat: la grange lui rira au nez, et dès qu'il aura déguerpi, son panier une fois vidé, c'est nous qui trinquerons de la réponse. Elle ne se fait pas attendre. Un premier obus tombe dans les étables et blesse un homme. Un second éborgne la maison. Hâtons le déjeuner, ce serait dommage de perdre nos belles pommes de terre si bien dorées. Vlan! et v'ian! Un obus dans le grenier, un autre devant la porte. Impossible de tenir. Je renvoie mes hommes aux tranchées et vais chercher mon plat. Mais un obus entre en même temps que moi dans la cuisine et renverse le cuisinier d'un éclat dans le dos. Mon ordonnance et moi le portons dans la cave, en attendant une accalmie qui permette de l'évacuer. Et nous filons nous terrer dans nos trous, sans, bien entendu, lâcher les frites, pendant que quatre ou cinq rafales pleuvent sur la case. Et tout cela, c'est la faute à Grégoire!»
Mais nous voici parvenus au dernier acte du drame. La nuit du 9 au 10 novembre avait été relativement calme, quand, au point du jour, le bombardement reprend avec une intensité qui n'a pas été atteinte jusque-là. Les coups se succèdent de seconde en seconde, s'abattant sur la ville, dans les tranchées, écrêtant les digues et fauchant les réserves. C'est le prélude de l'assaut final, et il dure toute la matinée. «11 heures. Les arbres du canal tombent l'un après l'autre. Deux de nos tranchées sont encore effondrées, sans qu'on puisse aller en retirer nos morts et nos blessés. Et cela continue!» marque le lieutenant de vaisseau Cantener, dont la 11e compagnie, nous l'avons vu, occupe le terrain compris entre ce canal de Handzaëme et la route de Keyem. C'est alors qu'un secteur voisin, sur la droite, mais que n'occupaient pas des matelots, se trouve brusquement débordé par le flot des Allemands qui montait toujours. «J'ai prévu le cas, - poursuit notre précieux témoin. L'officier des équipages Le Provost, avec sa section, court se poster contre la berge du canal de Handzaëme, d'où il les prendra en flanc. Oui, seulement eux aussi ont prévu, et parent. Avec uue précision mathématique, trois rafales d'obus se succèdent, tuant la moitié des hommes et dispersant le reste de la section. Enfin, notre tir à nous arrête les Allemands qui se replient en massacrant leurs prisonniers belges. Mais, de l'autre côté du canal, ils continuent à affluer vers la ville. Il faut faire face partout à la fois, et ça commence à ne plus être drôle du tout. En vain j'essaie de communiquer avec les compagnies déployées sur ma gauche (la 10e, capitaine Baudry, qui vient d'être tué, et la 9e, capitaine Béra). Tous les hommes de liaison tombent sans pouvpir franchir la route de Keyem. Que se passe-t-il derrière nous? On ne le devine que trop!»
De tous côtés, maisons, ruines et fossés se sont peu à peu remplis de Boches... 4 heures du soir. Voilà plus de vingt fois que je regarde ma montre. Ne recevant plus d'ordres de personne (le capitaine de frégate Rabot, commandant le secteur, est mort), j'avais décidé que si, par miracle, je pouvais tenir jusqu'à la nuit, j'essaierais de ramener à l'Yser le reste de ma compagnie et des voisines de gauche. Je n'ai plus qu'une quinzaine d'hommes autour de moi. Pourquoi l'ennemi ne nous cliarge-t-il pas? Incompréhensible! Un moment, il éclate tant d'obus autour de nous qjie nous avons la sensation d'être protégés des balles par ce déluge de mitraille... et nous entamons une boîte d'endaubage avec du chocolat comme dessert. Il est tout de même temps de déjeuner!»
Dans l'intervalle, les Allemands ont tourné les débris de la 12e compagnie qui ne compte plus que quelques fusils en ligne et les font prisonniers, ainsi que le capitaine Sérieyx, adjudant-major du bataillon: Ils les entraînent vers la rivière à laquelle ils cherchent un passage.
Mais suivant leur lâche habitude ce sera en les plaçant devant eux, comme boucliers, contre le tir des tranchées que masque la rive gauche de l'Yser. «Dites-leur de se rendre», enjoint un officier au capitaine Sérieyx. «Vous plaisantez, répond celui-ci avec le plus grand sang-froid, nous avons là au moins 10.000 hommes! » A cet instant, une balle lui traverse le bras, ce dont il profite pour tomber à terre, exprès. Il a vu que des marins, en réserve de l'autre côté du canal, ont pris une passerelle volante qui demeure cachée aux Allemands et arrivent à leur secours. Sur un signe de lui, ses hommes se laissent rouler du haut en bas du talus et, tous ensemble, franchissent l'Yser glacé à la nage, - le capitaine Sérieyx malgré son bras cassé. Ils étaient sauvés!
Revenons maintenant à ceux que nous avons abandonnés tout à l'heure. Ils se trouvaient au milieu des circonstances les plus critiques, et le même journal que précédemment va nous montrer comment ils en sont sortis à leur honneur. «Enfin, voici la nuit. En nous faufilant, nous parvenons à traverser la route de Keyem. Je recueille en passant ce qui reste des compagnies 9 et 10. Dévisse réussit à remettre en action une mitrailleuse belge. Quelques salves bien envoyées arrêtent les Allemands trop entreprenants du côté Nord, et une pointe poussée vers la ville par une demi-section intimide ceux du Sud. Ils doivent nous croire bien pris et veulent sans doute se masser avant d'enlever nos tranchées. Nous formons un petit carré de protection et allons ramasser ce que nous pouvons de nos blessés. En silence nous partons. Ciel couvert, pas de lune. Au loin, une ferme qui brûle assure à peu près notre direction. Pendant cinq mortelles heures nous nous glissons par les marais. On s'embourbe dans les ruisseaux vaseux où l'on risque à tout moment de s'enliser. Mais nous avons la chance de n'essuyer que quelques coups de fusil auxquels nous nous gardons bien de répondre, afin de ne pas nous signaler. On se servira de la baïonnette seulement si nous sommes attaqués... Nous arrivons enfin à l'Yser. O bonheur! la passerelle volante y est encore, à 200 mètres du pont-route où la bataille fait rage. On nous reconnaît; nous passons.»
C'étaient 481 hommes, ralliés un peu partout, que le lieutenant de vaisseau Cantener ramenait, avec leurs armes et équipements presque complets, contre toute espérance, ayant accompli une retraite aussi pénible que glorieuse. Et quelle littérature vaudra jamais son simple et émouvant récit?
Dans Dixmude même, les actes d'héroïsme sont innombrables. Mais ils ne peuvent aboutir à la conservation de la ville que l'amiral se décide à évacuer, pour se mettre en mesure d'arrêter l'ennemi sur l'Yser même. On fait sauter les ponts (le pont-route et celui du chemin de fer) et, à 5 heures, les ruines de ce qui fut Dixmude restent en pouvoir des Allemands. Maigre conquête, au regard de leurs colossales hécatombes! Quoique beaucoup moins important, le nombre de nos,tués et blessés était encore assez élevé. Parmi les premiers, le capitaine de frégate Rabot, les lieutenants de vaisseau Baudry, Kirsch, d'Albiat, Modet, Gouin et Lucas, les enseignes de Montgolfier - qui mourut «heureux, dit-il, de donner sa vie pour la France» - de Lorgeril, de Nanteuil, le médecin principal Lecœur. Au nombre des seconds, le capitaine de vaisseau Varney (il commande aujourd'hui le Henri-IV devant les Dardanelles), le lieutenant de vaisseau Sérieyx, les enseignes Melchior, Kez-Lombardie, les officiers des équipages Paul et Charrier. Saluons très bas.
Le même soir arrivaient des renforts, malheureusement trop tard. il ne restait plus qu'à s'organiser derrière la banquette de la rivière dont nous fîmes un obstacle infranchissable. Pendant six jours et six nuits, les Allemands essayèrent de passer à n'importe quel prix, saris autre résultat d'ailleurs que d'aggraver considérablement leurs pertes. Tels les sauvages, cruels et voleurs, que ceux de la vieille marine, comme moi, ont encore connus en Malaisie. Avec la même rage impuissante, ils s'acharnaient à l'escalade du navire en relâche dans leurs îles, animés par l'espoir de massacrer l'équipage et de faire main basse sur ses richesses. Et ce navire, la berge de l'Yser le rappelait un peu, couronnée qu'elle était de matelas pare-balles qui évoquaient le souvenir des bastingages à hamacs d'autrefois, et garnie de défenseurs en bérets à pompons rouges. Mais la brigade navale était épuisée. Il devenait absolument nécessaire de l'envoyer se reformer quelque part, et, le ltî novembre, une division territoriale se présenta pour relever l'amiral Ronarc'h et ses « Jean-Le Gouin » de leur « quart » de vingt-six jours sur l'Yser.
Au repos, ils n'y demeurèrent pas longtemps. A peine complétés, on les revit sur le front, et, bien entendu, aux endroits où ça chauffait le plus fort. Raconter leurs derniers combats est actuellement impossible, il faut attendre la fin des opérations auxquelles ils participent. Disons seulement qu'ils sont toujours en Belgique, pas loin de la mer. Le hasard les a même fait rencontrer avec les fusiliers de la marine allemande, qu'ils ont eu la satisfaction de battre copieusement.
Un autre jour, donc, j'achèverai de nouer en gerbe les lauriers de nos marins. Ne pouvant plus, hélas! marcher avec eux, c'est encore un peu les suivre que d'enregistrer pieusement les hauts faits de mes anciens camarades.
Emile Vedel