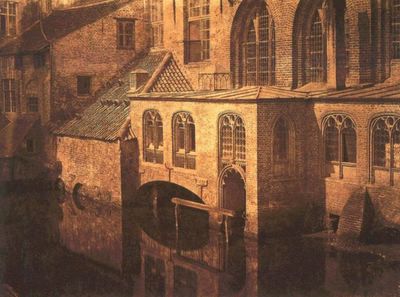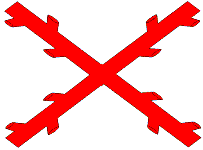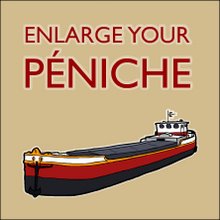En reconnaissance aérienne de St-Pol-sur-Mer
Dans les Avions
6 décembre
Sur la plage de Saint-Pol, où vient de nous déposer l'auto, douze aéroplanes sont rangés, pareils à de gros oiseaux de mer endormis sur le sable. Ce sont des « Voisin », de véritables monstres aux longues ailes grises, au capot large lancé en avant comme une proue de navire. Autour d'eux, les sapeurs s'agitent, portant des bidons d'essence et d'huile; ou bien, grimpés dans les nacelles, donnent un dernier coup d'œil aux moteurs. Les pilotes, arrivés avant nous, surveillent leurs mécaniciens, consultent l'état de l'atmosphère et la vitesse du vent. Depuis une huitaine, ce ne sont que tempêtes et que pluies. Aujourd'hui, le ciel s'est un peu dégagé, les nuages sombres filent très haut. Le jour gris est cependant lumineux. Sans doute, on va pouvoir sortir.
Les voisins LA5 du camp d'aviation de St-Pol-sur-Mer
J'ai été détaché pour quelque temps aux escadrilles de bombardement de Dunkerque. L'habitude de l'air, acquise au cours de mes trois mois d'apprentissage à l'école d'aviation de Reims, m'ont fait désigner pour remplir provisoirement une place vacante. Et l'ennui que j'ai ressenti en quittant mes chers camarades des chasseurs est bien atténué par la joie que j'éprouve à la pensée de recommencer à voler.
Pourvu qu'aujourd'hui le ciel nous soit clément!
Justement, voici mon chef d'escadrille, mon excellent camarade M..., qui vient vers moi, un papier à la main.
- Si le cœur t'en dit, mon cher, je viens de recevoir de l'état-major une demande de reconnaissance sur la ligne de chemin de fer de Dixmude à Gand. Le temps est clair, je t'offre cette occasion de promenade. Comme pilote, tu auras N..., que tu connais bien. Avec lui, tu peux être certain que tout ira bien.
Je connais, en effet, l'adjudant N... C'était l'un de mes pilotes moniteurs à Reims. Je le sais aviateur hardi, calme et expérimenté. De plus, je n'ignore pas qu'il a été cité deux fois à l'ordre de l'armée et qu'il a reçu lp médaille militaire depuis le début de la campagne. Je ne puis confier à un meilleur guide le soin de me mener au-dessus des lignes allemandes.
Le voici qui vient, le visage éclairé d'un large sourire, ses yeux gris brillant de courage et de franchise. Il n'a pas changé. Il a toujours son teint pâle, sa fine moustache blonde et son menton volontaire. Je reconnais sa démarche balancée, un peu lourde, semblable à celle des gens de mer. Nous nous serrons la main très cordialement et j'accepte avec joie de partir avec lui.
- Mon lieutenant, vous ferez bien de vous couvrir chaudement, car je vois que vous avez déjà le nez rouge et les mains violettes. Quand vous serez à 2 000 mètres et que vous ferez du 90, vous verrez qu'il fait un peu plus froid là-haut qu'ici.
Sur ses indications, je revêts un costume qui doit me rendre assez semblable à un Lapon. Je commence par retirer mes chaussures. J'enfile l'une sur l'autre deux paires de chaussettes, je remplace mes brodequins par des snowboots et je mets par-dessus ma culotte un large pantalon de cuir. En dessous de ma vareuse je me matelasse de deux tricots et en dessus je revêts un épais chandail. Je boucle péniblement sur cette quadruple cuirasse le ceinturon de mon revolver, car il faut toujours penser à un atterrissage forcé et l'on doit toujours porter sur soi de quoi défendre sa peau. Sur le tout, on me passe une ample peau de bique.
Complétez cet équipage par le passe-montagne, un épais cache-nez et par le casque, et vous aurez une idée de l'aspect comique que je devais offrir. Mais ici personne ne rit, car on est habitué à semblable mascarade.
Et N... s'est déguisé de la même façon que moi. Je le vois déjà qui grimpe dans son appareil. Je me hâte autant que me permet mon accoutrement, et je me hisse derrière lui dans la nacelle.
Rien ne peut donner une idée du mal que l'on a, ainsi habillé, pour lever suffisamment la jambe. Et pourtant il faut atteindre le premier marchepied et, du deuxième, enjamber le rebord du capot. Enfin, j'y arrive, non sans peine. Dès que le mécanicien de V... a mis le moteur en marche, je m'assois à mon poste d'observateur, bien calé dans le petit siège surélevé à dossier métallique.
Je peux voir ainsi par-dessus la tête de mon pilote, et c'est avec un véritable sentiment de confort que je m'installe et que je boucle la large ceinture de cuir qui me lie à mon siège.
N... essaye son moteur avant de partir. Tandis qu'une douzaine de sapeurs, agrippés aux ailes, maintiennent l'appareil, l'hélice tourne à toute vitesse avec un bruit assourdissant. Toute l'armature vibre sous son effort colossal. L'avion semble se ramasser, prêt à bondir, comme un cheval ardent maintenu par une poigne de fer. Les hommes sont obligés de se cramponner vigoureusement. Ils appliquent leurs épaules contre les longerons, ou bien, les deux bras tendus, le corps'fortement incliné, ils résistent à la poussée du moteur en enfonçant de biais leurs pieds dans le sable de la plage. Tout fonctionne bien et je me réjouis de sentir que, du premier coup, la capricieuse machine a donné son maximum de puissance. Je suis heureux qu'on n'ait pas été obligé de décrasser une bougie ou de vérifier une soupape.
Pas un raté; le ronflement majestueux et assourdissant est admirable de régularité. Il diminue ou reprend à volonté lorsque le pilote le désire. À nous deux, maintenant, mon cher N..., de remplir vaillamment notre mission!
Elle est simple, notre mission. Compter les trains de troupes qui circulent entre Dixmude et Gand, en indiquant sur ma carte l'heure et le lieu de leur passage et le nombre de leurs wagons. A cette hauteur, la seule difficulté est de ne pas confondre les trains de troupes et les trains de ravitaillement. A la hauteur où nous serons obligés de voler, cela n'est pas aisé. On n'a qu'une ressource, c'est de voir quels sont les trains uniquement composés de wagons couverts et quels sont ceux qui comportent à la fois des wagons couverts et des trucs. Ces derniers seuls sont des trains de troupes, car chaque unité qui se déplace en chemin de fer est accompagnée de ses voitures, placées sur des wagons spéciaux. A l'état-major, on déduira du nombre de voitures de chaque espèce l'effectif de la troupe et l'arme à laquelle elle appartient.
N... a mis son moteur au ralenti et a levé le bras. Les sapeurs s'écartent vivement. Et aussitôt, le ronflement reprend toute sa force, l'appareil s'échappe, roule à une vitesse vertigineuse sur le tapis uni de la plage. Il décolle sans que je m'en aperçoive, et nous voici à dix mètres au-dessus du sol. Déjà, nous passons au-dessus du camp d'aviation anglais, établi auprès du nôtre. Je vois, autour de leurs avions, des hommes qui lèvent la tète et se remettent à leur tâche. Notre « Voisin », pris dans un remous et ballotté par le vent, tangue furieusement. Il serait temps de prendre de la hauteur, car nous sommes ici sérieusement secoués. Néanmoins, j'éprouve une véritable volupté à goûter de nouveau l'ivresse de l'air.
Pendant quelques minutes, nous remontons vers le Nord en longeant la côte pour prendre de la hauteur. A gauche s'étend la mer. Elle s'étale à l'infini, formant une immense nappe d'un bleu sombre, où l'on distingue des myriades de petites taches d'écume blanche. Un paquebot, qui nous paraît minuscule, fait route vers l'Ouest. Son sillage forme dans l'eau un triangle plus foncé qui s'étend au loin derrière lui, et l'on peut distinguer d'ici tout un essaim de mouettes, qui semblent l'escorter en tournoyant.
Le moteur ronfle toujours régulièrement. Je voudrais bien pouvoir parler à N..., lui communiquer mes impressions, lui demander des renseignements sur tout ce que je vois de nouveau, car voilà déjà longtemps qu'il navigue, si l'on peut dire, dans ces parages. Mais le bruit est tel que, pour s'entendre, il faut véritablement hurler. Encore les paroles ne s'entendent-elles que difficilement.
Nous sommes maintenant à 300 mètres. N... décrit un brusque virage au-dessus du port. L'avion s'incline d'une façon inquiétante; c'est à croire qu'il va se retourner et tomber dans les bassins, dont j'admire les lignes géométriques et les nombreux bateaux qui semblent de bizarres petits jouets correctement alignés.
Et, aussitôt, malgré la faible hauteur où nous sommes, N... s'engage hardiment au-dessus de Dunkerque. C'est là, évidemment, une audace qui nous coûterait cher si le moteur avait une panne. Mais le pilote a confiance dans sa machine.
Un instant, mon intention se fixe sur lui. Impassible, le dos légèrement voûté, bien assis sur son siège comme un vieux cavalier dans sa selle, il regarde au loin sans s'inquiéter de la ville qui s'agite, vibre et respire au-dessous de lui. Ses deux mains, gantées de fourrure, sont posées sur le « manche à balai » qu'elles tiennent à peine. Je les vois qui oscillent continuellement pour rétablir l'équilibre détruit à chaque seconde par les rafales du vent. Il semble être l'âme même de l'avion. Et il l'est en réalité, ou, du moins, il en est le cerveau qui dirige les muscles, ordonne les mouvements, pense, prévoit et décide. Quelle admirable chose !
Comme j'admire cet être vivant formé de deux êtres différents - vivants tous deux, - le pilote et l'avion.
L'altimètre marque 400. Nous passons au-dessus de la place Jean-Bart, où le marché bat
son'plein. Penché sur le vide, je m'amuse à regarder les baraques bien alignées et le va-et-vient des acheteurs. Mais l'aéroplane file très vite, poussé par le vent qui souffle du Nord et double notre vitesse.
J'admire le pourtour des fortifications qui limitent la ville d'une ceinture verdoyante. Nous les dépassons et nous voici maintenant au-dessus de la campagne. Il faut à présent renoncer à la joie sportive qui m'a seule occupé jusqu'ici, ne plus perdre de vue la carte et le terrain. L'expérience m'a déjà démontré combien l'on se perd facilement quand on vole au-dessus d'un pays inconnu. Il ne faut pas que j'oublie ma mission. Le plaisir du touriste m'est interdit aujourd'hui. Nous sommes en guerre.
C'est vrai: j'oubliais...
Nous laissons le fort Louis à notre droite et piquons directement vers l'Est. Quel étrange pays s'étend en dessous de nous! Des milliers de canaux, de ruisseaux, de chemins, des champs coupés de haies qui forment des entrelacements bizarres. Il faut redoubler d'attention pour ne point se tromper de direction. Heureusement, nous sommes maintenant à 1 000 mètres et je ne perds point de vue le canal de la Basse-Colme, que nous allons couper pour rejoindre la ligne de Furnes à Gand. A partir de là, nous ne quitterons plus la voie du chemin de fer et cela facilitera ma tâche.
Le froid est devenu intense. Malgré mes vêtements superposés, je sens déjà mes mains et mes pieds glacés et mon corps semble suivre peu à peu leur exemple. Je ne m'amuse plus à considérer le paysage qui se déroule à mes pieds. D'ailleurs, à la hauteur où nous sommes, les détails pittoresques disparaissent. Les routes semblent désertes et les villages morts. Il faut se servir de la jumelle pour distinguer les voitures sur les chemins et les péniches sur les canaux.
Et puis, nous approchonsi des lignes allemandes. Je ne puis m'empêcher de songer que, quelques jours auparavant, le sergent-major R..., un des pilotes de l'escadrille, a été abattu par un projectile allemand d'une hauteur de 2 000 mètres. Quand j'étais à terre, tout à l'heure, je ne songeais qu'à la beauté de cette mort.
Maintenant que nous approchons de la ligne de feu, une certaine émotion m'envahit. Ce n'est point la peur, certes: nous en avons vu bien d'autres. Mais une idée me hante. Dans quelques minutes, je vais être au-dessus des tranchées allemandes, dans nne demi-heure je serai au milieu du territoire occupé par l'ennemi.
Si alors un de leurs obus nous frappe et si nous avons une panne, nous serons obligés d'atterrir. Trop éloignés pour pouvoir atteindre les lignes françaises, si nous ne sommes pas tués, nous serons faits prisonniers. Tout plutôt que cela!
Mais je chasse ces pensées moroses. Ma confiance revient vite dans mon étoile. Jusqu'ici la chance m'a singulièrement favorisé. Il n'y a point de raison pour qu'il n'en soit plus ainsi. Et l'ivresse du mouvement me saisit. Je ne songe plus qu'à la délicieuse sensation que j'éprouve à dominer, moi, faible chose, être anonyme, combattant inconnu, ces deux armées qui se choquent.
L'avion semble porté par le vent. Avec lui, il bondit, redescend, s'incline et frémit.
J'éprouve une véritable joie à me dire que, sur ce pays gris sombre qui s'étend au- dessous de nous, des milliers d'hommes ont les yeux fixés sur le petit point noir que nous sommes. Le bruit du moteur a fait lever toutes les tètes. Les yeux ont cherché quelques instants et, bien vite, on a vu se dessiner dans le ciel les deux grandes ailes sombres légèrement incurvées à l'arrière, le gouvernail de profondeur mince et allongé. Les uns ont eu tout de suite un regard de sympathie pour l'oiseau connu qui porte sur ses ailes les couleurs de France. Ils ont senti que c'était un peu d'eux-mêmes qui passait là-haut et s'avançait vers l'ennemi pour les aider, les éclairer dans leur rude tâche.
Instinctivement, ils ont fait des vœux pour le succès de sa mission. Les autres, au contraire, lui jettent des regards de haine. Eux aussi, connaissent bien la forme de cet avion qui avance vers eux. Bien souvent, ils en ont reçu de rudes leçons. Ils le couvent des yeux, se demandent pourquoi on le laisse venir ainsi. Ils souhaitent de voir bientôt les flocons de fumée environner l'appareil. Ils espèrent le voir soudain osciller, s'incliner, tourbillonner comme une feuille morte, puis s'écraser à l'intérieur de leurs lignes.
Justement, nous voici au-dessus des tranchées. Quel aspect bizarre elles présentent d'ici, à 1 800 mètres de hauteur! On distingue très nettement la ligne sinueuse qu'elles forment et les mille ramifications qui s'y rattachent, boyaux de communication, postes d'écoute, cheminements d'accès. On croirait voir deux reptiles monstrueux aux pattes innombrables et inégales qui serpentent l'un à côte de l'autre et dont les corps se rapprochent, se séparent, semblent vouloir se toucher, puis s'éloignent encore. En arrière d'eux, les nombreux épaule-rnents des batteries sont très nettement visibles.
Et voilà que ma contemplation amusée est tout à coup interrompue. Par-dessus le bruit du moteur, j'ai perçu une forte détonation à quelque distance derrière nous. Je regarde N... et je vois qu'il secoue la tête comme s'il voulait dire: Non. Il ne se retourne même pas et continue sa route, les yeux fixés au loin pour ne pas perdre sa direction. Mais je ne puis imiter son calme et je me penche légèrement hors du capot. En arrière de nous, à 400 mètres environ de distance et un peu en dessous, j'aperçois un flocon de fumée jaunâtre, épaisse, ressemblant à un gros paquet de canton que l'on serait arrivé à projeter jusque-là.
Au même moment, j'entends trois détonations plus fortes et trois projectiles éclatent bien plus près de nous, à 200 mètres au plus. J'avoue qu'à ce moment-là, je voudrais bien me trouver ailleurs. Que ceux qui n'ont pas connu cette première rencontre dans les airs avec les obus ne me jettent pas trop vite la pierre. Cette situation n'a rien de commun avec les situations où l'on peut se trouver dans un combat ordinaire.
On peut, quand on est exposé au feu, se jeter à terre, chercher un abri, creuser un trou au besoin.
On peut souvent répondre à l'ennemi, se défendre, lui rendre coup pour coup. On est excité par la lutte, l'esprit est tendu vers la mise à l'exécution du but que l'on se propose: détruire le plus de monde possible en face de soi.
Et puis, l'on se dit: Si je suis frappé, j'aurai quelqu'un des miens, là, tout près de moi, qui m'aura vu tomber, me portera secours si je ne suis que blessé, et qui, si je suis tué, me fermera les yeux, prendra les quelques chères reliques que je garde sur moi et les fera parvenir à ceux que j'ai laissés là-bas, chez nous.
Ici, rien de tout cela. Si, tout à l'heure, un des gros projectiles vient éclater dans l'appareil, ce sera la chute vertigineuse, comme il advint à ce pauvre R... la semaine passée, et il ne restera plus sur le sol que quelques débris sanguinolents dans lesquels les Prussiens fouilleront de leurs grosses pattes, tâchant de trouver nos papiers, nos carnets et nos notes. Et le dégoût me vient à la pensée de ces butors ouvrant mon portefeuille et se passant de main en main, avec des rires gras, des photographies, des médailles, quelques lettres...
Et si, simplement, un éclat vient frapper l'hélice ou le moteur, il nous faudra faire une descente savante en vol plané, tâcher d'arriver à regagner nos lignes quand même. Le pourrons-nous?
Nous avons fait déjà du chemin el le vent sera contre nous. Si nous échouons, ce sera l'interrogatoire subi, ce sera le supplice à supporter les regards gouailleurs, les sourires suffisants, les questions insidieuses. Plutôt mille fois la première catastrophe.
Mais N... s'est retourné, il se penche et regarde du côté des éclatements. De nouveau, sa tête s'agite de gauche à droite. Il me regarde de ses yeux clairs. Il rit d'un rire franc, large, joyeux, et il hurle à mon oreille que j'ai penchée vers lui:
- Pas de danger! Ce sont des obusiers... Ils ne peuvent tirer plus haut que 1 800 mètres... Ah! si c'était leurs canons spéciaux...
Il regarde l'altimètre. Il marque 1 900.
Et maintenant, stupidement, je suis pris d'une sorte d'allégresse, je ris tout haut à la pensée des canonniers qui, à mes pieds, doivent se dire: Nous les tenons! Justement, voici quatre nouveaux obus qui viennent d'éclater encore plus près de nous, mais toujours trop bas. Les détonations paraissent formidables malgré le ronflement du moteur. La fumée épaisse et jaune forme comme quatre écrans opaques destinés à nous cacher des petits coins de paysage. Allez, allez, tirez! Cela ne va pas nous empêcher de voler au-dessus de vos régiments, de vos batteries, des villes en ruines que vous occupez dans l'infortunée Belgique. Cela ne nous empêchera pas de remplir notre mission.
Justement, voici un panache de fumée blanche. Je l'entrevois à peine sur ce ruban brunâtre qui se déroule parmi la campagne grise et qui est la ligne de Gand. Vite, ma jumelle. Oui, je vois un train qui s'avance vers Dixmude. Du moins, je le devine, grâce à la direction de la fumée, car, à cette hauteur, on ne perçoit aucun mouvement. C'est bien un transport de troupes. Je distingue, au milieu des wagons, les plates-formes rectangulaires des trucs. Je saisis ma carte fixée à une planchette accrochée à mon cou. Je repère le point où se trouve le train en ce moment et y mets un petit trait au crayon bleu; j'inscris l'heure à côté: 8 h. 15, et je compte le nombre des voitures.
- Une, deux, trois...
N..., les yeux au loin, comme un capitaine sur son navire, garde soigneusement sa direction. Je m'en veux maintenant de ma stupide et fugitive émotion de tout à l'heure. Je ne veux plus songer qu'à remplir religieusement ma mission. En avant! Je me sens rempli d'allégresse. Je voudrais embrasser mon pilote, tant je me sens heureux et tant je voudrais lui prouver ma confiance.
Maintenant, vous pouvez tirer, Messieurs les canonniers allemands!
de la revue 'Le Noël' no. 1080, 2 mars 1916
'Reconnaissance Aérienne'
par Marcel Dupont
du livre 'En Campagne'