le général Foch à Cassel en 1914
La Pendule de Cassel
Il est déjà tard dans la nuit.
Cassel, petite ville flamande dont l'antique splendeur n'abrite plus que des crépuscules d'existences bourgeoises, a depuis longtemps clos ses volets. Sur la place, les autos du groupe d'armées se cachent dans l'ombre de la haute rampe princière que décore en son milieu une fontaine Louis XIV. Un chasseur à pied, baïonnette au canon, et un gendarme, dont le visage disparaît dans le col relevé de son manteau, battent la semelle sur le trottoir, au pied du fanion cravaté de rouge et de blanc, fanion improvisé au début de la guerre, dans le désarroi de la tourmente, avec une lance empruntée au théâtre de Reims, une de celles qui servaient indistinctement pour le défilé à'Aida, le chœur de Faust ou le dernier acte de Carmen. Par le courant d'air qui s'engouffre sous la voûte de la porte de Bergues arrive le grondement lointain mais ininterrompu du canon qui « tape dur » du côté d'Ypres.
Là-haut, au premier étage de la mairie, les fenêtres sont éclairées. Il y a celle, étroite, du Central téléphonique, puis les baies glauques du hall dont une lampe fumeuse assume à elle seule la clarté et où, frileusement, les estafettes jouent aux dominos autour du poêle, puis les deux fenêtres du chef d'état-major et du bureau des opérations et enfin les fenêtres du général Foch.
Dans le couloir sombre qui mène à ce bureau, sur la porte duquel on lit « Caisse d'épargne », Gifosse, le planton du général, se rafdit, hiératique et vigilant, sur sa chaise. Un filet de lumière filtre sous la porte qui mène au réduit poussiéreux où, faute de mieux, on a logé les officiers du chiffre. Derrière une cloison, le son galopant d'une machine à écrire trouble seul le silence.
Ce sont pourtant les heures dramatiques de la bataille de l'Yser: octobre et novembre 1914. On se serait imaginé une fièvre intense, un perpétuel va-et-vient d'officiers d'état- major crottés, des ordres nerveux, des portes qui claquent, une vision napoléonienne d'activité fébrile. Non, c'est le silence, un silence très calme, respectueux et confiant. Le général et son chef d'état-major travaillent. Eux seuls connaissent l'étendue et les difficultés du problème. Tout est absorbé par ces deux cerveaux. Le travail d'analyse et de synthèse se développe en eux. Ils n'en laissent rien deviner. Pas de confidences, de conférence générale où chacun dit son mot, où l'on s'énerve mutuellement à discuter des hypothèses et proposer des solutions.
La pensée du chef domine, parce qu'elle doit dominer, parce que c'est le principe même du haut commandement. Celui-là est fort qui accepte toutes les responsabilités, non seulement vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de lui-même et ne cherche pas à se couvrir devant sa propre conscience par l'avis plus ou moins autorisé d'un tiers.
Le général Foch a ce courage et cette foi. Parfois, dans le courant de ces journées, il traverse la place, monte vers la vieille église dont un crucifix géant, entouré de lierre grimpant, décore la façade, et pénètre dans le sanctuaire vide. L'homme de guerre va prier. Oh! ce n'est pas un vain exercice de paroles, la répétition de certaines formules sacrées, une invocation magique, un appel théâtral à quelque vieux Dieu français, — c'est son âme angoissée qui entre en rapport conscient avec la puissance mystérieuse dont elle sent qu'elle dépend et que dépendent sa destinée et celles de millions d'êtres qui gravitent autour d'elle. C'est un acte de soumission et de foi. C'est la dépendance puis la liberté que donne l'accord avec son Dieu.
En ces instants si graves de la vie de notre pays, quand la plus petite erreur dans les jugements et les décisions peut être fatale, l'homme sur lequel pèse l'une des plus formidables responsabilités que l'on puisse imaginer, humblement puise sa force dans la prière. La force qui incline est aussi celle qui redresse.
Au silence et à l'ombre du temple succèdent le silence et la clarté du cabinet de travail.
Les cartes couvrent les grands panneaux de chêne des murs.
Sur la cheminée, deux chandeliers, une vieille sonnette de bronze noirci et une délicate pendule Louis XVI dont deux colonnettes blanches supportent le cadran.
Cette pendule au balancier visible sera l'unique compagne des veillées émouvantes. Son maître, le Temps, est un collaborateur avec lequel la stratégie doit compter. « Le débarquement des renforts a-t-il pu se terminer assez vite pour secourir le point de la ligne qui faiblit? La 42e division a-t-elle réussi à reprendre Ramscapelle? Comme les heures passent lentement! Comme les heures vont vite! Le 9e corps n'a pas encore téléphoné? » La petite pendule poursuit le va-et-vient de son balancier. Au temps lointain où l'horloger la créa, elle ornait quelque boudoir, celui de Mme la Conseillère ou d'une noble dame du comté des Flandres. Elle a marqué bien des heures frivoles et inutiles, puis sont venus les jours graves de la Révolution, — peut-être en ces jours-là ne l'a-t-on plus remontée? Des kaiserliks, quelque soir de patrouille, l'ont convoitée, mais les hussards du général Vandamme ont empêché son départ au delà du Rhin. C'est l'épopée napoléonienne, puis le calme de la vie bourgeoise française qui revient; 48; le Second Empire; la tragédie de 70; le grand effort de relèvement de notre Patrie, sa résurrection. Le petit disque de cuivre se meut de droite à gauche et de gauche à droite, tic, tac... tic, tac, discrètement, comme font les bonnes pendules françaises qui répugnent au bruit fatigant des coucous de la Forêt Noire.
Dixmude, Bixsehoote, Poesele, l'écluse de Nieuport, Neuve-Chapelle... L'histoire s'écrit lentement, les jours s'effeuillent, la destinée s'accomplit. La pendule, à laquelle les pulsations de cuivre donnent comme une vie intérieure, a été pour le général une amie, une confidente. Elle sait un peu des pensées qui ont bouillonné dans ce cerveau génial et qui en sont sorties clarifiées, calmées, prêtes à se muer en actes virils et bienfaisants.
Un jour de printemps, des plantons sont venus décrocher les cartes du mur; le général est parti, la mairie a repris son existence normale et le couloir de la Caisse d'épargne a vu se réunir les souscripteurs de l'Emprunt.
La bataille s'était déplacée vers le Sud. Cassel redevenait petite ville de province. On commençait déjà de dire, dans les conversations: « Vous souvenez-vous, quand le général Foch était là... »
Les années ont passé, puis, un soir, la plaine des Flandres s'est sentie à nouveau secouée d'un terrible frisson. La ruée allemande recommençait. Elle déferlait au sommet du Kemmel, elle s'épandait dans les villages dévastés, elle menaçait Cassel. Ce fut une grande angoisse.
Mais le général Foch est revenu; il a repris, pour quelques jours, le petit bureau du receveur de la Caisse d'épargne; il s'y est enfermé avec ses cartes et son téléphone, et, machinalement, dans ce cadre familier, ses yeux se sont portés vers la pendule Louis XVI aux colonnettes de marbre.
Et le passé est réapparu. Aux jours déjà lointains de 1914, l'armée française, presque seule, avait, dans un admirable effort, brisé l'assaut germain. Nous n'avions plus de réserves, peu d'artillerie lourde, peu de munitions; l'armée anglaise n'était qu'une petite phalange ; l'armée belge manquait de tout. En frères d'armes, en braves gens, on s'était entr'aidé. Comme tout cela est loin et proche à la fois ! Maintenant, du monde entier, les secours sont venus à la France, de formidables armées se rallient à nos étendards, les usines de la moitié du globe travaillent pour les soldats de l'Entente. Qui eût cru qu'un jour, de ce même petit bureau de Cassel, partiraient des ordres d'attaque pour des divisions américaines!
La vieille pendule vient de sonner la demie de l'heure. C'est comme une réponse aux pensées qui vont vers elle.
Et elle dit: « Quel étrange souvenir s'éveille en moi! J'entends maintenant d'anciennes, très anciennes causeries. C'était tout au début de mon entrée dans le monde. Au coin de la grande cheminée, dont je décorais le centre, un jeune officier était accoudé et il parlait avec un vieux gentilhbmme à perruque poudrée. Je me souviens qu'ils avaient longuement discuté de M. de Voltaire, dont le retour à Paris avait fait tant de bruit, et puis le jeune officier s'était animé. Il disait son enthousiasme pour un pays d'outre-mer qui luttait pour son indépendance; il s'enflammait au mot de « liberté », le plus beau mot de la langue française; il affirmait qu'un Français se devait de soutenir une telle cause et qu'il allait partir. Quelqu'un survint et l'appela. J'ai su ainsi qu'il se nommait M. le marquis de La Fayette. »
La petite pendule a dit tout cela de sa jolie voix d'ancienne France, comme sur deux notes hautes d'un lointain clavecin. Tic, tac... Tic, tac... Les aiguilles avancent sur le cadran d'émail. Un jour encore va bientôt finir.
De lourds tracteurs, qui roulent sur la place, font trembler les vitres; des régiments défilent en martelant les pavés; c'est une immense armée qui marche à la rencontre des barbares.
Des jours et encore des jours passeront. Un soir le canon se taira et on ne l'entendra plus jamais. Le receveur de la Caisse d'épargne ne reviendra pas, chose curieuse, dans son bureau. Un employé de la mairie, en bel uniforme neuf, ouvrira la porte devant des touristes, qui s'arrêteront sur le seuil, n'osant pas le franchir, comme à l'entrée d'un sanctuaire. Il leur dira simplement: « Le bureau du général Foch. »
Ils écarquilleront les yeux et, dans cette pièce nue, dédaignant les deux modestes chandeliers et la lourde sonnette, ils fixeront leur attention sur une délicate pendule Louis XVI, bien à l'abri sous un globe, sans réaliser peut-être tout à fait que son vieux mécanisme, ciselé par un bon ouvrier français du dix-huitième siècle, a pu assez durer, comme tout ce que la France a créé de robuste et de beau, pour marquer les heures les plus grandes de l'humanité.
René Puaux
de la revue L'Illustration No. 3924, 18 mai 1918








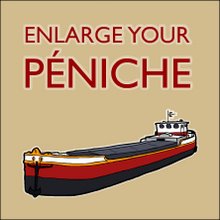

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire