Souvenirs de 14
Le journal d'une Lilloise,
de Jeanne Du Thoit
de la revue ‘Lecture Pour Tous’ du 1er avril 1916
Lille, 4 octobre 1914. — La première bombe vient d'être lancée sur la ville, à midi, atteignant une cité ouvrière, rue des Pénitentes. La stupeur est générale. On vivait dans une sorte de quiétude, on ne croyait pas le danger si proche.La nouvelle se répand que les Allemands ont tenté un coup de main (on parle même d'un train blindé): ils sont à Fives, on se bat dans les faubourgs.Dans l'après-midi le canon gronde, la fusillade ne cesse pas dans le lointain, et pourtant les Lillois, superbes d'audace imprudente, défilent dans la rue des Pénitentes pour examiner les dégâts produits par la bombe.Vers cinq heure:., la canonnade augmentant, c'est une dispersion générale, chacun rentre chez soi.
5 octobre. — On continue à se battre dans les environs, mais les Allemands ne sont pas en nombre. Ils sont repoussés par la troupe arrivée à Lille depuis quelques jours.Chacun va aux nouvelles, avide de connaître le résultat des combats de la veille. On apprend des choses navrantes. Des maisons sont incendiées, des gens tués....« Allez à Fives, me dit-on, vous verrez ce qu'est l'image de la guerre. »Les habitants de Saint-André, de la Madeleine, pris d'une sorte de panique, arrivent à Lille où l'affluence devient énorme. Personne ne veut rester dans la banlieue.
6, 7 et 8 octobre. — Accalmie, les journaux nous rassurent, le danger semble écarté momentanément. Les faubourgs sont débarrassés des ennemis qui ont été refoulés. Les chasseurs du 17e font des reconnaissances aux environs, et quand, à la tombée de la nuit, ils reviennent à la caserne, par escouades, les fenêtres s'entr'ouvrent sur leur passage et on les interroge fiévreusement.« Dormez tranquilles vous n'avez rien à craindre pour cette nuit, » répondent nos braves.Et sur ces mots, pleins pourtant de menaçantes éventualités, la ville s'endort plus confiante et plus calme.
9 octobre. — La sérénité renaît; depuis plusieurs jours le bruit du canon a cessé. Le danger serait-il réellement écarté? Hélas, non!A onze heures du matin, un bruit formidable retentit; c'est une bombe lancée par un Taube.L'hôtel des postes, visé, n'a pas été atteint. Les projectiles sont tombés sur l'hôtel de Bretagne, rue d'Inkermann, n'occasionnant heureusement que des dégâts matériels. La foule s'empresse, se rend sur les lieux du sinistre, commente l'événement. Il faut s'attendre à tout et les plus optimistes commencent à entrevoir la gravité de la situation. Plusieurs habitants font des installations sommaires dans les caves, en prévision des heures qui vont suivre. Cependant les autorités n'ont pas encore parlé, on essaie de se rassurer, tout en éprouvant malgré soi un affreux serrement de cœur.
Samedi 10 octobre. — L'agitation en ville est extrême. Des affiches signées par le maire sont apposées sur les murs; des attroupements se forment pour les lire; les yeux ne peuvent se détacher des gros caractères imprimés qui s 'étalent sur la muraille. Inutile de se faire illusion, le danger est immédiat! Le maire supplie la population de se montrer calme et digne.« La proximité des armées ennemies, dit l'affiche, fait redouter des incursions sur notre territoire. Que chacun reste chez soi et ne prenne pas part à la lutte, s'il veut éviter d'atroces représailles sur les femmes et sur les enfants. »
La consternation est générale; on va donc se battre!Une question se pose: Lille est-elle ville ouverte ou ville fermée? Les opinions les plus opposées, les plus absurdes aussi se croisent; on en est réduit aux hypothèses. Il faut attendre, et cette attente est mortellement angoissante.La ville est silencieuse et déserte. C'est une ville morte ou plutôt une ville qui semble attendre la mort. Les magasins sont fermés, les volets sont mis aux fenêtres. Çà et là il y a bien quelques rares passants, mais ils marchent tête basse, ils ont l'air tout désemparés.
Rue Esquermoise, une vision terrible: du côté de la rue de la Barre surgissent des ulhans coiffés de leurs casques à pointe. Ils viennent de la direction de Saint-André.J'ai besoin de tout mon courage pour traverser la rue et pénétrer rue Basse, dans le premier couloir qui s'offre à moi. De là je vois les cavaliers allemands passer au galop. Ils sont une quarantaine et paraissent inquiets, jetant des regards à droite et à gauche comme des gens peu sûrs d'eux-mêmes. Ils se dirigent vers la mairie pendant que je me sauve à toutes jambes pour rentrer chez moi.Une heure plus tard, la rumeur publique nous apprend ce qui s'est passé. Les uhlans ont demandé au maire le passage de la ville pour dix mille hommes, mais on ne sait pas au juste ce qu'a répondu M. Delèsalle. Quant aux uhlans, ils sont partis, leur mission étant terminée.Alors se produit un coup de théâtre inattendu. Les chasseurs à cheval, sortis dès l'aube pour faire une reconnaissance aux environs, rentraient fatigués et débouchaient Grand' Place quand ils aperçurent les Allemands. Nos héroïques soldats s'élancèrent à leur poursuite et, d'après ce qu'on nous dit, bien peu ont échappé au massacre.
L'après-midi est calme, personne n'ose sortir; on pressent quelque chose de grave, et, selon l'expression du maire qui durant tous ces jours d'angoisse s'est montré admirable, on attend « dans le silence qui convient aux grandes douleurs ».Vers cinq heures et demie, de nouveaux coups de feu retentissent. Des cyclistes allemands précédant des cavaliers sont arrivés par le grand boulevard et, en traversant la rue des Arts, se sont rencontrés avec quelques soldats français. Ceux- ci ont tiré, les autres ont riposté. Pendant que la lutte continue, les cavaliers allemands vont droit à la mairie pour s'emparer du maire et des adjoints. Ce sont des garants pour leur sécurité et, selon leur habitude, ils les mettent devant eux pour se faire conduire à la Préfecture. Mais ce plan échoue devant la fière attitude des goumiers qui gardent la Préfecture. Alors, ne se sentant plus en sûreté, ils prennent le parti le plus sage, la fuite.Jusqu'à six heures et demie, on entend le grondement du canon et des mitrailleuses; les balles sifflent, elles cinglent les façades des maisons.
Quand un calme relatif se rétablit, on va aux nouvelles chez les voisins et voisines. Le bombardement est imminent; il faut passer la nuit dans les caves!La plupart des habitants s'y résignent, mais ce n'est qu'une fausse alerte, la nuit s'écoule dans le silence.
Dimanche 11 octobre. — A neuf heures du matin, coups de canon... panique indescriptible.... Tout le monde rentre chez soi, effaré... les églises se ferment... on descend dans les caves. A dix heures, accalmie. On reprend espoir et peu à peu les curieux vont aux informations. Les portes de la ville sont maintenant gardées par des soldats qui organisent des barricades. Des chariots, des charrettes mis en travers de la chaussée sont entassés les uns sur les autres. Il fait froid. On va distribuer des cache-nez et des gants de laine à ceux qui exposent si courageusement leur vie pour la défense de la ville. Et ils nous rassurent, ces braves, ils nous font espérer que les Allemands n'auront pas la satisfaction d'avoir la clef du Nord: Lille!L'après-midi s'écoule lentement et confirme cet espoir. Le canon gronde dans le loin tain, mais malgré cela les Lillois se promènent tranquillement en "famille, tous veulent voir les barricades élevées aux portes, ces fameuses barricades dont tout le monde parle.
La Ville en Flammes.
Lundi 12 octobre. — Quelle nuit!... Nous n'avions pas jugé bon de descendre dans la cave, espérant passer une nuit calme. Mais vers dix heures un bruit infernal nous réveille. Cette fois c'est bien le bombardement, réglé, méthodique. Les bombes pleuvent sur la ville. Nous nous précipitons dans la cave et nous y passons des heures que jamais je n'oublierai. Il faut avoir entendu le sifflement des obus et leur éclatement formidable pour comprendre toute l'horreur de la situation! La maison tremble, tout menace de s'écrouler, et devant nous, se dresse menaçante la vision d'être ensevelies sous les décombres. A peine sommes-nous remises d'une émotion, d'une alerte, que de nouveau le sifflement d'un obus recommence. Nous l'entendons passer au-dessus de nos têtes et s'abattre avec fracas sur une maison voisine. Les bombes se succèdent sans interruption depuis dix heures du soir jusqu'à deux heures du matin. Nous sommes mortes de fatigue, de frayeur.
Vers trois heures une sorte d'apaisement se produit; nous décidons de remonter dans nos chambres pour essayer de nous reposer. Mais quand nous nous approchons de nos fenêtres, quelle épouvante! tout le ciel est en feu!Le crépitement des incendies arrive jusqu'à nous, nous frissonnons de terreur!La prudence exige que nous songions à parer à tout événement. Qui sait si, tout à l'heure, notre maison ne sera pas, elle aussi, la proie des flammes?Nous nous habillons en toute hâte et, fiévreusement, nous préparons une valise. Il y a des allées et venues dans la rue, et des voix angoissées demandent quels sont les bâtiments qui brûlent.
C'est le « Bon Génie »...
c'est la « Salpêtrière »....
On dit que tout le quartier va sauter.Cependant le canon ne tonne plus (les Allemands n'ont pas encore toutes leurs munitions) et les pompiers et les soldats s'emploient de toutes leurs forces pour arrêter le progrès des incendies.Il n'est, bien entendu, plus question de repos pour la nuit.Nous attendons le lever du jour avec anxiété pour nous rendre chez des amis où nous serons plus en sûreté. Leur cave est voûtée, les éboulements y seront moins à craindre.A cinq heures et demie du matin, le bombardement recommence, et c'est seulement à huit heures que nous pouvons, au bruit de la canonnade, quitter la maison.Vers dix heures, le bombardement reprend d'une façon terrible, pour ne plus s'interrompre. Toute la nuit, par les soupiraux des caves, on entrevoit les lueurs rouges des incendies qui éclairent tragiquement cette lugubre nuit.Mardi 13 octobre.
— Six heures du matin. Depuis deux heures le canon s'est tu et ce silence pèse lourdement sur nous. Qui a été victorieux?Toute la rue Faidherbe brûle. On marche dans des flaques de sang. La ville est aux Allemands! Depuis moins d'une heure, ils sont entrés dans nos murs, ayant l'audace de chanter leur hymne national au milieu de la ville en flammes.
Dix heures. — Lille brûle! Tous les quartiers ont été visés, les incendies ont éclaté partout! Les Allemands ont coupé les eaux: impossible d'éteindre le feu qui se propage avec une rapidité foudroyante. Les étincelles jaillissent de tous côtés; les morceaux de bois enflammés sont projetés à de grandes distances, provoquant de nouveaux incendies, et tous les habitants, dans un affolement général, tentent de s'enfuir pour échapper à cette fournaise! Mais s'enfuir où? Devant le sort inexorable auquel on ne peut échapper, un sombre désespoir plane sur toute la population.
Midi. — On nous annonce que le maire a obtenu (moyennant 2 millions) que les eaux lui soient rendues. Les pompiers de Roubaix et de Tourcoing sont réquisitionnés. On va circonscrire le feu et dynamiter les maisons voisines de celles qui brûlent, afin d'éviter de dangereux écroulements.Dans l'après-midi, je fais un tour en ville. Hélas! tout dépasse en horreur ce que j'avais pu concevoir. Les chevaux blancs des goumiers n'ont pas encore été ramassés: ils gisent éventres, les entrailles pendantes. Les ruisseaux sont rougis, une odeur acre de fumée me prend à la gorge et j'aperçois les immenses brasiers où les pompiers lancent les jets d'eau et multiplient les efforts pour protéger les immeubles avoisinants.Je croise des familles entières qui fuient éperdues, serrant dans leurs bras tout ce qu'il leur est possible d'emporter. Des charrettes les suivent, contenant des matelas, des berceaux. Pauvres gens! Force leur a été de quitter leur foyer, le danger était trop grand. Ils jettent un dernier regard sur leur maison qui n'existera plus dans quelques instants et pleurant, sanglotant, ils s'enfuient! Pendant ce temps les autorités allemandes s'installent à la mairie, à la préfecture.
Mercredi 14 octobre. — Encore une nuit affolante, pleine d'affres angoissantes. Les incendies ont pris hier une extension si considérable que personne n'a osé se coucher. Et voilà la troisième nuit que nous passons debout, éveillées, prêtes à nous sauver au moindre signal.La ville est éclairée comme en plein jour par la lueur des flammes. Des gerbes de feu s'élèvent de toutes parts et s'éparpillent dans toutes les directions. On entend des craquements effroyables; ce sont des pans de murs qui s'écroulent, des toitures qui s'effondrent. Des papiers carbonisés voltigent dans la cour, ils viennent de plusieurs kilomètres de distance. Le vent fait rage, la nuit est mortellement longue!Enfin, vers cinq heures du matin, une immense colonne de fumée noire s'élève du milieu du brasier; c'est la fournaise qui s'éteint, le feu a fini son œuvre de destruction
Les Allemands à Lille
A dix heures, je sors. Partout c'est l'image de la désolation, de la mort. Les ruines de la rue Faidherbe et de la rue de Paris fument encore. Des portes, des armoires, des meubles à moitié carbonisés gisent lamentablement sur le sol. Ici, des lits sont suspendus dans le vide, là des monceaux de pierres et de décombres barrent les rues. Les habitants pâles, exténués, s'abordent tristement. Ah! ce n'est plus la belle Lille d'il y a... quelques jours, si vibrante de vie intense. La nature semble vouloir être en harmonie avec les événements. Il pleut, une petite pluie fine et froide qui vous glace jusqu'aux os tombe sans discontinuer. Des automobiles allemandes circulent dans toutes les directions, officiers et soldats sont en quête de réquisitions.
Déjà des signes à la craie sont faits sur certaines maisons. Sur tous les murs on colle des affiches jaunes et vertes portant des inscriptions qui commencent toutes par ces mots: Ordre à la population lilloise. Ils ordonnent, ils sont donc les maîtres! Des Taubes planent au-dessus de la ville.... C'en est trop! Je ne puis en supporter davantage! Je rentre chez moi, et là, j'éclate en sanglots.
Pendant l'Occupation
Janvier 1915. — Depuis le 13 octobre, jour de deuil pour notre ville, chaque matin, en me réveillant, la même impression angoissante me saisit. Mes yeux sont à peine ouverts que déjà me revient le sentiment poignant de la réalité. Dans une sorte de demi-conscience, j'écoute les bruits de la rue. Ne vais-je pas entendre le cri de ceux qui vendent les journaux locaux: la Dépêche, l'Echo du Nord? Hélas, non! Ce sont les bottes allemandes qui résonnent sur le pavé, ce sont les accents des voix teutonnes, au timble rude et grossier, qui parviennent jusqu'à moi.Cette nuit a été particulièrement lugubre. Des régiments entiers d'Allemands sont passés dans notre rue. Ils venaient de la Madeleine: tapies dans l'obscurité, en écartant légèrement le rideau de la fenêtre, nous avons assisté au défilé qui a duré deux heures. Les grosses pièces de canon s'étaient arrêtées devant notre porte. Oh! ces pièces qui, dans quelques heures, cracheraient la mitraille et sèmeraient mort autour d'elles! Quelle impression elles nous faisaient!Tantôt les cavaliers passaient au galop, tantôt ils s'arrêtaient brusquement aux cris gutturaux des chefs. Le bruit des sabots des chevaux sur le pavé, le roulement des lourdes pièces d'artillerie, les lueurs sinistres projetées par les réverbères, nous offraient une vision d'enfer.
Que Lille est triste et morne par cette froide journée de janvier! Les gens vont et viennent comme des âmes en peine. La vie est suspendue! Les usines ne fonctionnent plus; le travail est arrêté partout!Il faut cependant songer à la vie matérielle, et de grand matin, les ménagères sont en quête pour faire leurs provisions.La plupart des boulangeries sont fermées, et il faut parfois faire queue pour avoir... du pain! Et quel pain! Ce fameux pain K qui nous rend tous si malades! Quand nous le voyons arriver sur la table, des nausées nous prennent, et, bien souvent, c'est en soupirant et les larmes aux yeux, que nous nous décidons à le manger. Il le faut bien: il n'y en a pas d'autre!Quelques personnes se procurent du blé (comment et à quel prix!) et le moulent dans des moulins à café. D'autres achètent des farines mixtes (seigle et fécule de pommes de terre) et arrivent à faire un pain supportable. Nous allons essayer de ce système. Le pain K est si écœurant depuis quelques jours! A l'extérieur, la croûte est épaisse, dure — on dirait une pierre — et à l'intérieur, c'est une sorte de pâte molle, visqueuse, où le doigt s'enfonce et reste collé! Impossible de le manger frais. Nous le laissons souvent trois ou quatre jours dans la cave.De quoi se compose-t-il donc? Personne ne le sait! Les docteurs nous conseillent d'en manger le moins possible et de le remplacer par des pommes de terre.Ces dernières, heureusement, sont à un prix raisonnable. On trouve aussi facilement des œufs conservés. Les villageois installent, chaque matin, des caisses remplies d'œufs sur les trottoirs; ils ont hâte d'écouler leur marchandise pour ne pas être réquisitionnés.Le lait est rare! Les vaches des fermiers habitant la banlieue ont été prises en grande partie par les Allemands. Quant aux laitiers, ils sont souvent arrêtés aux portes, et obligés de donner aux soldats le contenu de leurs bidons!Les vivres ont augmenté , la vie est chère! La viande est hors de prix et va devenir un article de luxe.Hélas! « Il faut manger pour vivre » et les seuls magasins qui vendent sont les magasins de victuailles. Aussi les devantures offrent un aspect hétéroclite! Ici, l'étalage d'une modiste s'est transformé en une exposition de fromage, beurre et œufs. Là, un coiffeur se met à vendre du riz et des haricots. Les prix sont écrits en grosses lettres pour attirer la clientèle!Dans les grandes épiceries, il faut attendre son tour, et les Allemands accaparent tout. Ils ne se contentent pas de leurs magasins à eux, installés rue Nationale, où il trouvent d'énormes saucisses, des pâtés colossaux, des produits de charcuterie de toutes sortes. Ils exigent ce qu'il y a de plus fin, de meilleur et envahissent tous les endroits où il y a quelque chose à prendre. On ne peut rencontrer un Allemand, sans un paquet sous le bras. Le plus souvent, c'est un paquet de gâteaux ou de friandises!Il y a pénurie de pétrole! Plus une goutte d'essence et les bougies se font rares! Aussi les pauvres gens s'éclairent avec une sorte de veilleuse, au bec lumineux, inventée pour la circonstance.
L'échange de la monnaie est aussi devenu un problème qui se complique de jour en jour. Il n'y a plus de pièces d'argent. Des billets émis par la ville sont mis en circulation (billets de 10 fr., 5 fr., 2 fr., 1 fr., 0 fr. 50 et 0 fr. 25) et la monnaie de billon se fait si rare qu'on parle même de faire des billets de 0 fr. 10.La misère est grande et les secours de chômage que doit distribuer la ville sont nombreux. La Caisse d'épargne a enfin rouvert ses portes, et tous les quinze jours, on peut toucher 50 francs en billets de la ville.La vie qu'on mène ici est une vie automatique, abrutissante! Plus de journaux à lire, sauf le Bien public de Gand, censuré par les Allemands, et la Gazette des Ardennes, dont la rédaction est toute allemande.Un seul thème à discuter! Toujours le même: l'occupation! C'est un cauchemar qu'on vit à toute heure du jour. Aussi, pour échapper à cette obsession qui me tue, je sors le plus possible. Je vais aux nouvelles, je veux me rendre compte de la physionomie de la ville.
Tout d'abord, je vais en pèlerinage, place Saint-Martin. Je salue notre cher drapeau, le fanion en zinc que les Allemands (négligence inouïe de leur part) ont oublié d'enlever au poste de police.Hier, je le regardais discrètement, le moindre geste étant sujet à suspicion, quand des gens, hommes et femmes, se mirent à courir devant moi dans une grande agitation.
« Des prisonniers! »En effet, de la porte de Gand, surgissaient des uhlans à cheval qui encadraient nos vaillants pioupious, nos chers soldats français. Mon cœur se serrait pendant qu'on leur jetait du pain, du chocolat, des cigares, tout ce que l'on avait sous la main. Comme on les interrogeait avec avidité!«
D'où venez-vous?
« — D'Ypres!
— De La Bassée! »
L'un d'eux jetait une adresse de parents qu'il fallait prévenir.Hélas! ils ne faisaient que passer dans notre ville, et, le soir même, ils partaient pour un camp allemand.Sur ma route, j'aperçois de nouvelles grandes affiches. Encore! Qu'ont-ils donc inventé aujourd'hui pour nous tourmenter? Ce sont des ordres:« Tous les pigeons doivent être mis à mort dans les vingt-quatre heures.« Les groupes de plus de cinq personnes sont formellement interdits, etc.... »Encore des réquisitions:« Tous les harnais, toutes les selles de chevaux doivent être déposés à tel endroit, tel jour, à telle heure.... »
Grand'Place, que tout est changé! Je n'y suis pas encore habituée! Le cadran de la Grand'Garde est largement ébréché. Un obus a fait un trou béant dans le mur de L’Ècho du Nord. Des soldats allemands font le guet, baïonnette au canon. Une mitrailleuse est installée, en face de la halle Saint-Nicolas, menace perpétuelle pour la ville.Tous les cafés regorgent d'officiers allemands qui prennent leur apéritif. Leurs autos (les autos qu'ils ont volées) sont alignées, et les chauffeurs, vêtus de peau de buffle, lisent leur correspondance ou déploient leurs journaux, en attendant les ordres des chefs.Cette vue me cause un malaise indéfinissable. Je me hâte. D'ailleurs, il est presque onze heures, et je ne veux pas être témoin du pas de parade des troupes de couverture qui, musique en tête, partent chaque matin de l'hôpital militaire, enfilent la rue Nationale, font le tour de la Grand'Place et se dispersent ensuite, enchantés de l'impression qu'ils pensent avoir produite sur la population.Quelles nouvelles vais-je rapporter ce matin? Rien, où pas grand'chose. J'ai bien rencontre des voitures de ravitaillement qui disparaissaient, les unes du côté d'Haubourdin, les autres vers Saint André, mais ce n'était pas une indication. J'en étais réduite aux conjectures.Tous les jours, les ennemis affichent des communiqués. Faut-il les croire? Pour tous, l'impression est la même. On voudrait ne pas les lire,on passe indifférent, et pourtant, malgré soi, on revient, pour essayer de deviner le sens caché entre les lignes. On écoute les réflexions des gens sensés, on hausse les épaules à la lecture du chiffre fantastique de prisonniers faits par les Allemands; et les officiers nous croisent, officiers de parade, la figure balafrée, la cravache à la main, qui sourient d'un mauvais sourire, en voyant que nous rie sommes pas dupes de leurs mensonges.Les après-midi sont bien monotones. La même idée obsédante nous poursuit. On essaie bien de s'occuper, mais c'est un travail machinal; on est vite lassé.
La pensée est au loin... dans les tranchées... à Paris, dont nous ne savons rien. Que se passe- t-il là-bas?Je reste des heures entières à consulter la carte, je fais des plans, mais ma stratégie est bientôt mise en défaut, réduite à néant, et je pousse un gros soupir.J'ai besoin de mouvement. Je sors, je vais, parcourant l'un ou l'autre des quartiers de la ville.Partout des ruines, des maisons aux étages branlants, des poutres qui menacent de tomber. A chaque pas, une nouvelle émotion, une oppression qui m'étouffe.Au-dessus de ma tête, se livrent des combats aériens. J'aperçois distinctement les panaches de fumée, les flocons noirs qui disparaissent dans le ciel gris du nord. Je tremble pour ceux qui sont là-haut, pour nos héroïques aviateurs! Malheureusement l'avion est trop haut, il m'est difficile de suivre les péripéties du combat. Peu à peu, les coups de feu se font plus rares....L'aéro disparaît! Où va-t-il? Chez nous! Je le regarde disparaître avec joie et orgueil, et, en même temps, je souris intérieurement, en voyant devant moi l'expression grimaçante d'un soldat allemand, à figure rabougrie, qui, lui aussi, a suivi les phases de la lutte....P
lus loin, je rencontre des automobiles chargées de couronnes mortuaires en fleurs naturelles. Il y en a à profusion! A qui sont destinés ces monceaux de fleurs? Pour le coup, ma curiosité est excitée.« C'est pour un haut personnage qui est mort à l'hôpital Saint-Sauveur, me répond- on. — C'est le Kronprinz! ajoute une autre personne; toutes les diaconesses allemandes ont pleuré ce matin; il paraît qu'on va transporter, ce soir, le corps en Allemagne! »J'avoue que je ne crois pas à la mort du Kronprinz, c'est une fable qu'on m'a contée trop de fois, mais j'apprends quand même la nouvelle avec plaisir.
Il est cinq heures. C'est l'heure du thé. A la Marquise de Sévigni, les salons du premier étage sont brillamment éclairés, les rideaux sont écartés, afin qu'on puisse mieux voir les officiers allemands siroter leur café ou leur chocolat!Sur toute ma route, c'est un fourmillement de Boches. Ils sont partout, ils ont toutes les audaces, on les retrouve jusque dans les églises.Et à mesure que le jour tombe, les rats sortent plus nombreux (c'est le surnom bien suggestif qu'on leur a donné ici), ils se répandent dans les rues. La ville leur appartient plus encore, si c'est possible, puisque les civils doivent être rentrés pour huit heures. Dès ce moment, les despotes allemands ne tolèrent plus de lumières aux fenêtres. Des coups de crosse aux portés rappellent à l'ordre ceux qui seraient tentés d'oublier la consigne.Fatiguées, lasses de trop penser, nous nous couchons, tandis qu'au loin, le canon gronde. Sa voix nous est devenue si familière que nous nous endormons quand même, pour nous réveiller le lendemain, et revivre une nouvelle journée de tristesse sous le joug écrasant des oppresseurs.








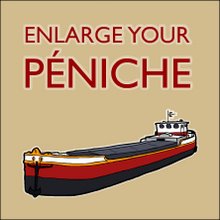

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire